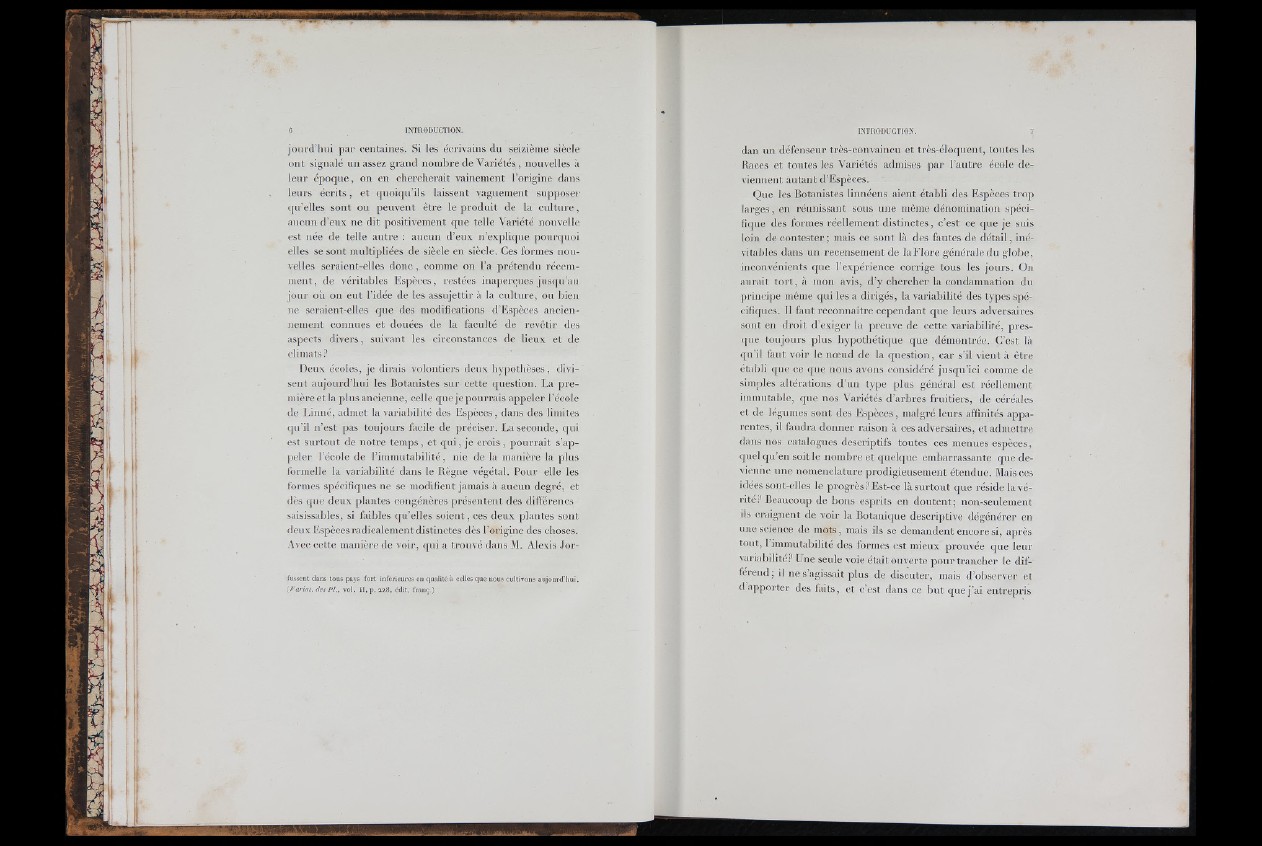
i l III
(I ;
6 INTRODUCTION.
joiird’luii par centaines. Si les écrivains du seizième siècle
ont signalé un assez grand nombre de Variétés , nouvelles à
leur époque, on en cliercherait vainement l’origine dans
leurs écrits, et quoiqu’ils laissent vaguement supposer
qu'elles sont on peuvent être le produit de la cultine,
aucun d’eux ne dit positivement que telle Variété nouvelle
est née de telle autre ; aucun d’eux n’explique ponrcpioi
elles se sont multipliées de siècle en siècle. Ces formes non-
\elles seraient-elles donc , comme on l’a prétendu récemment,
de véritables Espèces, restées inaperçues ¡nstpi’au
jour où on eut l’idée de les assujettir à la culture, on bien
ne seraient-elles que des modifications d’Espèces anciennement
connues et douées de la faculté de revêtir des
aspects divers, suivant les circonstances de lieux et de
climats?
Deux écoles, je dirais volontiers deux hypotlièses, divisent
aujourd’hui les Botanistes sur cette question. La pre-
mièreetla plus ancienne, celle qnejepourrais appeler l ’école
de Linné, admet la variabilité des Espèces, dans des limites
<]ii'il n’est pas toujours facile de préciser. La seconde, qui
est surtout de notre temps , et q u i, je crois , pourrait s’appeler
l’école de l’immutabilité, nie de la manière la plus
tbrmelle la varialiilité dans le Règne végétal. Pour elle les
formes spécifiques ne se modifient jamais à aucun degré, et
dès que deux plantes congénères présentent des différencs
saisissables, si faibles qu’elles soient, ces deux plantes sont
deux Espèces radicalement distinctes dès l ’origine des choses.
.Avec cette manière de voir, ([ni a trouvé dans M. Alexis Jorfu
s s e n t clans to u s p a y s f o r t in f é r ie u re s en ciuaiité à c elle s tju e n o u s c u ll iïo n s a iijo u r< riiu i.
[f^ariai. (les P l ., v o l. I I , p , 228, e d it, franc;,)
dan tin déiènseur très-convaincu et très-élo([uent, toutes les
Races et tontes les Variétés admises par l ’autre école deviennent
autant d’Espèces.
Que les Botanistes linnéens aient établi des Espèces trop
larges, en réunissant sons une même dénomination spété-
fique des formes réellement distinctes, c’est ce que je stiis
loin de contester ; mais ce sont là des fautes de détail, inévitables
dans un recensement de la Flore générale du globe,
inconvénients que l’expérience corrige tous les jours. On
aurait tort, à mon avis, d’y chercher la condamnation du
priii(‘i])e même qui les a dirigés, la variabilité des types spé-
ciiifpies. 11 faut reconnaître cependant que leurs adversaires
sont en droit d’exiger la preuve de cette variabilité, pres-
(pie toujours plus liypothéti([ue que démontrée. C’est là
cpi'il faut voir le noeud de la (juestion, car s'il vient à être
étaJili que ce ([iie nous avons considéré jusqu’ici comme de
simples altérations d’un type plus général est réellement
immutable, que nos Variétés d’arbres fruitiers, de céréales
et de légumes sont des Espèces, malgré leurs aflinités apparentes,
il faudra donner raison à ces adversaires, et admettre
dans nos catalogues descriptifs tontes ces menues espèces,
(piel qu’en soit le nomlire et quelque embarrassante que devienne
une nomenclature prodigieusement étendue. ÎMaisces
idées sont-elles le progrès?Est-ce là surtout que réside la vérité?
Beaucoup de bons esprits en doutent; non-seulement
ils craignent de voir la Botaniijue descriptive dégénérer en
une science de mots, mais ils se demandent encore si, après
tout, l ’immutabilité des formes est mieux prouvée que leur
variabilité? Une seule voie était ouverte pour trancher le différend;
il ne s’agissait plus de discuter, mais d’ol)scrver et
d apporter des faits, et c’est dans ce but q u e j’îü entrepris