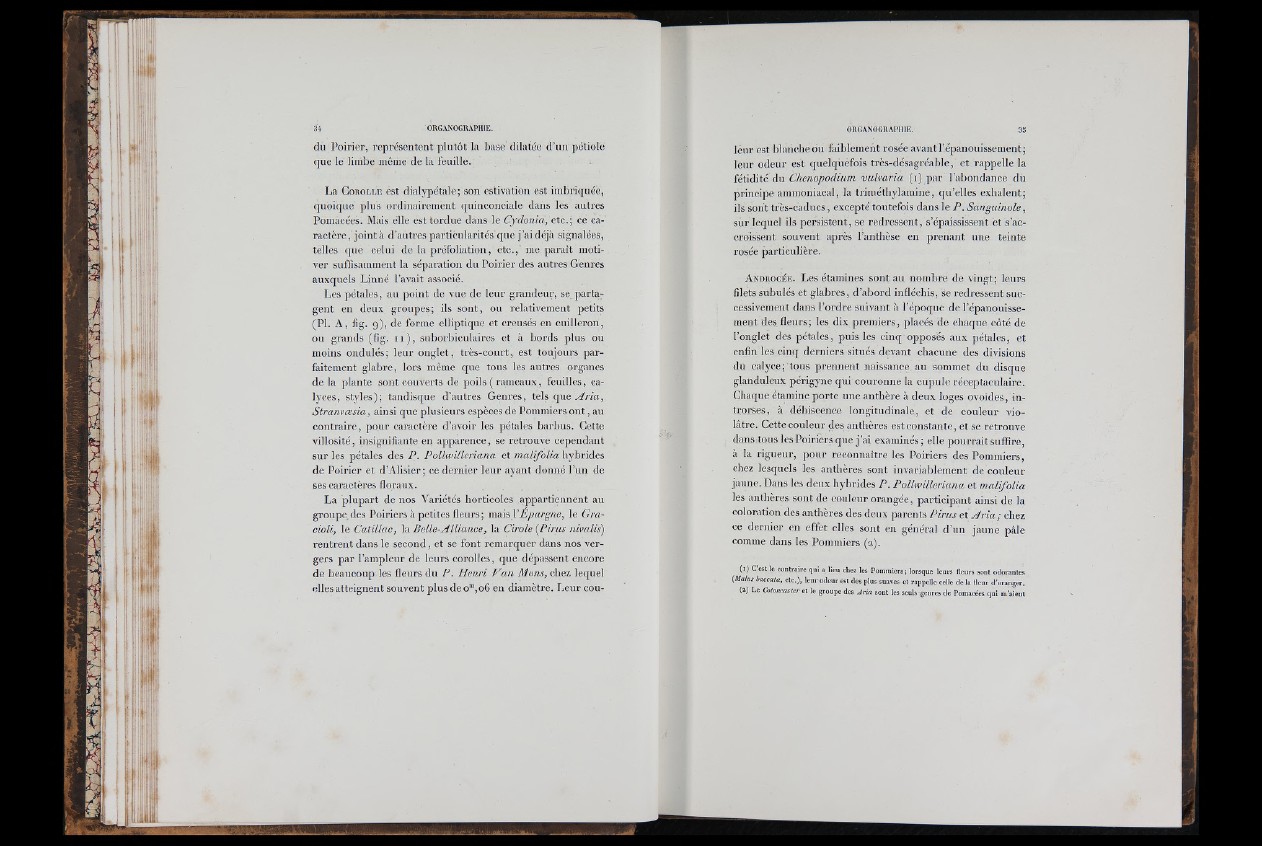
3 4 O B G A N O G nA P IllE .
du Poirier, représentent plutôt la base dilatée d’un pétiole
que le limbe mcine de la feuille.
La C orolle est dialypétale; son estivation est imbriquée,
quoique plus ordinairement quinconciale dans les autres
Pomacées. Biais elle est tordue dans le Cydonia, etc.; ce caractère,
jointà d ’autres particularités que j ’aidéjà signalées,
telles que celui de la préfoliatioii, etc.,' me paraît motiver
suffisamment la séparation du Poirier des autres Genres
auxquels Linné l ’avait associé.
Les pétales, ati point de vue de leur grandeur, se partagent
en deux groupes; ils sont, ou relativement petits
(PL A , fig. 9), de forme elliptique et creusés en cuilleron,
ou grands (fig. 1 1 ) , snborbiculaires et à bords plus ou
moins ondulés; leur onglet, très-court, est toujours parfaitement
glabre, lors même que tous les autres organes
de la plante sont couverts de poils ( rameaux, feuilles, ca-
lyces, styles ) ; tandisque d’autres Genres, tels que A r ia ,
Stranvæsia, ainsi que plusieurs espèces de Pommiers o n t, au
contraire, pour caractère d ’avoir les pétales barbus. Cette
villosité, insignifiante en apparence, se retrouve cependant
sur les pétales des P . Poiiwiiieriana et malifolia hybrides
de Poirier et d’Alisier; ce dernier leur ayant donné l ’un de
ses caractères floraux.
La plupart de nos Variétés horticoles appartiennent au
groupe, des Poiriers à petites fleurs ; mrô?,YÉpargne, le Gra-
cioli, le Catillac, la Belle-Alliance, la Cirole {Pirus nivalis)
rentrent dans le second, et se font remarquer dans nos vergers
par l ’ampleur de leurs corolles, que dépassent encore
de beaucoup les fleurs du P. Henri Van Mons, chez lequel
elles atteignent souvent plus de o",oG en diamètre. Leur couleur
est blanche ou faililement rosée avant l ’épanouissement;
leur odeur est quelquefois très-désagréable, et rappelle la
fétidité du Chenopodium vulvaria (1) par l ’abondance du
principe ammoniacal, la trimétbylamine, qu’elles exhalent;
ils sont très-caducs, excepté toutefois dans \e P . Sanguinole,
sur lequel ils persistent, se redressent, s’épaississent et s’accroissent
souvent après l’anthèse en prenant une teinte
rosée particulière.
A ndrocée. Les étamines sont au nombre de vingt; leurs
filets subulés et glabres, d’abord infléchis, se redressent successivement
dans l ’ordre suivant à l ’époque de l ’épanouissement
des fleurs; les dix premiers, placés de chaque côté de
l’onglet des pétales, puis les cinq opposés aux pétales, et
enfin les cinq derniers situés devant chacune des divisions
du calyce; tous prennent naissance au sommet du disque
glanduleux périgyne qui couronne la cupule réceptaculaire.
Chaque étamine porte une anthère à deux loges ovoïdes, in-
trorses, à déhiscence longitudinale, et de couleur violâtre.
Cette couleur des anthères est constante, et se retrouve
dans tous les Poiriers que j ’ai examinés; elle pourrait suffire,
à la rigueur, pour reconnaître les Poiriers des Pommiers,
chez lesquels les anthères sont invariablement de couleur
jaune. Dans les deux hybrides P . Poiiwiiieriana et malifolia
les anthères sont de couleur orangée, participant ainsi de la
coloration des anthères des deux parents Pirus et A r ia ; chez
ce dernier en effet elles sont en général d’un jaune pâle
comme dans les Pommiers (2).
( i ) C’e s t le c o n tra ir e q u i a lie u c h e r les P om in ie r s t lo r s q u e le u rs fleu rs s o n t o d o r a n te s
[Mahts baccattt, e tc .) , le u r o d e u r e s t d e s p lu s su a v e s e t ra p p e lle c elle d e la fleu r d 'o r a n g e r .
(a ) L e Cotoneaster e t le g r o u p e d e s d r ia s o n t les seu ls g e n re s d e P om a c é e s q u i m 'a ie iil
i