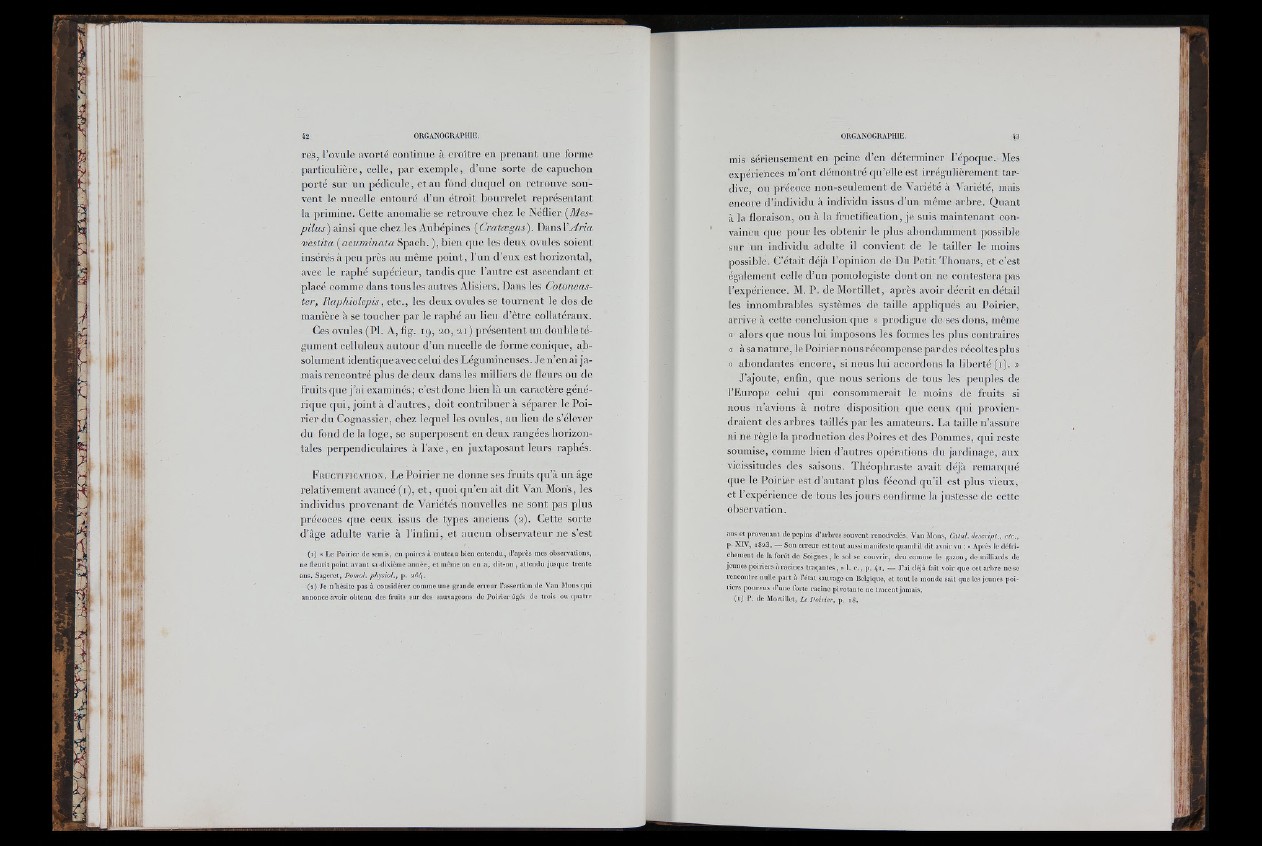
11 ,
; i; i
Ml!
■ 17
■1.. .AT
.!■û '■ii■üyllçl-
r ,,
'I [ ?;!■
res, l’ovule avorté continue à croître en prenant une forme
particulière, celle, par exemple, d’une sorte de capnclion
porté sur un pédicule, et au fond diupicl on retrouve souvent
le luicelle entouré d’un étroit bourrelet représentant
la primine. Cette anomalie se retrouve chez le Néüier (Mes-
pilus) ainsi que chez les Aubépines (Cratoegi/s). D:msVAria
vestita [acuminata Spaeli. ), bien ([ue les deux ovules soient
insérés à peu près au même point, l ’un d’eux est liorizontal,
avec le raphé supérieur, tandis que l’autre est ascendant et
placé comme dans tous les autres Alisiers. Dans les Cotoneaster,
Raphiolcpis, etc., les deux ovules se tournent le dos de
manière à se toucher par le raphé au lieu d’être collatéraux.
Ces ovules (PI. A, fig. 19, 20, 2 1 ) présentent un double tégument
celluleux autour d’un nucelle de forme conique, al)-
solument identique avec celui des Légumineuses, .le n’en ai jamais
rencontré plus de deux dans les milliers de fleurs ou de
fruitsque j ’ai examinés; c’est donc bien là un caractère générique
qui, joint à d’autres, doit contribuer à séjiarer le Poirier
du Cognassier, chez lequel les ovules, au lieu de s’élever
du fond delà loge, se superposent en deux rangées horizontales
perpendiculaires à l’axe, en juxtaposant leurs raphés.
F buc tif ic .atiox. Le Poirier ne donne ses fruits qti’à u n âge
relativement avancé (t), et, cpioi qu’en ait dit Van Mons, les
individus provenant de Variétés nouvelles ne sont pas pins
précoces que ceux issus de types anciens (2). Cette sorte
d’âge adulte varie à l ’infini, et aucun ol)servateur ne s’est
( i ) " L e P o i r ie r d e sem is, en p o ire s à c o u te a u b ie n e n te n d u , d ’a p rè s m e s o b s e rv a tio n s ,
n e f le u r it p o in t a v a n t sa d ix ièm e a n n é e , c t m êm e o n en a , d i t- o n , a tte n d u ju s q u e tr e n te
a n s . S a g e re t, Poinol. pitysiol., p . afi.'j.
( î ) J e n ’h é s ite p a s à c o n s id é r e r c om m e u n e g r a n d e e r r e u r l’a s s e r tio n d e V a n M o n s q u i
a n n o n c e a v o ir o b te n u d e s f ru i ts s u r d e s s a u v ag e o n s d e P o i r i e r âg és d e tr o is o u q u a tre
mis sérieusement en peine d’en déterminer l ’époqne. Mes
expériences m’ont démontré (ju’elle est irrégulièrement tardive,
ou précoce non-seulement de Variété à Variété, mais
encore d’individu à individu issus d’un même arbre. Quant
à la floraison, ou à la fructification, je suis maintenant convaincu
([lie pour les obtenir le plus abondamment possible
sur lin individu adulte il convient do le tailler le moins
possible. C’était déjà l ’opinion de Du Petit Tliouars, et c ’est
également celle cl’iiii pomologiste dont on ne contestera pas
l’expérience. M. P. de Blortillet, après avoir décrit en détail
les innombrables systèmes de taille appliipiés an Poirier,
arrive à cette conclusion que « prodigue de ses dons, même
« alors que nous Ini imposons les formes les plus contraires
« àsanatnre, iePoiriernous récompense pardes récoltesplos
K abondantes encore, si nous liii accordons la liberté (i). »
J’ajoute, enfin, que nous serions de tous les peuples de
l’Europe celui (¡ui consommerait le moins de fruits si
nous n ’avions à notre disposition que ceux (¡ni proviendraient
des arbres taillés par les amateurs. I.a taille n ’assure
ni ne règle la production des Poires et des l“oimiies, ([ui reste
soumise, coiiiiiie bien d’autres opérations du jardinage, aux
vicissitudes des saisons. 'l'héophraste avait déjà remai([ué
que le l'oirier est d’autant pins fécond (jii’il est pins vieux,
et l ’expérience de tous les jours confirme la justesse de cette
observation.
an s e t p ro v e n a n t d e p é p in s d ’a rb r e s so u v e n t r e n o u v e lé s . V a n M o n s , Ca/al. descript., d e .,
p . X IV , 182 3. — S o n e r r e u r e s t to u t a u s sh n a n ife s te q u a n d il d it a v o ir v u : • A p rè s le d é fr ic
h em e n t d e la fo rê t d e S o ig n e s , le so l se c o u v r ir , d r u c om m e le g a z o n , d e m illia rd s d e
je u n e s p o ir ie rs à ra c in e s t r a ç a n t e s , » I. <■., p . 41. — J ’a i d é jà fait v o ir q u e c e t a rb r e n e se
r e n c o n tr e n u lle p a r t à l’é ta t sau v ag e en B e lg iq u e , e t to u t le m o n d e s a it q u e les je u n e s p o irie
r s p o u rv u s d ’u n e fo rte r a c in e p iv o ta n te n e tr a c e n t jam a is .
( 0 P- d e MoiTillet, Le Poirier, p . 18.
r r