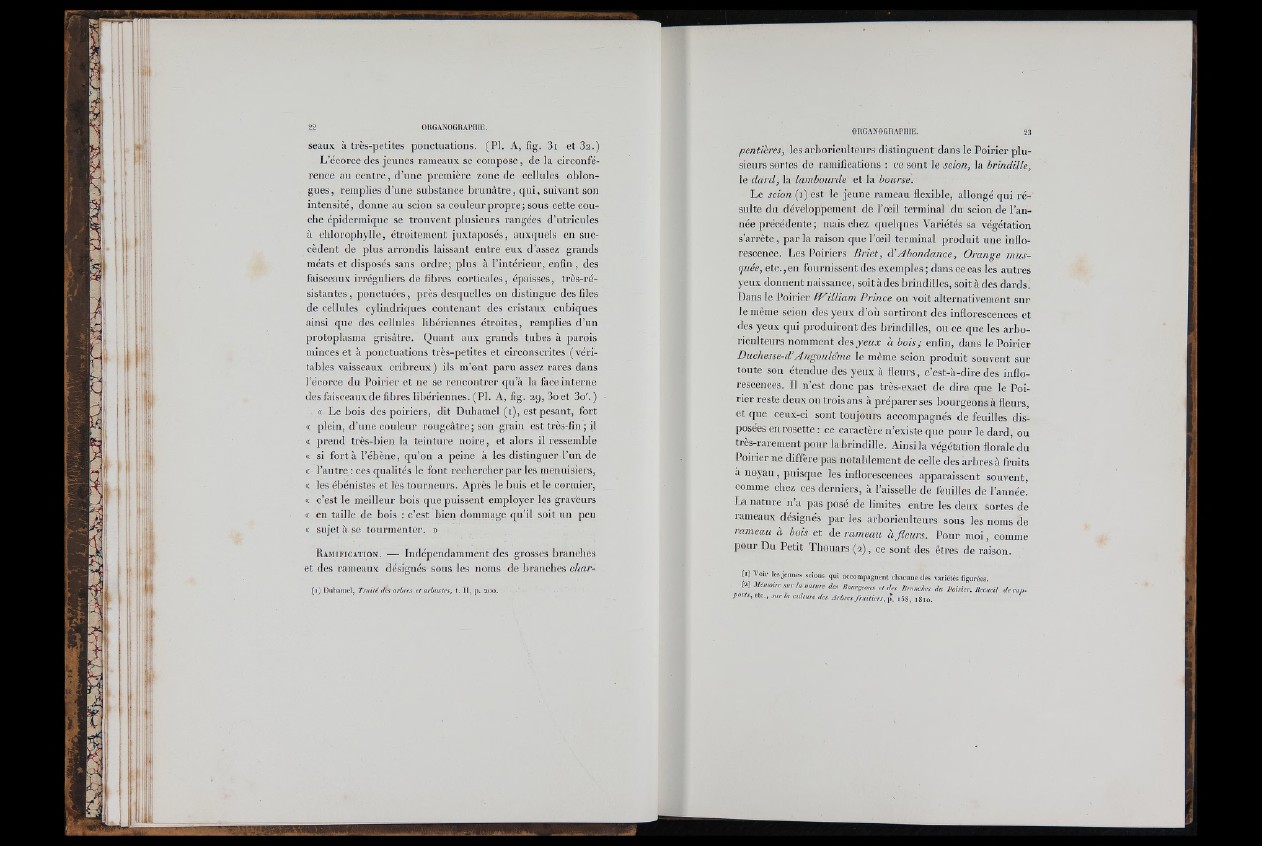
I'
r|l‘
seaux à très-petites ponetuations. (Pl. A, fig. 3 i et Sa.)
Leeorcedes jeunes rameaux se compose, de la circonférence
an centre, d ’une première zone de cellules oblon-
gues, remplies d ’une substance brunâtre, qui, suivant son
intensité, donne au scion sa couleur propre; sous cette couche
épidermique se trouvent plusieurs rangées d’ntricules
à eliloroplivlle, étroitement juxtaposés, auxquels en succèdent
de plus arrondis laissant entre eux d’assez grands
méats et disposés sans ordre; plus à l’intérieur, enfin, des
faisceaux irréguliers de libres corticales, épaisses, très-résistantes
, ponetuées, près desquelles on distingue des files
de cellules cylindriques contenant des cristaux cubiques
ainsi que des cellules libériennes étroites, remplies d’un
protoplasma grisâtre. Quant aux grands tubes à parois
minces et à ponctuations très-petites et circonserites ( véritables
vaisseaux cribreux ) ils m’ont paru assez rares dans
l ’écorce du Poirier et ne se rencontrer qu’à la lace interne
des faisceaux de fibres libériennes. (Pl. A, fig. 29, 3oet 3o’ . )
« Le bois des poiriers, dit Dnbamel (1), est pesant, fort
n plein, d’une couleur rougeâtre; son grain est très-fin ; il
« prend très-bien la teinture noire, et alors il ressemble
<( si fort à l ’ébène, qu’on a peine à les distinguer l'un de
ï l ’autre : ces cjiialités le font rechercherpar les menuisiers,
« les ébénistes et lès tourneurs. Après le buis et le cormier,
« c’est le meilleur bois que puissent employer les graveurs
K en taille de bois : c’est bien dommage qu’il soit un peu
« sujet à se tourmenter. »
R a î i i f i c a t i o n . — Indépendamment des grosses branches
et des rameaux désignés sous les noms de branches char-
( 1) D u h am e l, Traité des arbres ct arbustes, t. I I , p . 2« o .
penticres, les arboriculteurs distinguent dans le Poirier plusieurs
sortes de ramifications ; ce sont le scion, la brindille,
le dard, la lambourde et la bourse.
Le scion le jeune rameau flexible, allongé qui résulte
du développement de l ’oeil terminal du scion de l ’année
précédente ; mais eliez quelques Variétés sa végétation
s’arrête , par la raison que l ’oeil terminal produit une inflorescence.
Les Poiriers Driet, A'Abondance, Orange musquée,
etc., en fournissent des exemples ; dans ce cas les antres
yeux donnent naissance, soit à des brindilles, soit à des dards.
Dans le Poirier FFilliam Prince on voit alternativement sur
le même scion des yeux d’où sortiront des inflorescences et
des yeux qui produiront des brindilles, ou ce que les arboriculteurs
nomment Ad yeux a bois; enfin, dans le Poirier
Duehesse-d’Angouléme le même scion produit souvent sur
toute son étendue des yeux à fleurs, c’est-à-dire des inflorescences.
Il n’est donc pas très-exact de dire que le Poirier
reste deux ou trois ans à préparer ses bon rgeons à fleurs,
et que ceux-ci sont toujours accompagnés de feuilles disposées
en rosette : ce caractère n ’existe que pour le dard, ou
très-rarement pour labrindille. Ainsi la végétation florale du
Poirier ne diffère pas notablement de celle des arbres à fruits
a noyau, puisque les inflorescences apparaissent souvent,
comme chez ces derniers, à l ’aisselle de feuilles de l ’année.
La nature n a pas posé de limites entre les deux sortes de
rameaux désignés par les arboriculteurs sous les noms de
rameau a bois et de rameau à fleurs. Pour m o i, comme
pour Du Petit Thouars (2), ce sont des êtres de raison.
( 1) Voii- les jeunes scions (|ui accoiiipagnent chacune des variélés (igui-ées.
( 2) s,,r h, n ,u „r t Dourgron., et des lir e ,„d e s eh, Poirier. R r c e i l ele rap-
p o r ls, é lu ., la c i t a r e des d i i r e s fru it ie r s , p’. i5 8 , 18 10 .