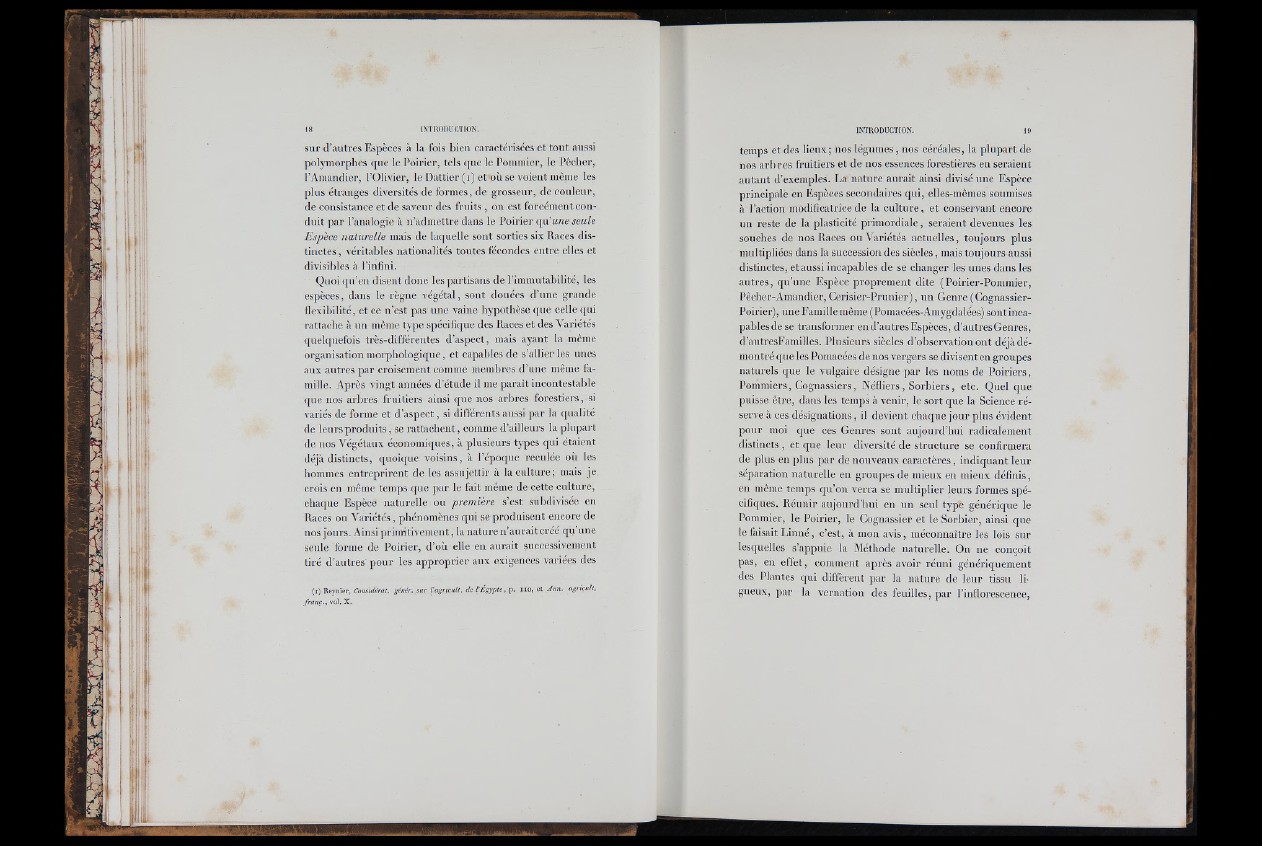
sur d ’autres Espèces à la fois bien caractérisées et tout aussi
polymorphes que le Poirier, tels tpie le Pommier, le Pêcher,
l ’Amandier, l ’Olivier, le Dattier (i) et oit se voient même les
plus étranges diversités de formes, de grosseur, de oonleiir,
de consistance et de saveur des fruits , on est forcément conduit
par l ’analogie à n’admettre dans le Poirier qn’«ne seule
Espèce naturelle mais de laquelle sont sorties six Races distinctes
, véritables nationalités tontes fécondes entre elles et
divisibles à l’infini.
Quoi qu’en disent donc les partisans de l'immutabilité, les
espèces, dans le règne végétal, sont douées d’une grande
flexibilité, et ce n’est pas une vaine hypothèse que celle qui
rattache à un même type spécifique des Races et des Variétés
quelquefois très-différentes d’aspect, mais ayant la même
organisation morphologique, et capables de s’allier les nues
aux antres par croisement comme membres d’une même famille.
Après vingt années d’étude il me paraît incontestable
que nos arbres fruitiers ainsi que nos arlires forestiers, si
variés de forme et d’aspect, si différents aussi par la cjualité
de leurs produits, se rattachent, comme d’ailleurs la plupart
de nos Végétaux économiques, à plusieurs types qui étaient
déjà distincts, quoique voisins, à l ’époque reculée où les
liommes entreprirent de les assujettir à la culture; mais je
crois en même temps que par le fait même de cette culture,
chaque Espèce naturelle ou première s’est subdivisée en
Races on Variétés, phénomènes qui se produisent encore de
nos jours. Ainsi primitivement, la nature n’auraiteréé qu’une
seule forme de Poirier, d’où elle en aurait successivement
tiré d’autres pour les approprier aux exigences variées des
( i ) R e y n ie r, Considérât, géricr. t
f r a n c ., v o l. X.
r l'a g nciilt. de PÉgypte, p . n o , e t /inn. agricult.
temps et des lieux; nos légumes, nos céréales, la plupart de
nos arlires fruitiers et de nos essences forestières eu seraient
autant d’exemples. La nature aurait ainsi divisé une Espèce
principale en Espèces secondaires qui, elles-mêmes soumises
à l ’action modificatrice de la culture, et conservant encore
un reste de la plasticité primordiale, seraient devenues les
souches de nos Races ou Variétés actuelles, toujours plus
multipliées dans la succession des siècles, mais toujours aussi
distinctes, etaussi incapables de se changer les unes dans les
antres, qu’une Espèce proprement dite (Poirier-Pommier,
Pêcher-Amandier, Cerisier-Prunier), un Genre ( Cognassier-
Poirier), une Famille même (Pomacées-Amygdalées) sont inca-
pablesde se transformer end’autres Espèces, d’autres Genres,
d’autresFamilles. Plusieurs siècles d’observation ont déjà démontré
que les Pomacées de nos vergers se divisent en groupes
naturels que le vulgaire désigne par les noms de Poiriers,
Pommiers, Cognassiers, Néfliers, Sorbiers, etc. Quel que
puisse être, dans les temps à venir, le sort que la Science réserve
à ces désignations, il devient chaque jour plus évident
pour moi que ces Genres sont aujourd’hui radicalement
distincts , et que leur diversité de structure se confirmera
de plus en plus par de nouveaux caractères, indiquant leur
séparation naturelle en groupes de mieux en mieux définis,
en même temps qu’on verra se multiplier leurs formes spécifiques.
Réunir aujourd’hui en un seul type générique le
Pommier, le Poirier, le Cognassier et le Sorbier, ainsi que
le faisait Linné, c’est, à mon avis, méconnaître les lois sur
lesquelles s’appuie la Jléthode naturelle. On ne conçoit
pas, eu effet, comment après avoir réuni génériquement
des Plantes qui diffèrent par la nature de leur tissu ligneux,
par la vernation des feuilles, par l ’inflorescence.