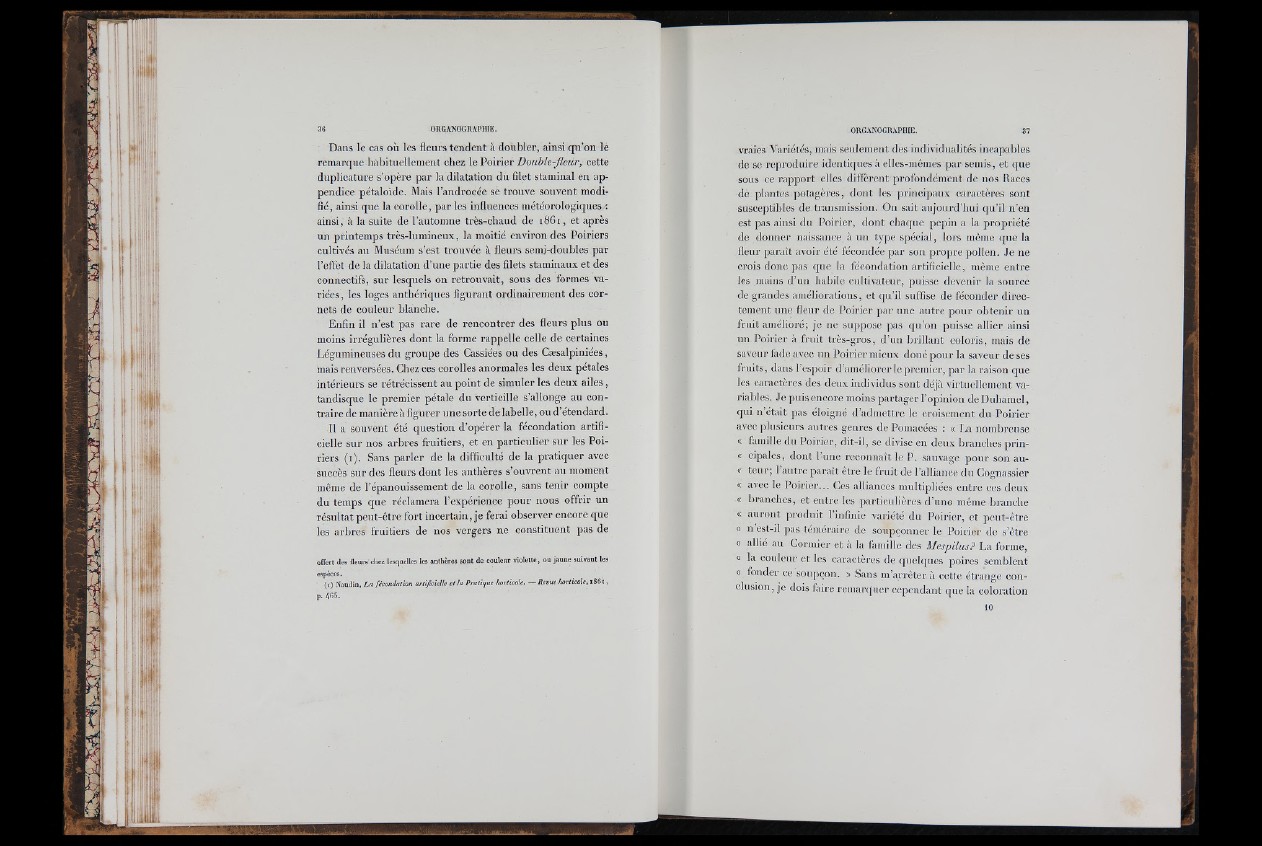
3 6 ORGANOGRAPHIE.
Dans le cas où les fleurs tendent à doubler, ainsi qu’on le
remarque habituellement chez le Poirier Double-fleur, cette
duplicature s’opère par la dilatation du filet staminal en appendice
pétaloide. Mais l ’androcée se trouve souvent modifié,
ainsi que la corolle, par les influences météorologiques :
ainsi, à la suite de l ’automne très-chaud de 18G1, et après
un printemps très-lumiiieux, la moitié environ des Poiriers
cultivés au Muséum s’est trouvée à fleurs semj-doubles par
l ’effet de la dilatation d'une partie des filets staminaux et des
coiinectifs, sur lesquels on retrouvait, sous des formes variées,
les loges anthériqiies figurant ordinairement des cornets
de couleur blanche.
Enfin il n’est pas rare de rencontrer des fleurs plus ou
moins irrégulières dont la forme rappelle celle de certaines
Légumineuses du groupe des Cassiées ou des Cæsalpiniées,
mais renversées. Chez ces corolles anormales les deux pétales
intérieurs se rétrécissent au point de simuler les deux ailes,
tandisque le premier pétale du verticille s’allonge au contraire
de manière à figurer une sorte de labelle, ou d’étendard.
Il a souvent été question d’opérer la fécondation artificielle
sur nos arbres fruitiers, et en particulier sur les Poiriers
(i). Sans parler de la difficulté de la pratiquer avec
succès sur des fleurs dont les anthères s’ouvrent au moment
même de l ’épanouissement de la corolle, sans tenir compte
du temps que réclamera l’expérience pour nous offrir un
résultat peut-être fort incertain, je ferai observer encore que
les arbres fruitiers de nos vergers ne constituent pas de
o ffe rt (les Heurs ch e z lesq u elles les a n th è r e s s o n t (le c o u le u r v io le tte , o u ja u n e s u iv a n t le s
e^pècps.
( [ ) N a u d in , L u fécondation artificielle ct la Pratique horticole. — Revue horticole, i 86i ,
p. 4 6 5 .
vraies Variétés, mais seulement des individualités incapables
de se reproduire identiques à elles-mêmes par semis, et que
sons ce rapport elles différent profondément de nos Races
de plantes potagères, dont les principaux caractères sont
susceptibles de transmission. On sait aujourd’hui ([u’il n’en
est pas ainsi du Poirier, dont chaque pe])iii a la propriété
de donner naissance à un type spécial, lors même que la
(leur paraît avoir été fécondée par son propre pollen. Je ne
crois donc pas que la fécondation artificielle, même entre
les mains d’un liainle cultivateur, puisse devenii- la source
de grandes améliorations, et qu’il suffise de féconder directement
une fleur de Poirier par une autre pour oliteiiir un
fruit amélioré; je ne suppose pas qu’on puisse allier ainsi
un Poirier à fruit très-gros, d ’un brillant coloris, mais de
saveur fade avec un Poirier mieux doué pour la saveur de ses
fruits, dans l ’espoir d’améliorer le premier, par la raison que
les caractères des deux iiidividus sont déjà virtuellement variables.
Je puis encore moins partager l ’opinion de Duliamel,
qui n’était pas éloigné d ’admettre le croisement du Poirier
avec plusieurs autres genres de Pomacées : « La nombreuse
« famille du Poirier, dit-il, se divise en deux branches prin-
(( cipales, dont l ’une reconnaît le P. sauvage pour son au-
-r teur; l ’autre paraît être le fruit de ralliance du Cognassier
« avec le Poirier... Ces alliances multipliées entre ces deux
ce branches, et entre les particulières d’une même l)ranehe
a auront produit l ’infinie variété du Poirier, et peut-être
cc n’est-il pas téméraire de soupçonner le Poirier de s’être
(C allié au Cormier et à la famille des Mespiius? La forme,
« la couleur et les caractères de quelques poires semblent
cc fonder ce soupçon. » Sans m’arrêter à cette étrange conclusion,
je dois faire remaixpier cependant (pie la coloration
10