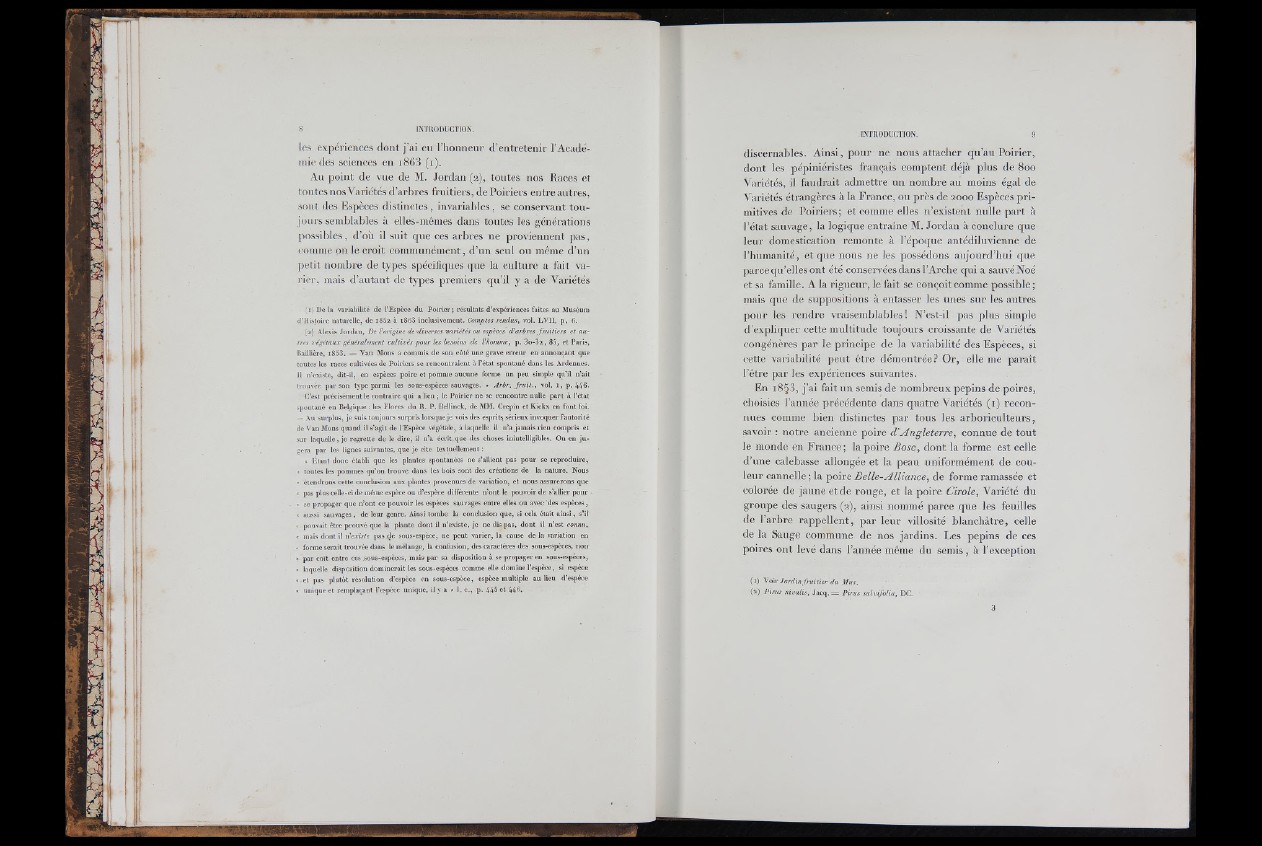
Il i
I f
¡1
8 INTRODUCTION.
les expériences dont j ’ai eu riionneur d’entretenir l’Aeadé-
inie des sciences en i 863 (i).
Au point de vue de àl. Jordan (2), toutes nos Races et
toutes nos V’ariétés d’arbres fruitiers, de Poiriers entre autres,
sont des Espèces distinctes , invariables , se conservant toujours
seinlilables à elles-mêmes dans toutes les générations
possibles, d’oîi il suit que ces arbres ne proviennent pas,
comme on le croit communément, d’un seul ou même d’un
petit nombre de types spécifujues que la culture a fait varier,
mais d’autant de types premiers qu’il y a de Variétés
a ) D e la v a ria b ilité d e l’E sp è c e d u P o i r i e r ; r é s u lta ts d ’e x p é rieo c e s faites a u M u s é um
d 'H is to ir e n a tu re lle , d e i8 5 a à i8 6 3 in c lu s iv em e n t, Comptes rendus, v o l. L V I I , p . 6 .
; 2) Alex is J o r d a n , De Porigine de'diverses variétés ou espèces d'arbres fru itie r s ct autres
végétaux généralement cultivés p ou r les besoins de Ihomme, p . 3 o - 3 2 , 8 5 , e t P a r is ,
Ba iilière, i8 5 3 . — V a n M o u s a c om m is d e so n c ô té u n e g rav e e r r e u r e n a n n o n ç a n t q u e
to u te s les r a c e s c u ltiv é e s d e P o ir ie r s se r e n c o n tr a ie n t à l’é ta t s p o n ta n é d a n s les A rd e n iie s .
I l n ’e x is te , d it- il, en e sp èc es p o ir e e t p om m e a u c u n e fo rm e u n p e u sim p le q u ’il n ’a it
tro u v é e p a r so n ty p e p a rm i les so u s -e sp è c e s sa u v ag e s . » Ârbr. f r u i t ., v o l. i , p . 4 4 6 .
C ’e s t p r é c is ém e n t le c o n tra ir e q u i a lie u ; le P o i r i e r n e s e r e n c o n t r e n u lle p a r t à l’é ta t
s p o n ta n é en Be lg iq u e : les F lo re s d u R . P . B e llin ck , d e MM. C re p iii e t K ic k x e n fo n t foi.
— , \ u su rp lu s , je su is to u jo u r s s u r p r i s lo i’sq u e j e v o is d e s e sp rit^ sé rieu x in v o q u e r l’a u to r i té
d e A'an M o n s q u a n d il s’a g it d e l'E sp è c e v ég éta le, à laq u elle il n ’a jam a is r ie n c om p ris e t
s u r la q u e ll e , je r e g r e tte d e le d ir e , il n ’a é c r it q u e d e s c h o s e s in in te llig ib le s . O n en j u g
e ra p a r le s lig n e s su iv a n te s , q u e j e c ite te x tu e llem e n t:
.1 É ta n t d o n c é tab li q u e les p la n te s sp o n ta n é e s n e s’a llie n t p a s p o u r s e r e p r o d u ir e ,
■t to u te s les p om m e s q u ’o n tro u v e d a n s les b o is s o n t d e s c ré a tio n s d e la n a tu r e . N o u s
c é te n d r o n s c e tte c o n c lu s io n a u x p la n te s p ro v e n u e s d e v a ria tio n , e t n o u s a s su re ro n s q u e
( p a s p lu s c e lle -c i d e m êm e e sp èc e o u d ’e sp èc e d if f é r e n te n ’o n t le p o u v o ir d e s’a llie r p o u r
>. s e p ro p a g e r q u e n ’o n t c e p o u v o ir le s e sp èc es sau v ag e s e n tre elles o u av ec d e s e s p è c e s ,
au ssi s a u v a g e s , d e le u r g e n re . Ainsi tom b e la c o n c lu s io n q u e , si c ela é ta it a in s i , s’il
r p o u v a it ê tr e p r o u v é q u e la p la n te d o n t il n ’e x is te , je n e d is p a s , d o n t il n ’e s t co « /n i,
- m a is d o n t il iPexiste p a s d e so u s -e sp è c e , n e p e u t v a r ie r , la c au s e d e la v a ria tio n en
.. fo rm e s e ra it tro u v é e d a n s le m é lan g e , la c o n fu s io n , d e s c a r a c tè r e s d e s so u s -e sp è c e s , n o n
• p a r c o ït e n tr e ces so u s -e sp è c e s , m a i» p a r sa d isp o s itio n à se p ro p a g e r e n so u s-esp èc es,
• laq u elle d is p o s itio n d om in e r a it les so u s -e sp è c e s c om m e e lle d om in e l’e sp è c e , si e spèce
• e t p a s p lu tô t r é so lu tio n d ’e sp èc e e n s o u s - e s p è c e , e sp èc e m u ltip le a u lie u d ’e spèce
. u n iq u e e t r em p la ç a n t l’e sp èc e u n iq u e , il y a I. c . , p . 4 4 ^ e t 4 4 6 .
discernaliles. Ainsi, pour ne nous attacher qu’au Poirier,
dont les pépiniéristes français comptent déjà plus de 800
Variétés, il faudrait admettre un nombre au moins égal de
N’ariétés étrangères à la France, ou près de 2000 Espèces primitives
de Poiriers; et comme elles n’existent nulle part à
l'état sauvage, la logique entraîne AI. Jordan à conclure que
leur domestication remonte à l’époque antédiluvienne de
l’humanité, et que nous ne les possédons aujourd’hui que
parce qu’elles ont été conservées dans l ’Arche qui a sauvé Noé
et sa famille. A la rigueur, le fait se conçoit comme possible ;
mais que de suppositions à entasser les unes sur les autres
pour les rendre vraisemblables! N’est-il pas plus simple
d ’expliquer cette multitude toujours croissante de Variétés
congénères par le principe de la variabilité des Espèces, si
cette variabilité peut être d ém o n tré eO r , elle me paraît
l’être par les expériences suivantes.
En 1853, j ’ai fait un semis de nombreux pépins de poires,
choisies l ’année précédente dans quatre Variétés (i) reconnues
comme bien distinctes par tous les arboriculteurs,
savoir : notre ancienne poire d’Angleterre, connue de tout
le monde en France; la poire Bosc, dont la forme est celle
d’une calebasse allongée et la peau uniformément de couleur
cannelle ; la poire Belle-Alliance, de forme ramassée et
colorée de jaune et de rouge, et la poire Cirole, Variété du
groupe des saugers (2), ainsi nommé parce que les feuilles
de l’arbre rappellent, par leur villosité blanchâtre, celle
de la Sauge commune de nos jardins. Les pépins de ces
poires ont levé dans l ’année même du semis, à l ’exception
(1 ) \'e>\v Jardin f r u it ie r du Mus.
( 2) Piru s nivalis, J a c q . = P iru s sa lv ifo lia , DG.