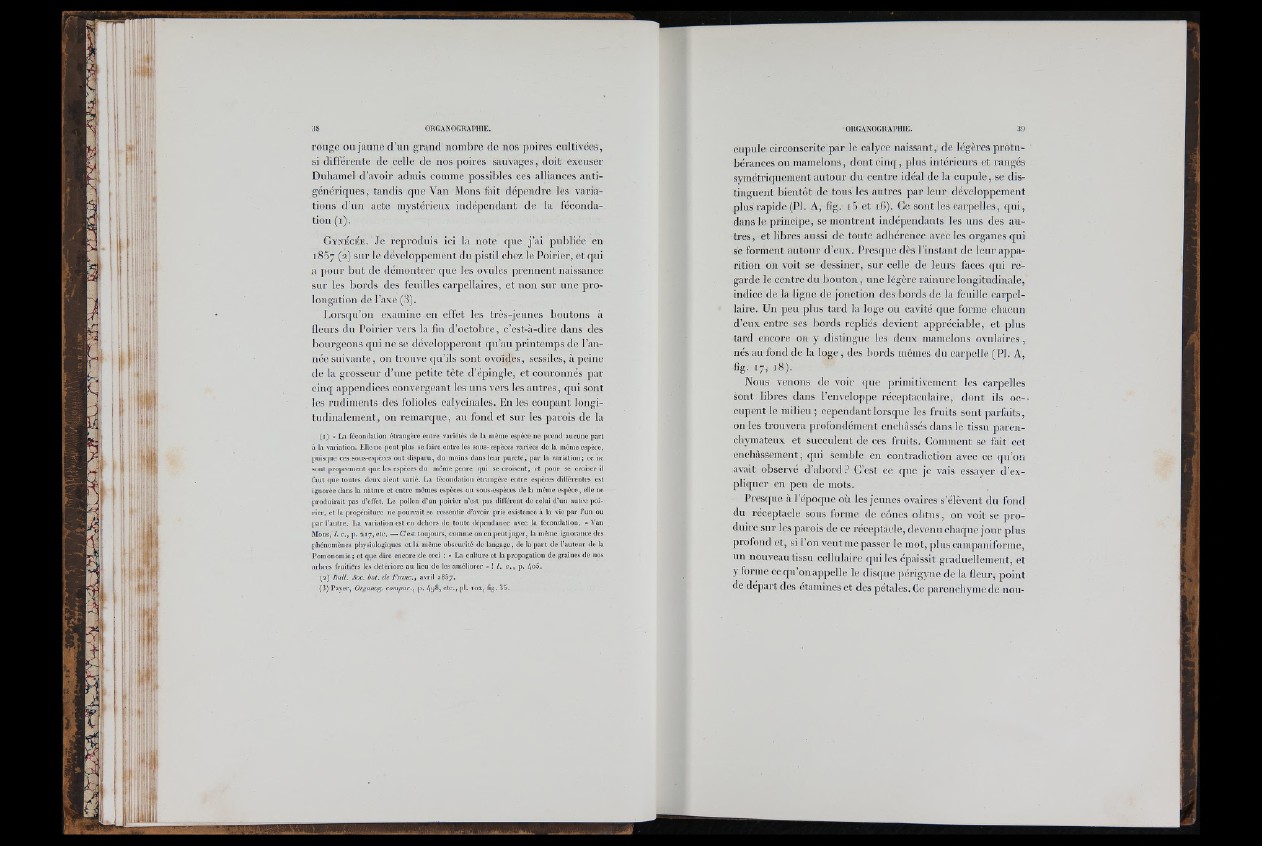
. ' 1 1 ! ''i 111
Il ■ l'i'i
rouge ou jaune d'un grand nombre de nos poires cultivées,
si différente de celle de nos poires sauvages, doit excuser
Duhamel d’avoir admis comme possililes ces alliances anti-
génériques, tandis que Van BIoiis fait dépendre les variations
d’un acte mystérieux indépendant de la fécondation
( i ).
G y n é c é e , .le re p ro d u is ic i la n o te q u e j ’a i p u l ilié e en
1807 (a) su r le d é v e lo p p em en t d u p is til ch e z le P o ir ie r , e t f[ui
a p o u r b u t do ilém o u t r e r q u e les o v u le s p r en n en t naissance
su r le s l)o rd s des fe u ille s c a rp e lla ir e s , e t n o n s u r u n e p r o lo
n g a tio n d e l ’a x e (3).
Lorsc|u’on examine.en effet les très-jeunes boutons à
fleurs du Poirier vers la lin d ’octolire, c ’est-à-dire dans des
bourgeons qui ne se développeront qu’au printemps de l ’année
suivante, 011 trouve qu’ils sont ovoïdes, sessiles, à peine
de la grosseur d’une petite tête d’épingle, et couronnés par
cinq appendices convergeant les uns vers les antres, qui sont
les rudiments des folioles cah cinales. En les coupant longitudinalement,
on remarque, au fond et sur les parois de la
(1 ) » La f é c o n d a tio n é tra n g è r e e n tr e v a rié té s d e la m êm e e sp èc e n e p r e n d a u c u n e p a r t
à la v a ria tio n . E lle n e p e u t p lu s s c fa ire e n tre les s o u s -e s p è c e s v a rié e s d e la m êm e e spèce,
p u is (|u c ces so u s-esp èc es o n t tl i s p a r u , d u m o in s d a n s le u r p u r e t é , p a r la v a r ia tio n ; ce ne
so n t p ro p rem e n t (pie les e sp èc es d u m êm e g e n re tju i se c ro is e n t, e t p o u r s e c ro is e r il
fa u t c|uc to u te s lie u x a ie n t v a rié . L a fé c o n d a tio n é ti’a n g è r c e n tre e sp èc es d iffé re n te s e st
ig n o ré e d a n s la n a tu r e e t e n tr e m êm e s e sp èc es o n so n s-csp èc cs d e la m êm e e sp è c e , e lle ne
p r o d u i r a i t p a s d ’e ffe t. Iæ p o lle n d ’u n p o ir ie r n ’e s t p a s d if f é r e n t d e c elu i d ’u n a u tr e p o ir
ie r , c l la p r o g é n itu re n e p o u r r a it s e re s s e n tir d ’a v o ir p r is e x is te n c e à la vie p a r l’u n o u
p a r l’a u tr e . L a v a ria tio n e s t en d e h o rs d e to u te d é p e n d a n c e av ec la fé c o n d a tio n . » V an
M o n s , l. c ., p . 2 1 7 , e tc . — C’e s t to u jo u r s , c om m e o n en p e u t ju g e r , la m êm e ig n o ra n c e d e s
p lic n om è n c s p h y s io lo g iq u e s e t la m êm e o b s c u ri té d e la n g a g e , d e la p a r t d e l’a u te u r d e la
P om o n om ie ; c t q u e d ir e e n co re d e c eci ; « L a c u ltu r e e t la p ro p a g a tio n d e g ra in e s d e nos
a rl)re s f ru i tie r s le s d é té r io r e a u lieu d e les am é lio re r » ! / . c . , p . 4 o 5 .
(2 ) Bull. Soc. bol. f/e F ran c., a v ril 18 5 7.
(3 ) P a y e r, Organog. compnr., p . 4 y 8 , e tc ., p l. 102, fig. 35 .
cupule circonscrite pur le calyce naissant, de légères protubérances
ou mamelons, dont c in q , pins intérieurs ct rangés
symétriquement autour du centre idéal de la cupule, se distinguent
liientüt de tons les antres par leur développement
plus rapide (Pl. A, fig. i 5 et ifi). Ce sont les carpelles, qui,
dans le principe, se montrent indépendants les uns des antres,
et libres aussi de toute adhérence avec les organes qui
se forment autour d’eux. Presque dès l ’instant de leur apparition
on voit se dessiner, sur celle de leurs faces (jiil regarde
le centre du bouton, une légère rainure longitudinale,
indice de la ligne de jonction des bords de la feuille carpol-
laire. Un peu plus tard la loge on cavité que forme cliacuu
d’eux entre ses bords repliés devient apprécialfle, et plus
tard encore on y distingue les deux mamelons ovnlaires ,
nés an fond de la loge , des liords mêmes du carpelle (Pl. A,
fig. 1 7 , 18).
Nous venons de voir que primitivement les carpelles
sont libres dans l ’enveloppe rêeeptaenlaire, dont ils oc--
cnpent le milieu ; cependant lorsque les fruits sont parfaits,
on les trouvera profondément enchâssés dans le tissu paren-
chymatenx et succulent de ces fruits. Comment se fait cet
enchâssement, qui semble en contradiction avec ce ([u’on
avait observé d’aljord ? C ’est ce (¡ne je vais essayer d ’ex-
pli(jner en peu de mots.
Presque à l’épo([ue où les jeunes ovaires s’élèvent du fond
(lu réceptacle sons forme de cônes obtus, on voit se produire
sur les parois de ce réceptacle, devenu chaque jour plus
profond et, si l’on vent me passer le mot, plus campaniforme,
un nouveau tissu cellulaire qui les épaissit graduellement, et
y forme ceqn’onappelle le disque périgyne de la fleur, point
de départ des étamines et des pétales. Ce parenchyme de non