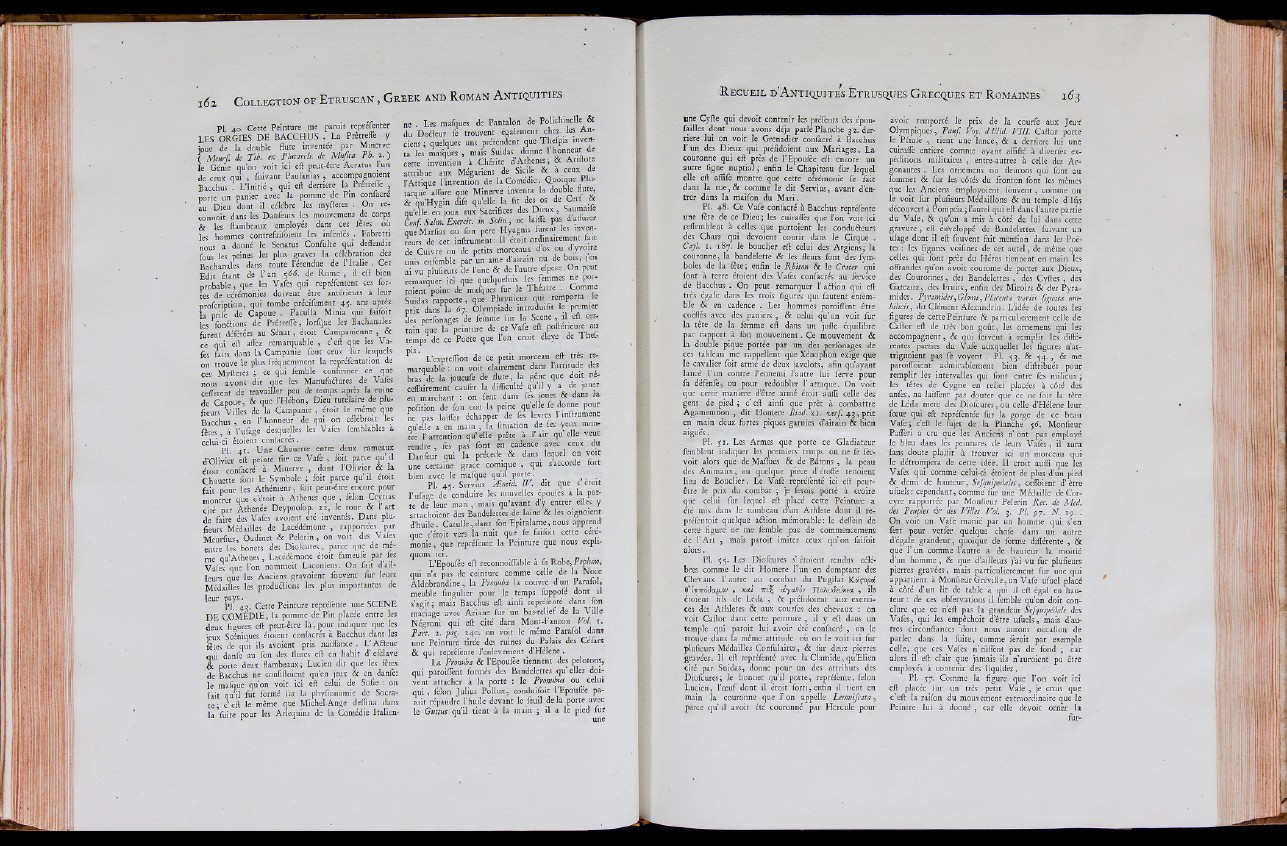
l i
I!
PI 40. Cette Peinture me paroit repréfenter
l e s o r g i e s d e B A C C H U S . L a PrècrelTe y
ioue de la double fiute inventée par Minerve
( Meurf. de Ttb. ex Plutarch, de Mujica P h . 2. )
le Génie qu’on v oit ici eft peut-être Acratus 1 un
de ceux qui , fuivant Paufanias , accompagnoient
Bacchus . L ’Initié , qui eft derrière la Prêcreflè ,
porte un panier avec la pomme de Pm confacré
au Dieu dont il célébré les myfteres . On reconnoit
dans les Danfeurs les mouvemens de corps
& les flambeaux employés dans ces ietes où
les hommes contrefaiibient les infcnfés . Fabretti
nous a donné le Senatus Confulté qui deffendit
fous les peines les plus graves la célébration des
Bachanales dans toute l’étendue de l’ Italie . Cet
E dit étant de l’ an <,66. de Rome , il eft bien
probable, que les Vafes qui repréfentent ces fortes
de cérémonies doivent être antérieurs à leur
proicription, qui tombe précifément 45. ans après
la prife de Capoue . Paculla Minia qui faiiôit
les fonaions de PrètreiTe, lorfq^ae les Bachanales
furent déférées au S é n a t, étoit Campanienne , &
ce qui eft alfez remarquable , c’ eft que les V a fes
faits dans la Campanie font ceux fur lesquels
on trouve le plus fréquemment la repréfentation de
ces Myfteres ; ce qui femble confirmer ce que
nous avons dit que les Manufadures de Vaiès
celferent de travailler peu de temps après la ruine
de C apoue, & que l’H cb on , Dieu rutdaire de plufieurs
V ille s de la Campanie , étoit le ^ même que
Bacchus , en l’ honneur de qui on célébroit les
ic t e s , à l’ ufage desquelles les Vafes femblables à
celui-ci étoient confacrés.
Pi
I CUJllet'.lW .
Une Chouette entre deux rameaux
d’Olivier eft peinte fur ce Vafe , foit parce qu’ il
¿toit confiicré à Minerve , dont 1 Olivier & la
Chouette font le Symbole ; fo it parce qu il eroit
fa it pour les Ath én ien s , foit peut-être encore pour
montrer que c’étolr à Athènes que , félon Cryrias
cité par Arhenée Deypnofop. 22, le tour & l’ art
de faire des Vafes avoient été inventés. Dans plufieurs
Médailles de Lacédémone , rapportées par
Meurfius, Oudlnet & P e le r in , on volt des Vafes
entre les bonets des Diofcures, parce que de meme
qu’Ath en es , Lacédémone étoit fameufe par fos
Vafes que l’on nommoit Laconiens. On fa it d'ailleurs
que les Anciens gravoient fouvent fur leurs
Médailles les produélions les plus importantes de
l e .
, Cette Peinture repréfente une SC E N E
d e C O M E D IE ; la pomme de Pin placée entre les
deux figures eft peut-être là ,f)o u r indiquer que les
jeux Scéniques étoient confacrés à Bacchus dans les
fêtes de qui ils avoient pris naiflance . L’ A f le u r
qui danfe au fon des flutes eft en habit d’ efclave
& porte deux flambeaux; Lucien dit que les fêtes
de Bacchus ne confiftoîent qu’en jeux & en danfe:
le mafque qu’on voit ici eft celui de Sofie : on
fait qu’il fut formé fur la phyfionomie de Socrate
; c’ eft le même que Michel-Ange deflîna dans
la fuite pour les Arlequins de la Comédie Italienne
. Les mafques de Pantalon de Polichinelle 5c
du Dofleur iè trouvent également chez, les A n ciens
; quelques uns prétendent que Thefpis inventa
les mafques , mais Suidas donne 1 honneur de
cette invention à Chérite d’Athenes; & Ariftote
attribue aux Mégariens de Sicile & a ceux de
l’Atrique l’invention de la Comédie. Quoique Plutarque
aflùre que Minerve inventa la double flute,
& qu’H y gin dife qu’elle la fit des os de Cerf «
quelle en joua aux Sacrifices des D ie u x , Saumaile
Conf. Salm. Exercit. in So lin , ne laifle pas d aflurer
que Marfias ou fon pere Hyagnis furent les inventeurs
de cet inftrument: I l étoit ordinairement fait
de C u iv re ou de petits morceaux d’os ou d y v o ire
unis enfemble par un ame d’airain ou de bois; jen
ai vu plufieurs de l’une & de fautre efpece-On peut
remarquer ici que quelquefois les femmes ne por-
roicnt point de mafques fur le Theatre . Comme
Suidas rappo rte, que Phrynicus qui remporta le
prix dans la 67. Olympiade introduifit le premier
des perfonages de femme fur la Scene , ü eft certain
que la peinture de ce Va fe eft po fte rieur au
temps de ce Poète que l’on croit eleye de Thel-
L expreffion de ce petit morceau eil_ très remarquable:
on v oit clairement dans 1 attitude des
bras de la joueufe de flute, la gêne que doit ne-
ceflairement caufer la difficulté q u il y a de jouer
en marchant : on fent dans fes joues & dans la
pofition de fon cou la peine qu’elle fe donne pour
ne pas laiflèr échapper de fes levres 1 inftrument
qu e lle a en main ; la fituation de_ fes yeux montre
l’ attention q u e lle prête à l’ air qu’ elle veut
rendre , fes pas font en cadence avec ceux du
Danfeur qui la precede & dans lequel on v o it
une certaine grace comique , qui s’accorde fort
bien avec le mafque qu’il porte .
Pl. 4S. Servius lE . dit que c croit
l’ ufage de conduire les nouvelles époufes à la porte
de leur m a r i, mais qu’ avant d’y entrer elles y
attachoient des Bandelettes de laine & les oignoient
d’h u ile . C a tu lle , dans fon Epitalame, nous apprend
que c’étoit vers la nuit que le faifoit cette cérémonie
, que repréfente la Peinture que nous expli-
quons ic i.
L ’Epoufée eft reconnoiffiable à {a.'R.ohs,Péplum,
qui n’a pas de ceinture comme celle de la No ce
Aldob randine, la Pronuba la couvre d’un Parafol,
meuble fingulier pour le temps fuppofe dont il
s’a g i r ; mais Bacchus eft ainfi repréienté dans fon
mariage avec Ariane fur un bas-relief de la V ille
Négroni qui eft cité dans Mont-Faucon Vol. i .
Part. 2. pag. 240. on voit le même Parafol dans
une Peinture tirée des ruines du Palais des Cefars
& qui repréfente l’enlevement d’H é len e .
L a Pronuba & l’Epoufée tiennent des pelotons,
qui paroiffent formés des Bandelettes qu’ elles doiven
t attacher à la porte : le Pronubus ou celui
q u i , ièîon Julius P o llu x , conduifoit l ’Epoufce paroit
répandre l’huile devant le fcuil de la porte avec
le Guttus qu’il tient à la main ; il a le pied fur
une
une C yfte qui devoit contenir les préfents des cpou-
failles dont nous avons déjà parlé Planche 3 2. derrière
r:
lui on voit le Grenadier confacré à Bacchus
r un des Dieux qui préfidoient aux M a r ia g e s . L a
couronne qui eft près de l’ Epoufee eft encore un
autre figne nuptial ; enfin le Chapiteau fur lequel
elle eft affife montre que cette cérémonie fe fait
dans la r u e ,& comme le dit Servius, avant d’entrer
dans la maifon du M a r i.
Pl. 48. C e Vafe confacré à Bacchus repréfente
une fête de ce D ieu ; les cuiraflès que l’on v oit ici
rcflembleiit à celles que portoient les condufteurs
des Chars qui devoient courir dans le Cirque .
Cayl. I . 187 . le bouclier eft celui des Argiens; la
couronne, la bandelette & les fleurs font des fym-
boles de la fê te; enfin le Rhiton & le Crater qui
font à terre croient des Vafes confacrés au fervice
de Bacchus . On peut remarquer l’ aèlion qui eft
très égale dans les trois figures qui fautent enièm-
ble 5c en cadence . Les hommes paroiffent être
coëffes avec des paniers , 5c celui qu’ on v oit fur
la tête de la femme eft dans un jufte équilibre
l a r rapport à fon mouvement. Ce mouvement &
a double pique portée par un des perfonages de
ces tableau me rappellent que Xénophon exige que
le cavalier foir arme de deux javelots, afin qu’ayant
lancé l’ un contre l’ ennemi l’autre lui ferve pour
fa défenfe, ou pour redoubler l ’ attaque. On v oit
que cette maniere d’être armé étoit auffi celle des
gens de pied ; c eft ainfi que prêt à combattre
Agamemnon , dit Homere lliad. x i . ve-rf. 4 3 , prit
en main deux fortes piques garnies d’airain & bien
aiguë s .
Pl. 5 1 . Les Armes que porte ce Gladiateur
femblent indiquer les premiers temps: on ne fe ferv
o it alors que de Maflùes ôc de Bâtons , la peau
des A n im a u x , ou quelque piece d’ étoffe tenoient
lieu de B ou c lie r . Le Vafe repréfenté ici eft peut-
être le prix du combat ; je forois porté à croire
que celui fur lequel eft placé cette Peinture a
été mis dans le tombeau d’un Ath lete dont il re-
préièntoit quelque aêlion mémorable: le deffein de
cette figure ne me lèmble pas de commenccmens
de l’ A r t , mais paroit imiter ceux qu’ on faifoit
a lo rs .
Pl. 55. Les Diofcures s’ étoient rendus célébrés
comme le dit Homere i ’ un en domptant des
Chevaux f autre au combat du P ugilat Karop«
e’ /inroci’oyxoi' , x a i ttu^ oty«0ôi' TToXucTsuxe« , ils
étoient fils de Léda , 5c préfidoient aux exercices
des Athletes 5c aux courfes des chevaux : on
voit Caftor d<ans cette peinture, i l y eft dans un
temple qui paroit lui avoir été confacré , on le
trouve dans la même attitude où on le v oit ici fur
plufieurs Médailles Coniùlaires, 5c fur deux pierres
gravées. Il eft repréfenté avec la Clamide, qu’Eüen
cité par Suidas, donne pour un des attributs des
Diofcures; le bonner qu’il porte, repréfente, fclon
Lu cien, l’oe u f dont il étoit fo r ti, enfin il tient en
main la couronne que l’ on appelle Lemnifcata,
parce qu’ il avoit été couronné par Hercule pour
avoir remporté le prix de la courfe aux Jeux
Olympiques, Voy. dElid. V I ll. Caftor porte
le Petafè , tient une lance, Ôc a derrière lui une
cuiraffe entiere comme ayant affifté à diverfes expéditions
militaires , entre-autres à celle des A r gonautes
. Les ornemens ou fleurons qui font au
ibmmet 5c fur les côtés du fronton font les mêmes
que les Anciens employoient fo u v en t, comme on
le v o it fur plufieurs Médaillons 5c au temple d’ Ifis
découvert à P ompeïa;l’autel qui eft dans l ’autre partie
du V a fe , ôc qu’on a mis à côté de lui dans cette
g ra v u re , eft enveloppé de Bandelettes fuivant un
ufage dont il eft fouvent fait mention dans les Poètes
: les figures voifines de cet au te l, de même que
celles qui font près du Héros tiennent en main les
offrandes qu’on a v o it coutume de porter aux Dieux,
des Couronnes, des Bandelettes , des Cyftes , des
G a teaux , des Fru its, enfin des Miroirs ôc des Pyramides.
Pyramides,GlomiyPlace-nta va-rtis fignata um-
bilicis, dit Clément Alexandrin. L ’idée de toutes les
figures de cette Peinture 5c particulièrement celle de
Caftor eft de très bon g o û t , les ornemens qui les
accompagnent, & qui fervent à remplir les différentes
parties du Va fe auxquelles les figures n’at-
trignoient pas fe voyent . Pl. 53. 5c 54. , 5c me
paroiflbient admirablement bien diftribués pour
remplir les intervalles qui font entre fes milieux ;
les têtes de Cygne en relie f placées à côté des
anfès, na laiiTent pas douter que ce ne foit la tête
de Léda mere des Diofcures, ou celle d’Hélene leur
foeur qui eft repréfentée fur la gorge de ce beau
V a f e ; c’eft le fujet de la Planche 56. Monfieur
PafTeri a cru que les Anciens n’ ont pas employé
le bleu dans les peintures de leurs V a f e s , il aura
fans doute plaifir à trouver ici un morceau qui
le détrompera de cette idée. I l croit auffi que les
Vaiès qui comme celui-ci étoient de plus d’un pied
5c demi de hauteur, Sefquipedales, ceflbient d’ être
ufuels: cependant, comme for une Médaille de Cor-
cyre rapportée par Monfieur Pelerin Rec. de Med.
des Peuples &" des Villes Vol. 3. P L p y . N. ip . .
O n v o it un Vafe manié par un homme qui s’ en
fert pour verfer quelque chofe dans un autre
d’égale grandeur, quoique de forme différente , 5c
que r un comme l’autre a de hauteur la moitié
d’un homme , 5c que d’ailleurs j’aî vu fur plufieurs
pierres g rav ée s , mais particulièrement for une qui
appartient à Monfieur G ré ville , un Va fe ufuel placé
à côté d’ un lit de table à qui il eft égal en hauteur
: de ces obfervations il femble qu’on doit conclure
que ce n’eft pas la grandeur Sefquipédale des
V a fe s , qui les empêchoit d’être u fu els , mais d’autres
circonftances dont nous aurons occafion de
parler dans la fuite, comme feroit par exemple
c e lle , que ces Vafes n’ eûflènt pas de fond ; car
alors il eft clair que jamais ils n’aurolent pu être
employés à contenir des liqu ide s .
Pl. 57. Comme la figure que l ’ on v oit ici
eft placée for un très petit Vafe , je crois que
c’ eft la raifon du mouvement extraordinaire que le
Peintre lui à donné , car elle devoir orner la
fur-
I
ii
J '
, m
lifPii
ilirP
iïll