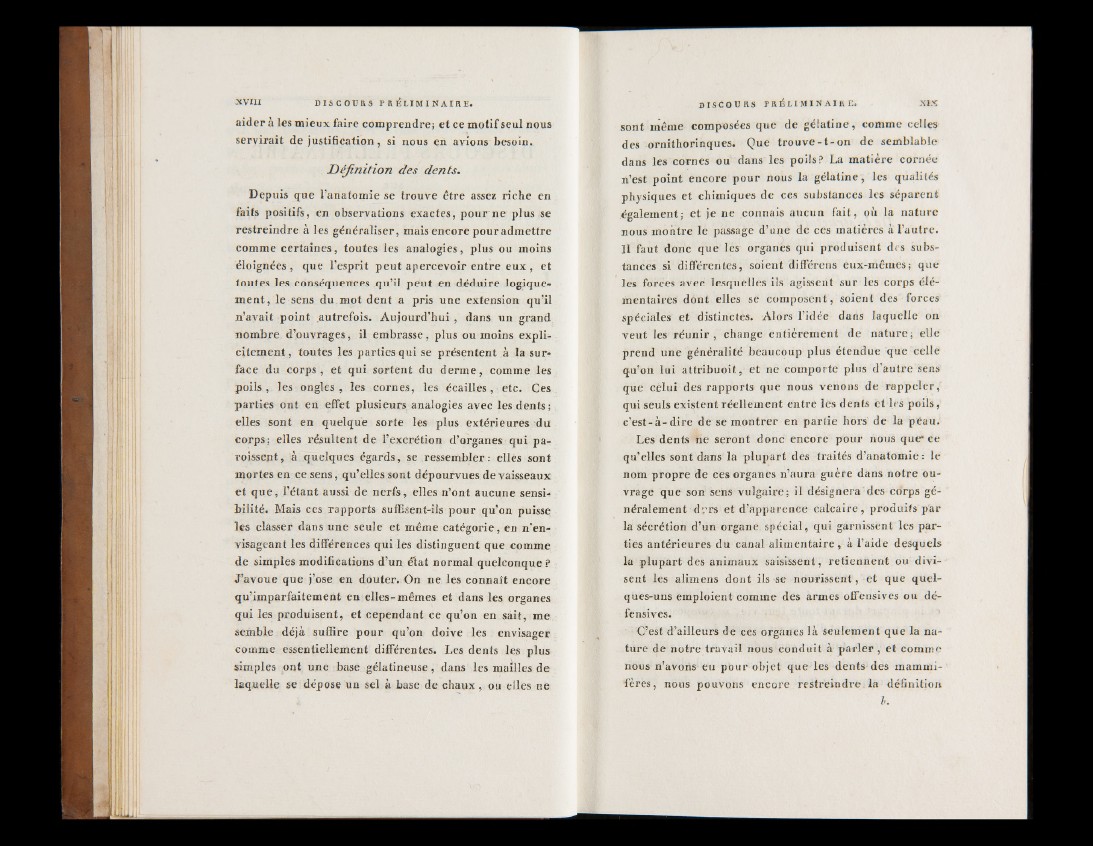
aider à les mieux faire comprendre; et ce motif seul nous
servirait de justification, si nous en avions besoin.
Définition des dents.
Depuis que l’anatomie se trouve être assez riche en
faits positifs, en observations exactes, pour ne plus se
restreindre à les généraliser, mais encore pour admettre
comme certaines, toutes les analogies, plus ou moins
éloignées , que l’esprit peut apercevoir entre eux , et
toutes les conséquences qu’il peut en déduire logiquement,
le sens du mot dent a pris une extension qu’il
n’avait point autrefois. Aujourd’hui , dans un grand
nombre d’ouvrages, il embrasse, plus ou moins explicitement,
toutes les parties qui se présentent à la surface
du corps, et qui sortent du derme, comme les
poils, les ongles, les cornes, les écailles, etc. Ges
parties ont en effet plusieurs analogies avec les dents;
elles sont en quelque sorte les plus extérieures du
corps; elles résultent de l’excrétion d’organes qui pa-
roissent, à quelques égards, se ressembler: elles sont
mortes en ce sens, qu’elles sont dépourvues de vaisseaux
et que, l’étant aussi de nerfs, elles n’ont aucune sensibilité.
Mais ces rapports suffisent-ils pour qu’on puisse
les classer dans une seule et même catégorie, en n’envisageant
les différences qui les distinguent que comme
de simples modifications d’un état normal quelconque ?
J’avoue que j’ose en douter. On ne les connaît encore
qu’imparfaitement en elles-mêmes et dans les organes
qui les produisent, et cependant ce qu’on en sait, me
semble déjà suffire pour qu’on doive les envisager
comme essentiellement différentes. Les dents les plus
simples ont une base gélatineuse, dans les mailles de
laquelle se dépose un sel à base de chaux, ou elles ne
sont même composées que de gélatine, comme celles
des ornithorinques. Que trouve-t-on de semblable
dans les cornes ou dans les poils? La matière cornée
n’est point encore pour nous la gélatine, les qualités
physiques et chimiques de ces substances les séparent
également; et je ne connais aucun fait, où la nature
nous montre le passage d’upe de ces matières à l’autre.
Il faut donc que les organes qui produisent des substances
si différentes, soient différens eux-mêmes; que
les forces avec lesquelles ils agissent sur les corps élémentaires
dont elles se composent, soient des forces
spéciales et distinctes. Alors l’idée dans laquelle on
veut les réunir, change entièrement de nature; elle
prend une généralité beaucoup plus étendue que celle
qu’on lui attribuoit, et ne comporte plus d’autre sens
que celui des rapports que nous venons de rappeler,
qui seuls existent réellement entre les dents et les poils,
c’est-à-dire de se montrer en partie hors de la peau.
Les dents ne seront donc encore pour nous que* ce
qu’elles sont dans la plupart des traités d’anatomie : le
nom propre de Ces organes n’aura guère dans notre ouvrage
que son sens vulgaire; il désignera des corps généralement
dvrs et d’apparence calcaire, produits par
la sécrétion d’un organe spécial, qui garnissent les parties
antérieures du canal alimentaire, à l’aide desquels
la plupart des animaux saisissent, retiennent ou divisent
les alimens dont ils se nourissent, et que quelques
uns emploient comme des armes offensives ou défensives.
C’est d’ailleurs de ces organes là seulement que la nature
de notre travail nous conduit à parler , et comme
nous n’avons eu pour objet que les dents des mammifères,
nous pouvons encore restreindre la définition
h