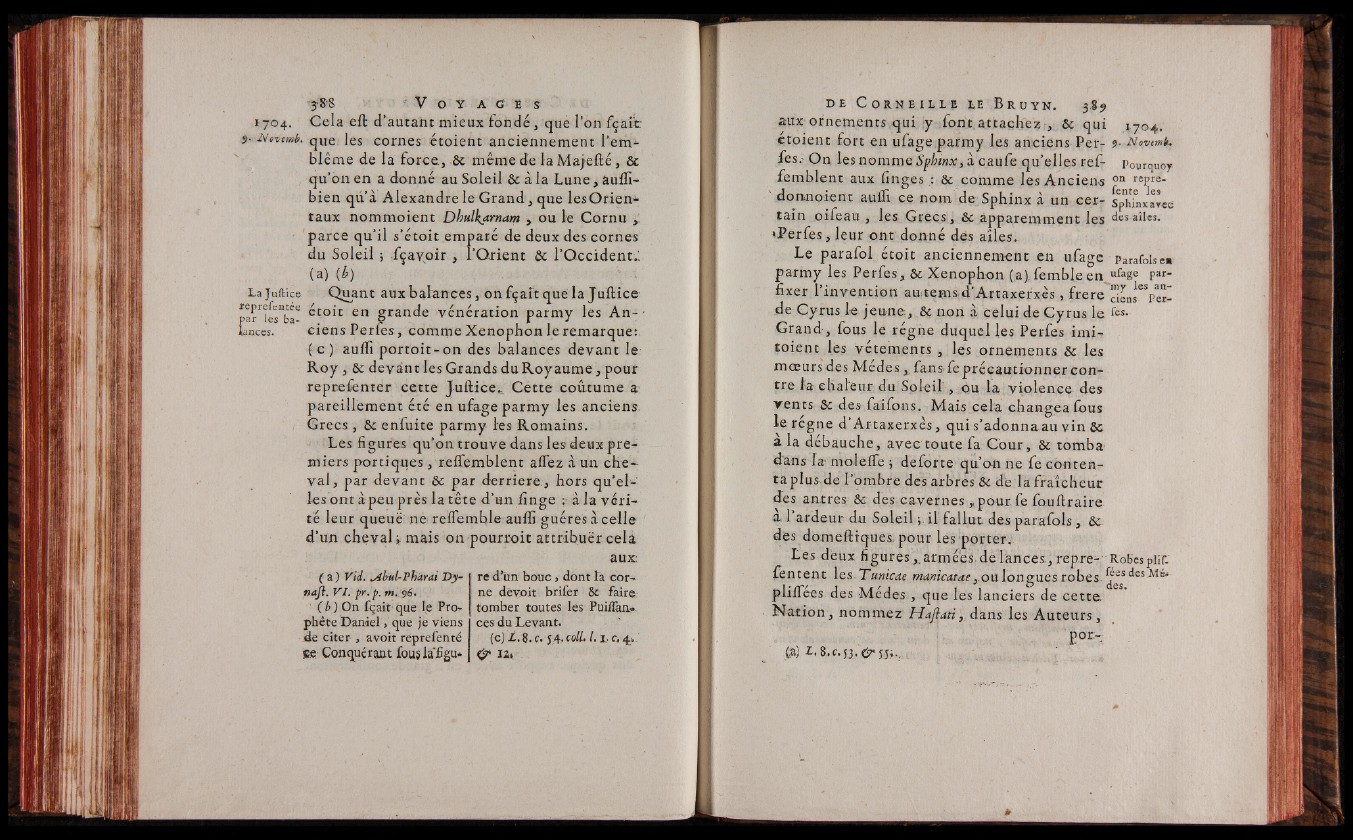
y&S V o y a g e s
1704. C e l a eft d’autant m ieux f o n d é , que l ’on fçait:
$. Novemb. nUe les cornes é toient an c iennement l ’em-
blême de la f o r c e , & même de la Ma j e f t é , &
qu’on en a donné au Solei l & à la Lune , auflï-
bien qu’à Ale x and r e le G r a n d , que les Or i e n taux
n ommo ien t Dhulkarnam > ou le Co rn u ÿ
parc e qu’ il s’étoi t emparé de deux des cornes
du Solei l ; f ç a vp i r , l ’Or i e n t & l 'Oc c ident«
(a) m
La juftice Qu a n t aux b a la n c e s , on fçai t que la Juf t ice
par^es^r ^ ° i c en g rande v éné ra t ion p a rmy les A n - -
lances. c i e n sP e r f e s , c omme Xe n o p h o n le remarque:
( c ) auiïi p o r t o i t - o n des balances de v an t le
R o y , Sc d e v an t les Grands du R o y a um e , pour
repte fente r c e t te Juf t ice« C e t t e coutume a
p a r e i l lement été en ufage p a rmy les anciens,
G r e c s , & enfui te p a rmy les Roma ins .
Les figures qu’on t rouv e dans les deux pre miers
por t iques , r.eiTemblent aifez à un c h e v
a l , par de v ant & par de r r i è r e , hors qu’e l les
ont à peu près l a tête d ’un f inge ;• à la v é r i té
leur queue ne rei femble auiïï guéres à cel le
d ’un c h e v a l * mais on pour roi t at t r ibuer ce la
aux:
( a ) Vid. ^ibul-Pharai Dy- re d’un bouc j dont ta cor-
naji. VI. pr.p. m. 96. ne devoit brifer 8c faire:
(b) On fçait que le Pro- tomber toutes les Puiiîàn*
phête Daniel t que je viens ces du Levant,
de citer , avoit reprefènté (c) 8. f . 54. coll. L 1 c, 4 .
se Conquérant fous ia'ügu- 124,
d e C o r n e i l l e le B r u y n . 38?
aux ornements qui y font a t ta che z , & qui 1704.
e toient fort en ufage p a rmy les anciens Per- 9■ Novtmb,
Les. On les nomme Sphinx, à caufe q u ’elles ref- Pourquoj
femblent aux f i n g e s & comme les A n c i en s on repre-
donno ient aufli ce nom de Sphinx à un c er - Sphînx^rcc
ta-in oi feau , les Grecs , & apparemment les des-aîles.
vPer fes , leur ont donné des aîles..
Le parafol étoi t anc i enn emen t en ufage Parfois em
pa rmy les Pe r fe s , & Xeno p h on (a ) . f emb le en.ufa8e Par*
f ixer l ’in v e n t io n au tems d ’A r tax e rx è s , f r e r e ^ J cspae" '
de Cy rus le j e u n e , & non à celui de C y rus le &*•
G r a n d , fous le r é gne duquel les Perfes imi -
toient les v ê t ement s , les ornement s & les
moeurs des M ede s x fans»feprécaut ionner contre
la chaleur du Solei l , ou la v io l e n c e des
v ent s & des faifons. Mais c e la c h an g e a fous
l e r e g n e d’Ar t a x e r x è s , q u i s ’a d on n a a u v in Sc
a la débauche , a v e c toute fa C o u r , & tomba
dans Ta mole ife ; defor te qu’on ne fe c o nt enta
plus de l ’ombre des arbres &c de la f ra îcheur
des antres & des cav e rne s „pour. fe fouf traire
a l ardeur du Sole i l ; il fallut des p a ra fo l s , &
des domeftiques. pour les porter.
Les deux f igur e s ,. armées , de lan c e s , repre - ' Robes pi;r.
f ent ent les. Tunicae mamcatae, .oulongues robes ^ esdesM&i
pliifees des Médes», que les lanciers de cette.
N a t i o n , nomme z Hajla ti, dans les A u t e u r s ,
por ta)
L, 8.c. 33. & 53,..