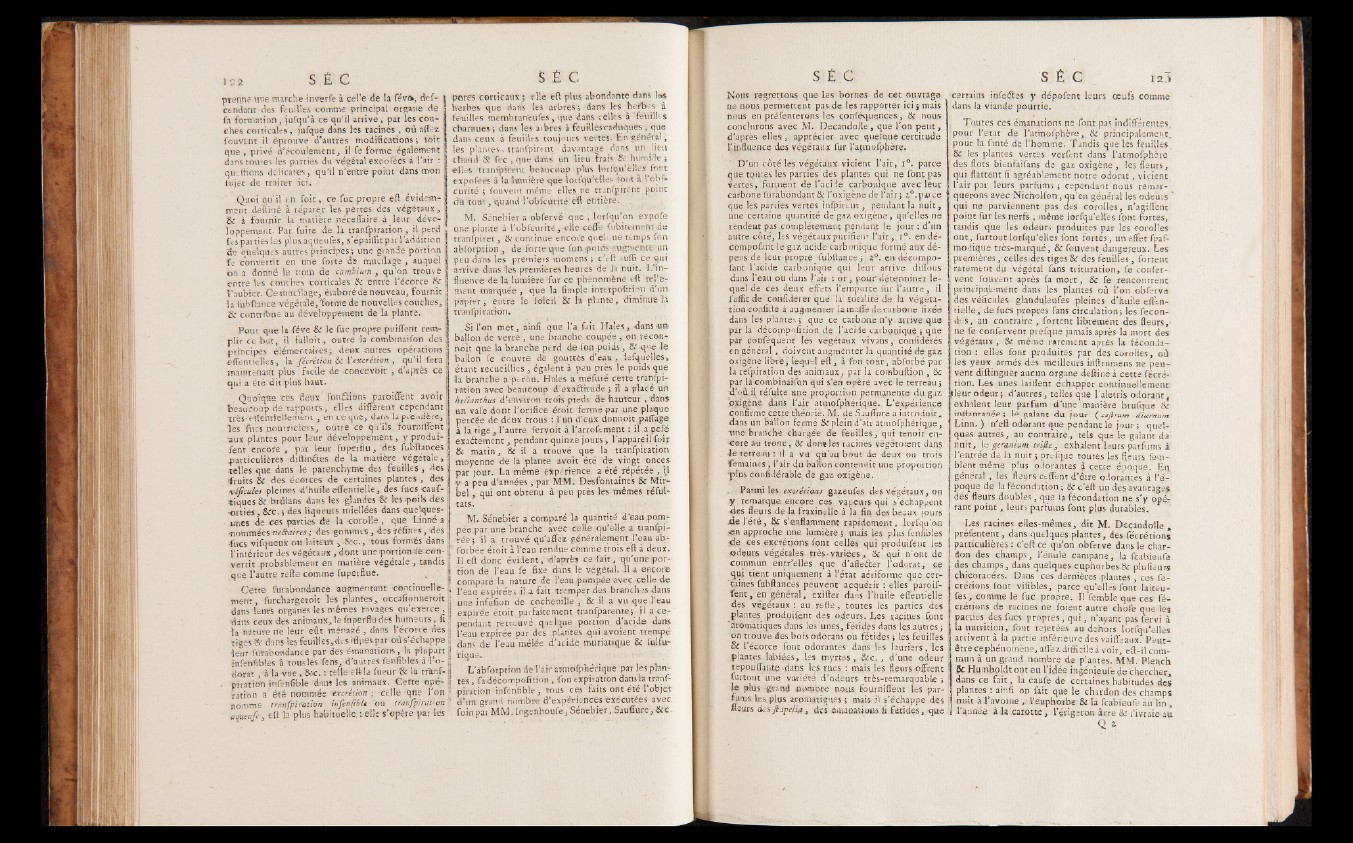
1 2.2 S É C S É C
prenne une marche inverfe à celle de la févP, def- |
tendant des fouilles tomme principal organe de |
fa formation,, jufqu’à ce qu'il arrive, par les cou- |
thés corticales, jufque dans les racines , où affez |
fou-vent il éprouve d'autres modifications; fort
que , privé d'écoulement, il fe forme également
dans toutes les parties du végétal expo fées à 1’àir :
qUcftioRS délicates, qu'il n'entre point dans mon
(ujet de traiter ici.
Quoi qu’il foit, ce fuc propre eft évidemment
-defiiné à réparer les pertes des végétaux,
& à fournir la matière néceffaire,4 leur développement.
Par fuite de la transi ration, il perd
fcs parties les plusaqüeufes, s’épaiffit par l ’addition
de quelques autres principes; une grande portion
fe convertit en Une forte de rquciïage, auquel
on a donné le trôm de cùmbiurn , qu'on trouvé
entre les côtrcites corticales & entre l’écorce 8c
l'aubier. Cemacïlàge, élaboréde nouveau, fournit
la fubfhnce végétale, forme de nouvelles couches,
& contribue au développement de la plante.
pores corticaux ; elle eft plus abondante dans loi
herbes que dans les arbres, dans les herbes à
feuilles membraneufes, que dans.'celles à feùilks
charnues ; dans les arbres à fèuilleS'cadu-ques, que
dans ceux à feuilles toujours ver-tfeS-. En •général •
les plantes^ tranfpirent davantage dans un lieu
•chaud & fec , que da¥vs un lieu trais & humide;
elles tranfpirent beaucoup plus îorfqu’elles font
expofées a la lumière que iorfqu'eUes font à l’hb-fc
curité ; fouvent même eltes.ne tranfpirent point
d% tout, quand ro'bfcuntétft entière.
M. Sinebier a obfervé que , lorfqu’on expofe
une plante à l’oblcurité, elle celle fubi terne Fit de
tranfpirer, & continue encore quelque temps fon
abfôrpt-ion , de forte que fon poids augmente ;ùn
peu dans les premiers momens ; c’eft auffi ce qui
-arrivé dans les premières heures de la nuit. L'Influence
de la lumière for ce phénomène eft tellement
marquée, que la (impie intetpofitinri d’un
papier; entre le folèil & h plante, diminue Là
tranfpiration.
Pour que la -fève & le fuc propre puiffem rem- ]
plir ce but,, il falloir, Outre la combinaifon des j
.principes élémentaires,; deux autres -opérations-
effentielks-, la fée ré tien & l'excrétion , qu il fera |
maintenant plus facile de concevoir , d'après ce |
qui a été dit plus haut.
Qooiqtre tes deux fondions paroiffent avoir j
beaucoup de 'rapports, ellès difFèrën't cependant;
très-'efferïtiellemeru , en ce que, dans la première, |
les fucs nouvriciérs, outre ce qu'ils, foürniffent j
-aux pla'ntes pour leur développement, y produi-j
fent encore , par leur fuperfiti, des fubftancësi
particulières diftin&es de la matière végétale,.!
telles que dans le parenchyme des feuilles, des?
fruits & des écorces de certaines plantes , des ;
•véficuies pleines d’ huile effentielle, des fucs cauf- j
tiques & brùlans dans les glandes & les -poils des j
-orties, & c .; des liqueurs miellées dans quelques- j
unes de ces parties de la corolle , que Linné a j
•nommées neftàtres; des-gommes , des ''refînes, des j
fucs vifq-ueux ou laiteux -, &c. , tous formés dans j
l ’intérieur des végétaux , dont une portion fe fou- u
vertit .probablement en matière végétale , tandis |
que l’autre refte comme fuperftue. , |
Cette furabondance augmentant continuelle-
men't, Turchargeroit les plantes, occasionneroit |
danslërrrfc organes les mêmes ravages qu'exerce , |
dans ceux des animaux*le fùperflu des humeurs, fi |
}a nature rte leur eût ménagé, dans l’écorce des j
tiges*8? dans les feuilles,des rfftrés par ods’échappe il
leur furabondance par des ém-anations , la plupart j
infeWfibles à tous les fens, d'auires fenfi-bîes à T-o- |
dorât , à la -Vue, -&c.celle efila fueur 8c la tr'anf- J
piratibn infettfibte dans les animaux. Cette opé-1
ration a été nommée ‘excrétion; -celle que l’on j
nomme tranfpif-ittidn infenfibU où tranfpiravon .!
nqueufe , eft la plus habituelle. elle s’opère par tes
.Si l’on met, ainfi que l’a fait Haïes, dans-un
ballon de verre , une branche coupée, on recon-
noît que la branche perd de fon poids, & que le
ballon fe couvre dè gouttes d’eau , iefquelles»
étant recueillies, égalent à peu près le poids que
la branche aperâù. Haies a méfiiré ‘cette trafifpi-
ration avec beaucoup d'exactitude ; fl a placé un
kdianthus d’efMîron trois pieds de hauteur , dans
un vafe dont l’orifice droit fermé par une plaque
percée de deux trous *. l’un d’eux donnoit paffage
à là t i g e l ’autre fervoit à l’arrofoment ; il a pefé
exactement, pendant quinze jours % l ’appareil foip
& matin, & il a trouvé que la tran'fpiration
moyenne de la plante avoir été de vingt onces,
par jour. La même expérience a été répétée , il
y• a peu d’années, -par MM; Dés-fontaines & Mir-
bel , qui ont obtenu à peu près les mêmes rëfrfl-
tats.
M. Sénebier a comparé la quantité d’eau .pompée
.par une branche avec celle qu’elle a tranfpi-
tée; il a trouvé qu’ affez généralement l ’eau ab-
forbée écoit à l’eau rendue comme trois eft à deux.
Il eft donc évident, d ’après ce fait , qu’une portion
de l’eau fe fixe dans le vqgétal. Il -a encore
comparé'la nature de l’eau pompée avec celle de
l’eau expirée; il a fait tremper des branches dans
une infûfion de cochenille , & il a vu que l’eau
expirée étoit parfaitement transparente; il a cependant
retrouvé quelque portion d acide dans
Peau expirée par des plantes qui a voient trempé
dans de beau mêlée d’acide muriatique & Culfu-
fique. .
L’abforption deTair atmofphérique par les plantes
, fa décompofition, fon expiration damlatranf-
piration inTeniïble, tous ces faits ont été l’objet
d’un grand nombre d’expériences exécutées avec
foin par MM. Ingenhoufe, Sénebier, Sauflfure, &.C.
s i c 12 Jf
Nous regrettons que les bornes de cet ouvrage
ne nous permettent pas de les rapporter ic i} mais j
nous en préfenterons le,s çonféquences, 6( nous
conclurons avec M. Decandolle, que l’on peut,
d’après elles, apprécier avec quelque certitude
l’influepce des végétaux fur l’a|mofphère.
D’un côté les végétaux vicient l’air, i°. parce
que tçut.es les parties des plantes qui ne font pas
vertes, forment de l’acide carbonique avec leur
carbone fiir'ahondant & l’oxigènè de l’air ; z°.parce
que les parties vertes înfpiruit, pendant la nuit,
une certaine quantité de gazoxigène , qu’elles ne
rendent pas .complètement pendant le jour: d’un
autre côté, les végétaux purifient l’air, i°. endé-
Cpmpofan't le gaz acide Carbonique formé aux dépens
de leur.-:propre fubft.a^cç ; 2P. en déeompo-
fant l'acide carbonique qui leur arrive difibus
dans l’eau ou dans l’air- : or, potierdémrmin^r lequel
de ces deux effets l’emporte fur l’autre , il
fttffit de' coéfî\iérei que là totalité de la végétation
confifte à augmenter la malfe de,carbo>ne fixée
dans les plantes; que ce carbone rr’ y arrive que
par la décompofition d§ J’acide carbonique i qùe
par conféquen-t les végétaux vivans, confîderés
en général, doivent augmenter la quantité de gaz
oxigène libre, lequel eft, à fon tour, abforbé par
la refpiration des animaux^ par la combuftion , &
par là combinaifan qui s’en opère avec le terreau ;
d/où ü réfuite une proportion permanente du gaz
îpxlgène dan$ l’air atmofphérique. L’expé,rience
confirme çet;e théprjè. M* de Sauffure a introduit,
dans un ballon fermé & plein d’air atmofphérique,
•une branché chargée dé feuiïles, qui tenoic encore
a-u tronc, &r dont les racines végétotent dan?
Je terreau : il a vu qu’au bout de deux ou trois
•femaitics ; l’air du ballon eontenèit une proportion
'plus confidérable de gaz oxigène.
. Parmi les excrétions gazeufes des végétaux, on
y , remarque encore c^ vapeurs qui s'échappent
des deuts de la fraxindle à la fin des beaux jours
^e l’été, Os s’enflamment rapidement, icvrfqu’on
approche une lumière; mais les plus fenfibles
de ces excrétions font celles qui produifent les
odeurs végétales trè.s-variées., & qui • n’opt de
commun en.tr’elles que d’affeâer l’odorat, ce
qui tient uniquement à l’état aériforme que çer-
'taines fubftances peuvent acquérir : elles parpif-
ïent, en général, exifter dans l’huile effentielle
des végétaux : au refte, toutes les parties des
plantes produisent des odeurs. Les racines font
'aromatiques dans les unes, fétides dans les autres.;
on ttoiive des bois odorans pu fétides ; les feuilles
& l’écorce font odorantes dans les lauriers, les
..plantes labiées, les my.rt.es, & c ,, d’une odeur
repouffante'dans les rues.: mais les fleurs offrent
furtout une variété d’odeurs très-remarquable ;
le plus grand fH>mbïe nous foUrniffent les parfums
ljes.pl:u$ arom-auques ; mais il s’échappe des
fleurs <ks fiapelia3 des énumiiom fi fétides, que
S Ê C
certains infeétes y dépofent leurs oeufs comme
dans la viande pourrie.
. Toutes ces émanations ne font pas indifférentes,
pour l’état de l’ar'mofphère., & principalement,
pour la finté de l’homme. Tandis que les feuilles,
& les plantes vertes verfent dans ratmofphèrô
des flots bienfaifans de gazoxigène, les fleurs,
qui flattent fi agréablement notre odorat, vicient
l’air par leurs parfums ; cependant nous remarquerons
avec Nicholfon, qu'en général les odeurs
qui ne parviennent pas des corolles, n’agiffent
point fur les nerfs , même lorfqu’elfes font fortes,
tandis que les odeurs produites par les corolles
ont, furtout lorsqu'elles font fortes, un effet fpaf-
modique très-marqué, & fouvent dangereux. Les
premières, celles des tiges & des feuilles, fortent
’ rarement du végétal fans trituration, fe confer-
j vene fouvent après fa mort, & fe rencontrent
. principalement dans les plantes où l’on ob&rye
j des véficuies. gianduleufes pleines d'huile eifon-
( rielle, de fucs p r^ c s fans circulation; les fecon-
- des, au contraire , fortent librement des fleurs,
j ne fe confer vent prefque jamais après la mort des 5 végétaux , & même rarement après la féeonda-
i tion : elles font produites'par des corolles, où
; les yeux armés des meilleurs inftrumens ne peu-
’ vent diftinguer aucun organe deftinë à cette, féeré^;
tion. Les unes laident échapper eommuollement
lleur odeur; d’autres, telles que Laletns odorant.
exhalent leur parfum d’une manière hrufque &
inftantanée; le galant du jour ( cejirum diurnum
Linn. ) n’eft odorant que pendant le jour ; quel*
ques autres, ail contraire, tels que le galant de
nuit, le géranium trifie, exhalentléurs parfums à
l ’entrée do la nuit ; prefque toutes les fleurs fem-
blent même plus odorantes à çette époque. Eq,
général , les fleurs çdfent d’ètre odorantes à l’époque
de la fécondation ; 8c c ’eft un des avantages
dés fleurs doubles, que ia fécondation ne s’y opé?
rant point, leurs parfums font plus durables.
Les racines elles-mêmes, dit M. Decandolle,
préfentent, dans quelques plantes, des fécrétions
; particulières : c’eft ce qu’on obferve dans le char-
■ don des champs, i’énule campanela feabieufe.
des champs, dans quelques euphorbes & plufieurs
çhicoracées. Dans ces dernières plantes , ces fécrétions
font vifibles, parce qu’elles font laiteu-
fes , comme le fuc propre. Il Temble que ces fé-
erétiotis de racines ne foient autre chofe que les
parties des fucs propres, qui, n’ayant pas fervi à
la nutrition, font rejetées au dehors lorfqu*elles
arrivent à la partie inférieure des vaiffeaux. Peut-
être cephénomène, allez difficile à voir, eft-il commun
à un grand nombre de plantes. MM. Plench
& Humhpldtont eu l’idée ingénieufe de chercher,
dans ce fait, la caufe de certaines habitudes des
plan tes ƒ ainfi on fait que le chardon des champs
nuit à l’avoine ,- l’euphorbe & la feabieufe àu lin,
l auaée à la carotte, l’értgeron âcre & l’ivraie au.
Q i