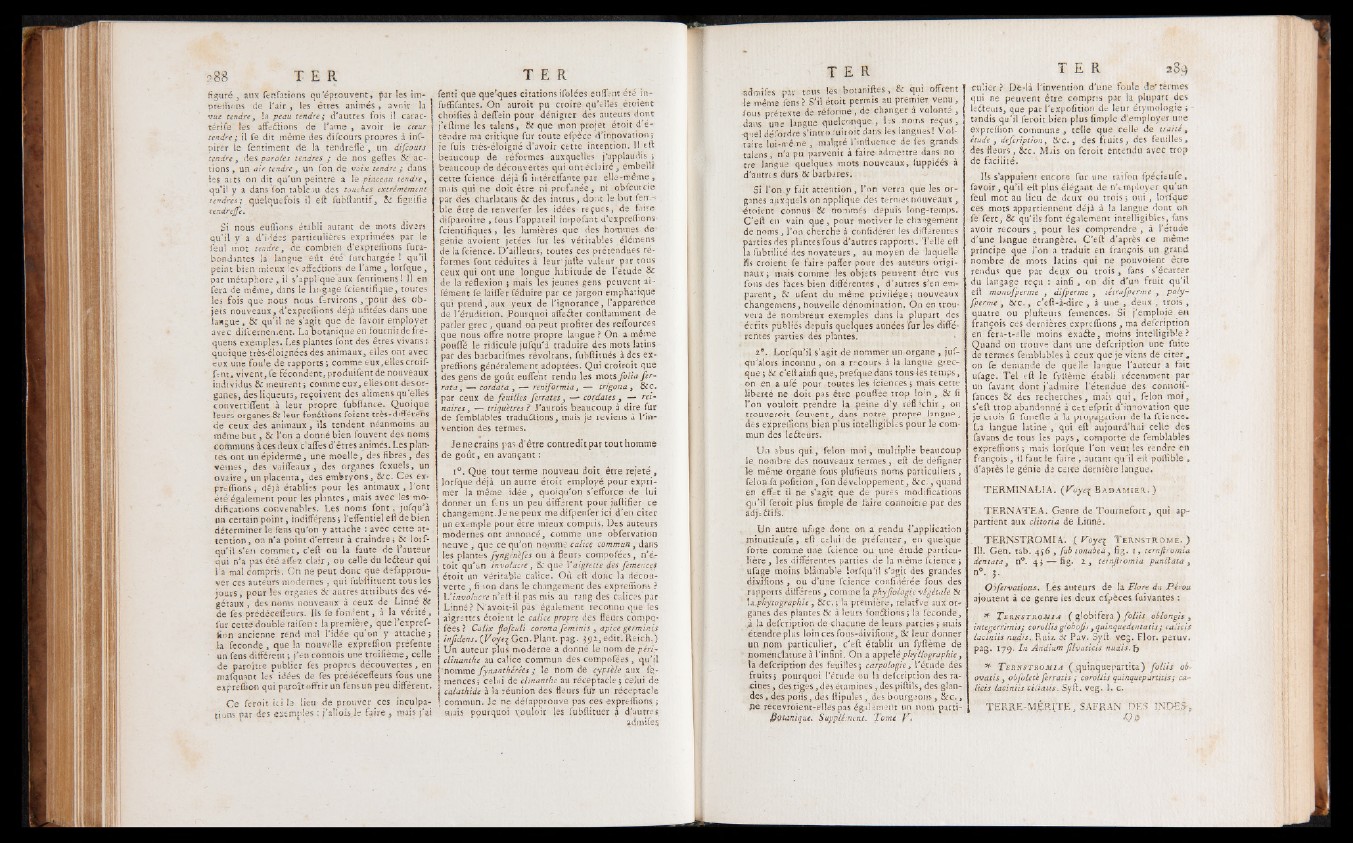
figuré j aux fe niât ions qu’éprouvent, par les im-
preüions de l’a ir , les êtres animés , avoir la
vue tendre 3 la peau tendre; d’autres fois il car acté
ri fe les affections de l’ame , avoir le coeur
tendre; il fe dit même des difcours propres à inf-
pirer le fentiment de la tendrefle un difcours
tendre , des paroles tendres ; de nos geftes & actions
, un air tendre , un fon de voix tendre ; dans
les aits on dit qu’un peintre a le pinceau tendre s
qu’ il y a dans Ton tableau des touches extrêmement
tendres ; quelquefois il eft fubftantif, & lignifie
tendrejfe.
$i nous euflions établi autant de mors divers
qu’ il y a d’idées particulières exprimées par le
feul mot tendre, de combien d’exprelîions fura-
bondantes la langue eût été'' furchargée ! qu’il
peint bien mieux les affrétions de famé , lorfque,
par métaphore , il s’applique aux fentimens! 11 en
fera de même, dans le langage fcientifiqùe, toutes
les fois que nous nous farvirons, pour des objets
nouveaux, d’expreflions déjà ufitées dans une
langue, & qu’il ne s’agit que de favoir employer
ayec dilcernement. La botanique en fournit de fré-
quens exemples. Les plantes font des êtres vivans r
quoique très-éloignées des animaux, elles ont avec
eux une foule de rapports ; comme eux,elles croif-
(Vnt, vivent, fe fécondent, produifent de nouveaux
individus & meurent; comme eux, elles ont desorganes,
des liqueurs, reçoivent des alimens qu’elles
convertiffent à leur propre fubftance. Quoique
leurs organes.& leur fonctions foient très-différens
de ceux des animaux, ils tendent néanmoins au
même but, & l’on a donné bien fouvent des noms
communs à ces deux c!affes d’êtres animés. Les plantes
ont un épiderme, une moelle, des fibres, des
veines, des vailfeaux, des organes fexuels, un
ovaire, un placenta, des embryons, & c. Ces ex-
prcffions, déjà établies pour les animaux , l’ont
été également pour les plantes, mais avec les modifications
convenables. Les noms font, jufqu’à
u» certain point, indifféjrens; l’effentiel efl de bien
déterminer le fens qu’on y attache : avec cette attention,
on n’a point d’èrreur à craindre; & loif-
qu’ il s’en commet, c’eft ou la faute de Fauteur
qui n’a pas été affez clair, ou celle du leéteur qui
l à mal compris. Cn ne peut donc que défapprou-
ver ces auteurs modernes , qui fubftituent tous les
jours, pour les organes & autres attributs des végétaux
, des noms nouveaux à ceux de Linné &
de fes prédéceffeurs. Ils fe fondent, à la vérité,
fur cette double raifon : la première, que l’expref-
feon ancienne rend mal l’idée qu’on y attache j
la fécondé, que la nouvelle e x or e filon préfente
un fens différent ; j’en connois une troifième, celle
de paroître publier fes propres découvertes, en
mafquant les idées de fes prédéceffeurs fous une
expreffion qui paroît offrir un fens un peu différent.
Ce feroit ici le lieu de prouver ces inculpations
par des exemples : j’aljois.k > fai
fenti que que-ques citations ifolées enflent été in-
fuffifantes. On auroit pu croire qu’eiîes étoienc
choifies à deffein pour dénigrer des auteurs dont
j’eflime les talens, & que mon projet étoit d’étendre
ma critique fur toute efpèce d’inpovation;
je fuis très-éloigrié d’avoir cette intention. 11 eft
beaucoup de réformes auxquelles j'applaudis ;
beaucoup de découvertes qui ont éclairé, embelli
cette fcience déjà fi intérelfante par elle-même ,
mais qui ne doit être ni profanée, ni obfcurcie
par des charlatans & des intrus, dont le but ferr.-.
ble être de renverfer les idées reçues, de faire
difparoître , fous l’appareil impofant d’uxpreffionS'
feientifiques, les lumières que des hommes de
génie avoient jetées fur les véritables élémens 3e lafcience. D’ailleurs, toutes ces prétendues réformes
font réduites à leur'jufte valeur par tous
ceux qui ont une longue habitude de l’étude &
de la réflexion ; mais les jeunes gens peuvent ai-
fément fe laiffer féduire par ce jargon emphatique
qui prend, aux yeux de l’ignorance, l’apparence
de ler.udicion. Pourquoi affeéter conftatnment de
parler grec , quand on peut profiter des reffources
que nous offre notre propre langue? On a même
pouffé le ridicule jufqu’à traduire des mots latins
par des barbarifmes révoltans, fubftitués à des ex-
preflions généralement adoptées. Qui croiroit que
des gens de goût euffent rendu les mots folia fer-
ratas —* cordât a , — reniformia, — trigona , &c.
| par ceux de feuilles ferrâtes , —- cordâtes , — reinaires,
— triquetres? J’aurois beaucoup à dire fur
de femblables traductions, mais je reviens à l’invention
des termes.
Je ne crains pas d’être contredit par tout homme
de goût, en avançant :
i°. Que tout terme nouveau doit être rejeté,
lorfque déjà un autre étoit employé pour exprimer
la même idée , quoiqu’on s’efforce de lui
donner un fens un peu différent pour juftifier ce
changement. Je ne peux me difpenfer ici d’en citer
un exemple pour être mieux compris, Des auteurs
modernes ont annoncé, comme une obfervation
neuve , que ce qu’on nomme calicç commun 3 dans
les plantes fyngénèfes ou à fleurs compofées, n’ér
toit qu’un involucre, & que l’ aigrette des femeneçs
étojt un véritable calice. Où elt donc la découverte
, fi ion dans le changement des expreffions ?
L‘involucre n’eft-il pas mis au rang des calices par
Linné? N'avoit-il pas- également reconnu que les
! aigrettes étoient le calice propre des fleurs compo-
j fées ? Calix flofculi corona feminis , apice germinis
j inpdens. (Voye%Gen.Plant, pag. 392,edit. Reich.)
j Un auteur plus moderne a donné le nom de péri-
| clinanthe au calice commun des compofées, qu’ il
rnomrne fynanthérées ; le nom de çypsêle aux fe.-
{ mences; celui de clinanthe au réceptacle; celui de
j calathide à la réunion des fleurs fifr un réceptacle
] commun. Je ne défapprouve pas ces expreflions ;
mais pourquoi vouloir les fubftituer à d’autres
îtdmifes
admifes par tous les botaniftes, & qui offrent
le même fens? S’il étoit permis au premier venu,
fous prétexte de réforme , de changer à volonté ,
dans une langue quelconque, Ls noms reçus,
quel défordre s’intro fuîroit dans les langues! Voltaire
lui-même , malgré l’influence de fes grands
talens, n’a pu parvenir à faire admettre dans no
tre langue quelques mots nouveaux, fuppléés à
d’autres durs 6c barbares.
Si l’on.y fait attention, l’on verra que les organes
auxquels on applique des termes nouveaux,
étoient connus & nommés depuis long-temps.
C ’eft en vain que, pour motiver le changement
de noms, l’on cherche à confidérer les différentes
parties des plantes fous d’autres rapports. Telle eft
la fubtüité des novateurs , au moyen de laquelle
?ls croient fe faire paffer pour des auteurs originaux
; mais comme les objets peuvent être vus
fous des faces bien différentes , d'autres s’en emparent,
&c ufent du même privilège; nouveaux
changemens, houvelle dénomination. On en trouvera
de nombreux exemples dans la plupart des
écrits publiés depuis quelques années fur les différentes
parties des plantes.
2®. Lorfqu’il s’agit de nommer un organe , juf- ;
qu’alors inconnu , on a recours à la langue grecque;
Sc c’eft ainfi que, prefquedans tousdes temps,
on .en a ufé pour toutes les fciences; mais cette
liberté ne doit pas être pouffée trop loin , .& fi
l’on vouloit prendre la peine d’y réfléchir, on
trouveroit fouvent, dans notre propre langue,
des expreflions bien plus intelligibles pour le commun
des lecteurs.
Un abus quf, félon moi, multiplie beaucoup
le. nombre des nouveaux termes , eft de défigrier
le même organe fous plufieurs noms particuliers,
félon.fa pofition, fon développement, & c ., quand
en effet il ne s’agit que de pures modifications
qu’il feroit plus (impie de faire connoîtie par des
adjtétifs.
Un autre ufage dont on a rendu l’application
minutieufe, eft celui de préfenter, en quelque
forte comme une fcience ou- une étude particulière
, les différentes parties de la même fcience j
ufage moins blâmable lorfqu’il s’agit des grandes
divifions, ou d’une fcience confniérée fous des
rapports diffère ns, comme la phyfologie végétale 6t
Id.phytographie , &c. ; la première, relative aux organes
des plantes & à leurs fondions; la féconde,
.à la defeription de chacune de leurs parties ; mais
étendre plus loin ces fous-divifions, Sr leur donner
un nom particulier, c’eft établir un fyftème de
nomenclature à l'infini. On a appelêphyllographie3
la defeription des feuilles ; carpplogie, l’étude des
fruits; pourquoi l’étude ou la defeription des racines
, des tiges, des étamines, des piftils, des glandes
, des poiis, des ftipules, des bourgeons, & ç .,
jie recevroient-elles pas égalemertt un nom parti-
tunique, Supplément. Tome ,
eu lier ? De-là l’invention d’une foule der termes
qui ne peuvent être compris par la plupart des
lecteurs, que par l'expofition de leur étymologie ; -
tandis qu’il feroit bien plus (impie d’employer une
expreflion commune., telle que celle de traité,
étude , deferiptiony & c . , des fruits, des feuilles,
des fleurs, &c. Mais on feroit entendu avec trop
de facilité.
Ils s’appuient encore fur une raifon fpécieufe,
favoir, qu’il eft plus élégant de n’employer qu’un
feul mot au lieu de deux ou trois; oui, lorfque
ces mots appartiennent déjà à la langue dont on
fe fert, & qu’ ils font également intelligibles, fans
avoir recours, pour les comprendre, à l’étude
d’une langue étrangère. C'eft d’après ce même
principe que l’on a traduit en frar.çois un grand
nombre de mots latins qui ne pouvoient être
rendus que par deux ou trois, fans s’écarter
du langage reçu : ainfi , on dit d’un fruit qu’il
eft monofptrme , difperme , têtrafperme , poly-
fperme , 6cc . , c’eft-à-dire , à une , deux , trois ,
quatre ou plufieurs femences. Si j’emploie e«
françois ces dernières expreflions , ma defeription
en fera-t-elle moins exaéte, moins intelligible?
Quand on trouve dans une defeription une fuite
de termes femblables à ceux que je viens de citer,
on fe demande de quelle langue l’auteur a fait
ufage. Tel eft le fyltème établi récemment par
un favant dont j’admire l’étendue des connoif-
fances & des recherches, mais qui, félon moi,
s’eft trop abandonné à C c t efprît d'innovation que
je crois fi funefte à la propagation de la fcience.
La langue latine , qui eft aujourd’hui celle des
favans de tous les pays, comporte de femblables
expreflions ; mais lorfque l’on veut les rendre en
françois, il faut le faire , autant qu'il eft pollîble ,
d’après le génie de cette dernière langue.
TERMINALIA. Badamier. )
TERNATEA. Genre de Tournefort, qui appartient
aux clitoriu de Linné.
TERNSTROMIA. { Voyei T ernstrome. )
II!. Gen. tab. 456 , fuh tonabeâ, fig. 1, ternftromia.
dent ata, n°. 4; — fig. 2 , ternjtiomia punftata ,
n°. y
Qôfervaiions. Lès auteurs de la Flore du Pérou
ajoutent à ce genre les deux efpèces fuivantes :
* Ternstrowix ( globifera ) foliis oblongis ,
integerrimis; corollis globops 3 quinquedentatis; caiicis
laciniis nudis. Ruiz 6c Pav. Syft veg. Flor. peruv.
pag. 179. In Andium filvatiçis nudis.
* T ersstromia ( quinquepartita) foliis ob-
ovatis , obfolete ferratis ; corollis quinquepartitis; ca-
licis laciniïs ciliads. Syft. veg. 1, c.
TERRE-M.ÉRfTE, SAFRAN DES INDES,
-Q {?