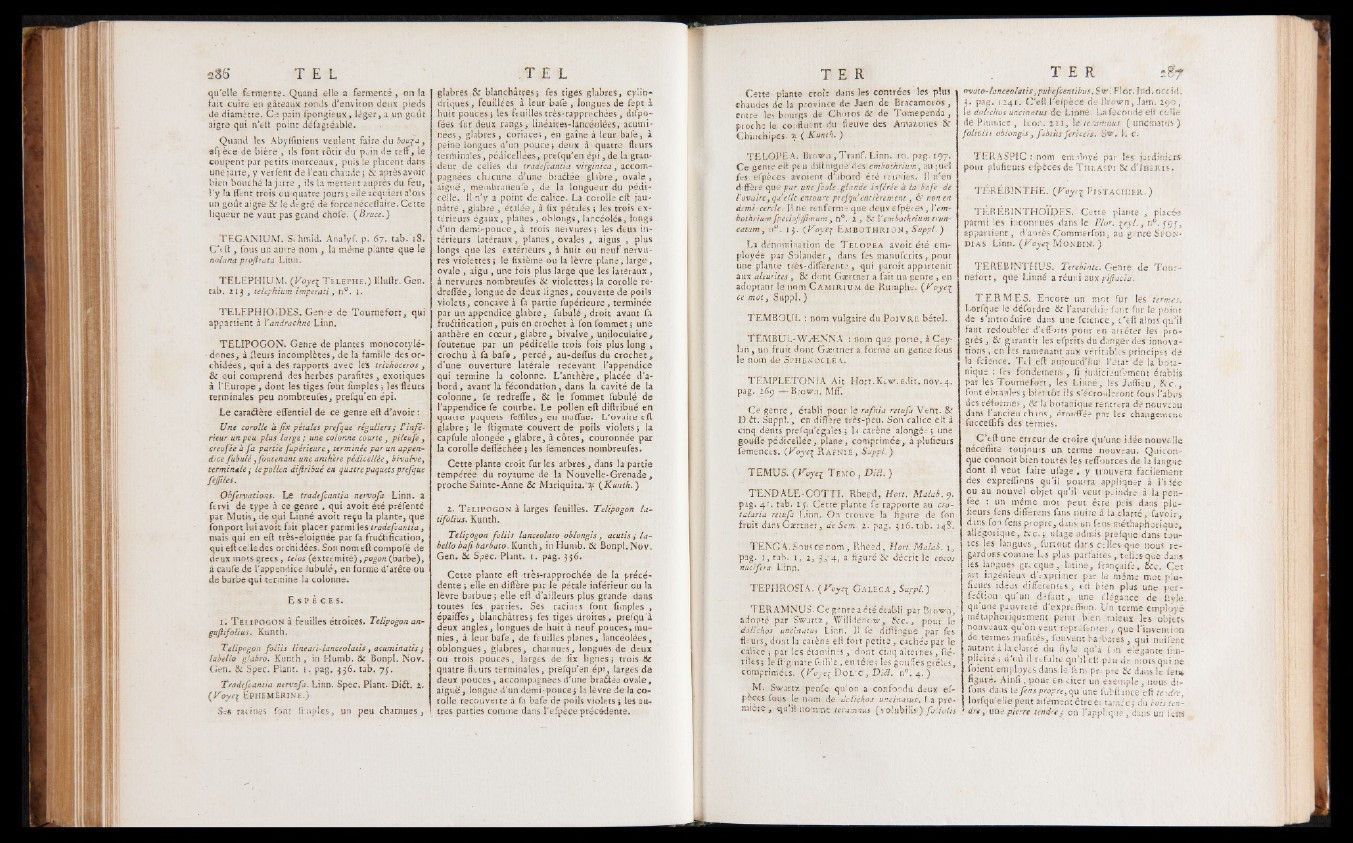
quelle fermente. Quand elle a fermenté, on la
fait cuire en gâteaux ronds d’environ deux pieds
de diamètre. Ce pain fpongieux, léger, a un goût
aigre qui n’eft point défagréable.
Quand les Abyfliniens veulent faire duSowfa,
sfpèce de bière , ils font rôtir du pain de teff, le
coupent par petits morceaux, puis le placent dans
une jarre, y verfent de l'eau chaude 5 6c après avoir
bien bouché la jarre , ils la mettent auprès du feu,
l ’y la fient trois ou quatre jours ; elle acquiert alors
un goût aigre & le degré de forcenécellaire. Cette
liqueur ne vaut pas grand choie. ( Bruce.)
TEGANIUM. Sthmid. Analyf. p. 67. tab. 18.
C't f l , fous un au ire nom , la même plante que le
nolana profirata Linn.
TELEPHIUM. ÇVoyei T élephe.) Illuftr. Gen.
tab. 213 , teUpkium imperati, n°. 1.
TELEPHIOiDES. Geme de Tourneforc, qui
appartient à Y andrachne Linn.
TELIPOGON. Genre de plantes monocotylé-
dones, à (leurs incomplètes, de la famille des orchidées,
qui a des rapports avec leis trhhoceros ,
& qui comprend des herbes parafâtes , exotiques
à l'Europe, dont les tiges font (impies ; les fleurs
Terminales peu nombreufes, prefiqu’en épi.
Le cara&ère effentiel de ce genre eft d’avoir :
Une corolle a fix pétales prefque réguliersy Vinférieur
un peu plus large ; une colonne courte , pileufe ,
çreuféea fa partie fupérieure , terminée par un appendice
fubulé 3 foutenant une anthère pédicellée, bivalve t
terminale ,• le pollen dijlribué en quatre paquets prefque
feffiles.
Qbfervations. Le tradefeantia nervofa Linn. a
fervi de type à ce genre , qui avoit été préfenté
par Mutis, de qui Linné avoit reçu la plante, que
fon port lui avoit fait placer parmi les tradefeantia,
mais qui en eft très-éloignée p.ar fa fructification,
qui eft celle des orchidées. Son nom eft compofé de
deux mots grecs, telos (extrémité) ypogon (barbe),
à caufe de l’appendice fubulé, en forme d'arête ou
de barbe qui termine la colonne.
E s p e c e s .
1. T empogon à feuilles étroites. Telipogon an-
gujlifolius. Kunth.
Telipogon foliis lineari-lançeolaiis, acuminatis j
labello glabro. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov.
Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 336. tab. 7p.
Tradefeantia nervofa. Linn. Spec. Plant. Diét. 2,.
(Voye{ EpheMÉRINE.)
Se« racines font (impies, un peu charnues,
glabres & blanchâtres} fes tiges glabres, cylindriques,
feuillées à leur bafe , longues de fept à
huit pouces} les feuilles très-rapprochées, difpo-
fées fur deux rangs, linéuires-lancéolées, acumi-
nées, glabres, coriaces, en gaine à leur bafe, à
peine longues d’ un pouce} deux à quatre fleurs
terminales, pédicellées, prefqu’en épi, de la grandeur
de celles du tradefeantia virginica, accompagnées
chacune d’une bradée glabre, ovale,
aiguë, membraneufe, de la longueur du pédi-
cêüe. 11 n’y a point de calice. La corolle eft jaunâtre
, glabre , étalée, à fix pétales ; les trois extérieurs
égaux, planes, oblongs, lancéolés, longs
d’un demi-pouce, à trois neivures; les deux intérieurs
latéraux, planes, ovales , aigus , plus
longs que les extérieurs, â huit ou neuf nervures
violettes} le fixième ou la lèvre plane, large,
ovale, aigu , une fois plus large que les latéraux,
à nervures nombreufes & violettes} la corolle re-
drertee, longue de deux lignes, couverte de poils
violets, concave à fa partie fupérieure, terminée
par un appendice glabre, fubulé, droit avant fa
fructification, puis en crochet â fon fommet} une
anthère en coeur, glabre, bivalve, uniloculaire,
foutenue par un pédicelle trois fois plus long ,
crochu à fa bafe, percé, au-deffus du crochet,
d’une ouverture latérale recevant l’appendice
qui termine la colonne. L’anthère, placée d’abord,
avant'la fécondation, dans la cavité de la
colonne, fe redrefle, & le fommet fubulé de
l’appendice fe courbe. Le pollen eft diftribué en
quatre paquets fertiles, en maflue. L’ovaire eft
glabre} le ftigmate couvert de poils violets} la
capfule alongée , glabre, à côtes, couronnée par
la corolle deflechée} les femences nombreufes.
Cette plante croît fur les arbres , dans la partie
tempérée du royaume de la Nouvelle-Grenade,
proche Sainte-Anne & Mariquita.'^ (Kunth.)
2. T elipogon à larges feuilles. Telipogon la-
tifolius. Kunth.
Telipogon foliis lanceolato oblongis, acutis y labello
bafi barbato. Kunth, in Hurnb. & Bonpl. Nov.
Gen. Spec. Plant. 1. pag. 336.
Cette plante eft très-rapprochée de la précédente
} elle en diffère par le pétale inférieur ou la
lèvre barbue} elle eft d’ailleurs plus grande dans
toutes fes parties. Ses racim s font (impies ,
épaifles, blanchâtres} fes tiges droites, prefquà
deux angles, longues de huit à neuf pouces, munies,
à leur bafe, de feuilles planes, lancéolées,
oblongues, glabres, charnues, longues de deux
ou trois pouces, larges de (ix lignes} trois &
quatre fleurs terminales, prefqu’en épi, larges de
deux pouces , accompagnées d’une braâée ovale,
aiguë, longue d’un demi-pouce} la lèvre de la corolle
recouverte à fa bafe de poils violets j les autres
parties comme dans l ’efpèçe précédente.
Cette plante croît dans les contrées les plus
chaudes de la province de Jaen de Bracamoros,
entre les bourgs de Choros & de Tomependa,
proche le confluent du fleuve des Amazones &
Chincbipes. y ( Kunth. )
TELGPEA. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 197.
Ce genre eft peu diftinguéd-es embothrïum, auquel
fes efpèces avoient d’abord été réunies. Il n’én'
diffère que par une feule glande inférée a la bafe de
! ovaire, quelle entoure prefqu entièrement, & non en
demi-cercle. Il ne renferme que deux efpèces, Yem-
botkrium fpeciofjfimum , n°. 1 , & Yembothrium trun-
catum, nü. 13. (Voyeq EmB0TBR.I0N, Suppl.)
La dénomination de T elopea avoit été employée
par Solander, dans fes manuferits, pour
une plante très-différente, qui paroît appartenir
aux aleuntes, & dont Gasrtner a fait un genre , en
adoptant le nom C amirium de Ruraphe. (Koye{
ce mot t Suppl. )
TEMBOLIL : nom vulgaire du Poivre bétel.
TEMBUL-WÆXNA : nom que porte, à Cey-
Ian , un fruit dont Gæctner a. formé un genre fous
le nom de Sphenoclea.
TEMPLETONfA Ait Hort.Kew. edit. nov. 4.
pag. i l l Brown. MIT.
Ce genre, établi pour le rafnia retuf a Vent. &
D:a. Suppl., en diffère très-peu. Son calice eft à
cinq dents prefqu’égaies} la cârène alongée} une
gonfle pédicellée, plane, comprimée,, à plufieurs
femences. (F b y^R afnie , Suppl.)
TEMUS. {Voyei T emo , Di8. )
TEND A LE-COTTI. Rheed, Bon. Malab. 9.
pag. 4c. tab. 2y. Cette plante fe rapporte au cro-
talaria retitfa Linn. On trouve la figure de fon
fruit dansGærtner, deSem 1. pag. 316. tab. 148.
TEN G A. Sous ce nom, Rheed, Bon, Malab. 1,
pag. i , tab. 1, 2, 5,- 4, a figuré & décrit le cocos
rtuerfera Linn.
TEPHROSIA. (Voye[ G A LE G Ai , Suppl.)
TERAMNUS. Ce genre a été établi par Brown,
adopté par Swartz, Wiüdëncw, &rc., pouf le
dolïchos uncinaius Linn. 11 fe di flingue par fes
fleurs, dont la carène eft fort petite, cachée par le
calice } par les étamines, dont cinq alternes, dénies
$ le ft’gmate Effile , en tête; les gouffes grêles,
comprimées. (Koye^ Dol’C , Dicl. n°. 4 .)
Swartz penfe qu’on a confondu deux espèces
fous le nom de de lie ho s uncinaius. La première
, qu’il nomme te ram nus (volubilis) folio lis
ovaio-lanceolatisypubefeentibus. Swi Flor. Itld. occid.
pag. 1241. C ’eft l'efpèctf de Brown, Jam. 290,
le dolichos uncinatus de Linné. La fécondé eft celle
de Plumier, kon. n i , 11 teranmus (uncinaius)
foliolis oblongis} fabius fericcis. Sw. 1. c.
TERASPIC : nom employé par les jardiniers
pour plufieurs êfpèces de T h l a s p i & d’iBERis.
T E R É 81N T H E . (Boye^ P i s t a c h i e r . )
TÉRÉBINTHOÏPES. Cette plante , placée
parmi les inconnues dans le Flor. %eyl. s n°. 595,
appartienr, d’après Commerfon, au genre S pon-
dias Linn. (Voye-p Monbin. )
TEREBINTHUS. Terebinte. Genre de Tour-
nefort, que Linné a réuni auxpiflacia.
T E RM E S . Encore un mot fur 1 es termes.
Lorfque le défordre & l'anarchie font fur le point
de s’introduire dans une fcience, c’eft alors qu’il
faut redoubler d’efforts pour en arrêter les progrès
, & girantir les efprits du danger des innovations,
ënlés ramenant aux véritables principes de
la fcience. Tel.eft aujourd’hui l’état de la botanique
: les fondt-rneris , fi judicieufement établis
par les Tournefort, les Linné, les Jurtieu, & c .,
font ébranlés} bientôt ils s’écrouleront fous l’abus
des réformes, la botanique rentrera de nouveau
dans l’âncren chaos, étouffés par les changemtns
fucceffifs des termes.
C ’eft une erreur de croire qu’une idée nouvelle
nécertite toujours un terme nouveau. Quicon-
ue cqnnoit bien toutes les rertburces de la langue
ont il veut faire ufage j y prouvera facilement
des exprefiîons qu’il pourra applique^ à l ’idée
ou au nouvel objet qu’il veut peindre à la pen-
fée : un même mot peut être pris dans plu-
fieurs fens différens fans nuire â la clarté, favoir,
dtns fon fens propre, dans un fens méthaphorioue,
allégorique, &c. j. ufage admis prefque dans toutes
les langues, furtout dans celles que nous regardons
comme Ls plus parfaites, telles-que dans
les langues grecque,-latine,Trançaife, &c. Cet
art ingénieux d exprimer par le meme mot p.u-
fieurs idées différentes, eft bien plus une perfection
qu’un d e fa u tu n e élégance de liy!o_
qu’une pauvreté d’exprertlon. Un terme employé
métaphoriquement peint bien mieux les objets
nouveaux qu’on veut repréfenter , que l’invention
de termes inufités, fouvent barbares, qui nuifent
autant à la clarté du fl vie qu’à l m élégante (implicite
> 4 ou il refaite qu il eft peu de mots qui ne
foient employés dans le fens pr; pre & dans le fer»
figuré. Ainfi , pour en citer un exemple, nous di-
fons dans le fens propre 3 qu’une fubfhnce eft teidre,
lorfqu’eîie peut aile ment être et. ramée j du bois tendre
y une pierre tendre ; on l’applique, dans un feus