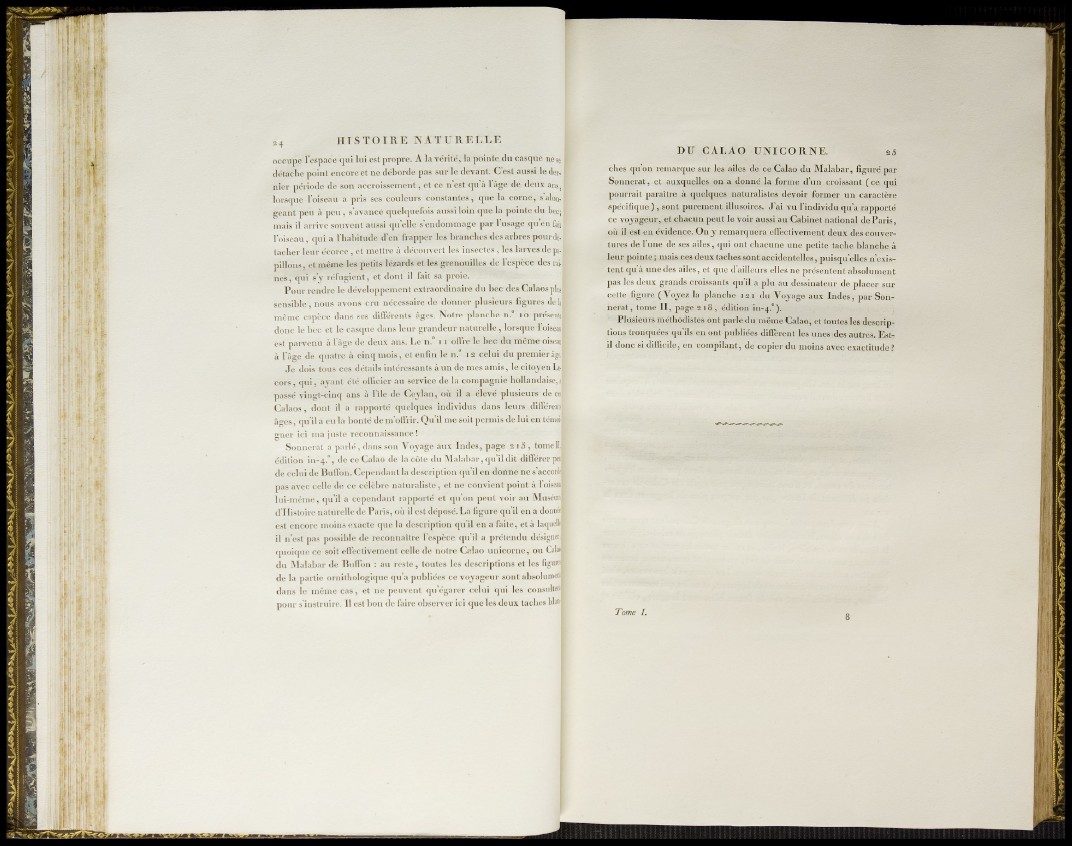
occupe l'espace qui lui est propre. A la vérité, la pointe du casque ne se
détache point encore et ne déborde pas sur le devant. C est aussi le (1ernier
période de son accroissement, et ce n'est qu'à l'âge de deux ans,
lorsque l'oiseau a pris ses couleurs constantes, que la corne, s'alongéant
peu à peu, s'avance quelquefois aussi loin que la pointe du bec;
mais il arrive souvent aussi qu'elle s'endommage par l'usage qu'en fait
l'oiseau, qui a l'habitude d'en frapper les branches des arbres pour détacher
leur écorcc, et mettre à découvert les insectes , les larves de papillons,
et môme les petits lézards et les grenouilles de l'espèce des raines,
qui s'y réfugient, et dont il fait sa proie.
Pour rendre le développement extraordinaire du bec des Calaos plu?
sensible, nous avons cru nécessaire de donner plusieurs figures delà
même espèce dans ses différents âges. Notre planche n.° 10 préscnle
donc le bec et le casque dans leur grandeur naturelle, lorsque l'oiseau
est parvenu à l'âge de deux ans. Le n.° 1 « offre le bec du même oiseau
à l'âge de quatre à cinq mois, et enfin le n.° 12 celui du premier âge.
Je dois tous ces détails intéressants à un de mes amis, le citoyen Lecors,
qui, ayant été officier au service de la compagnie hollandaise,a
passé vingt-cinq ans à l'île de Ceylan, où il a élevé plusieurs de ces
Calaos, dont il a rapporté quelques individus dans leurs différente
â°-es, qu'il a eu la bonté de m'offrir. Qu'il me soit permis de lui en témoigner
ici ma juste reconnaissance!
Sonnerat a parlé, dans son Voyage aux Indes, page 2 1 5 , tome H,
édition in-4.0, de ce Calao de la côte du Malabar, qu'il dit différer peu
de celui de Buffon. Cependant la description qu'il en donne ne s'accorde
pas avec celle de ce célèbre naturaliste, et ne convient point à l'oiseau
lui-même, qu'il a cependant rapporté et qu'on peut voir au Muséum
d'Histoire naturelle de Paris, où il est déposé. La ligure qu'il en a donnée
est encore moins exacte que la description qu'il en a faite, et â laquelle
il n'est pas possible de reconnaître l'espèce qu'il a prétendu désigner,
quoique ce soit effectivement celle de notre Calao unicorne, ou Calao
du Malabar de Buffon : au reste, toutes les descriptions et les figure;
de la partie ornithologique qu'a publiées ce voyageur sont absolûmes
dans le même cas, et ne peuvent qu'égarer celui qui les consulter*
pour s'instruire. Il est bon de faire observer ici que les deux taches blanches
qu'on remarque sur les ailes de ce Calao du Malabar, figuré par
Sonnerat, et auxquelles on a donné la forme d'un croissant (ce qui
pourrait paraître à quelques naturalistes devoir former un caractère
spécifique), sont purement illusoires. J'ai vu l'individu qu'a rapporté
ce voyageur, et chacun peut le voir aussi au Cabinet national de Paris,
où il est en évidence. On y remarquera effectivement deux des couvertures
de l'une de ses ailes, qui ont chacune une petite tache blanche à
leur pointe; mais ces deux taches sont accidentelles, puisqu'elles n'existent
qu'à une des ailes, et que d'ailleurs elles ne présentent absolument
pas les deux grands croissants qu'il a plu au dessinateur de placer sur
cette figure (Voyez la planche 121 du Voyage aux Indes, par Sonnerat,
tome H, page 218 , édition in-4.°).
Plusieurs méthodistes ont parlé du même Calao, et toutes les descriptions
tronquées qu'ils en ont publiées difierent les unes des autres. Estil
donc si difficile, en compilant, de copier du moins avec exactitude?
Tome I. 8