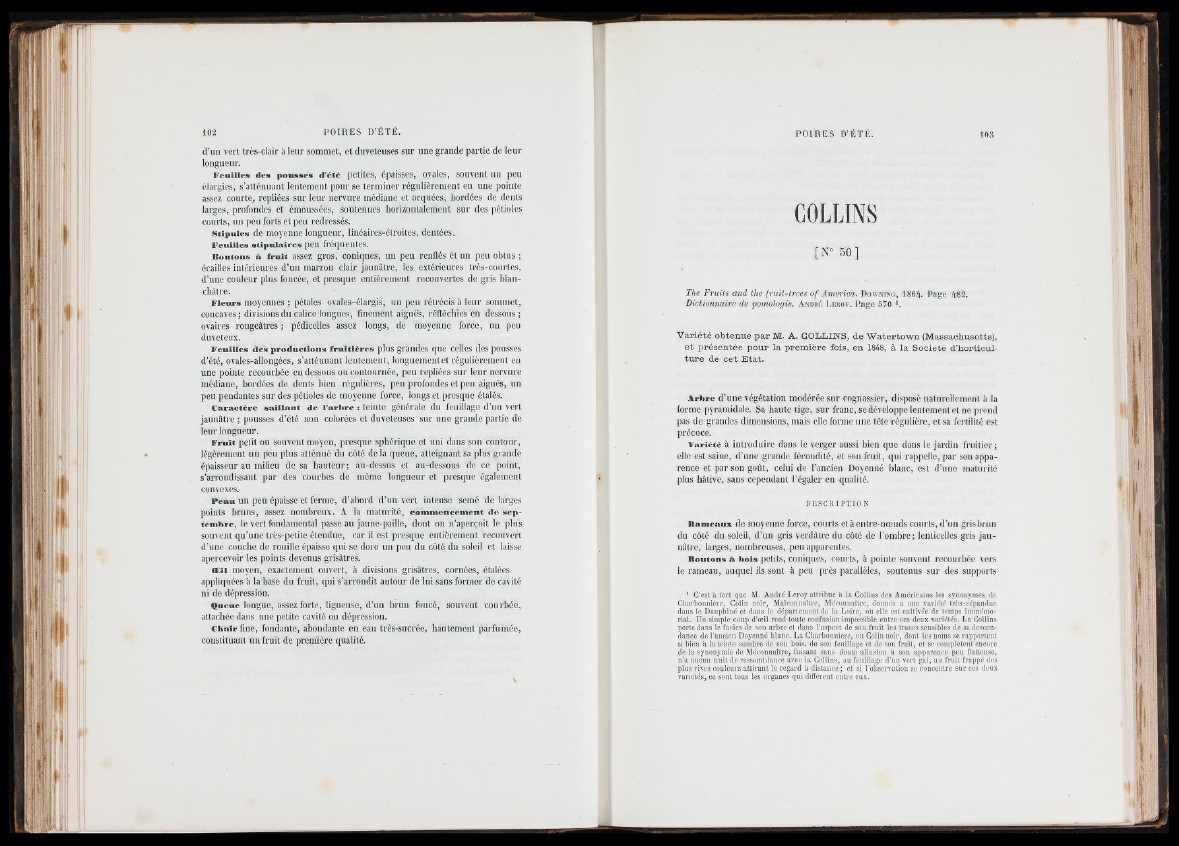
I: i
IIII
iiit
I
d ’mi vert très-clair à leu r sommet, et duveteuses sur une grande partie de leur
longueur.
F eu ille s des pou sses d’éte petites, épaisses, ovales, souvent un peu
élargies, s ’atténuant lentement pour se terminer régidièrcmcnt en une pointe
assez courte, repliées sur leu r nervure médiane et arquées, bordées de dents
larges, profondes et émoussées, souten ues horizoïitalemciit sur des pétioles
courts, un peu forts et peu redressés.
S t ip u le s de moyenne longueur, lliicaircs-élroitcs, dentées.
F eu ille s s t ip u la ir e s peu fréquentes.
Bou tons a fru it assez gros, coniques, un peu renflés et un peu obtus ;
écailles intérieu res d’un marron clair jaunâtre, les extérieures très-courtes,
d’une couleur plus foncée, et presque entièrement recouvertes de gris blanchâtre.
F leu r s moyennes ; pétales o vales-élargis, un peu rétrécis à leu r sommet,
concaves; divisions du calice longues, finement aiguës, réfléchies en d e ssou s;
ovaires rougeâtres ; pédicelles assez longs, de moyenne force, un peu
duveteux.
F e u il le s des prod u c t ion s fru it iè r e s plus grandes que celles des pousses
d ’été, ovales-allougées, s ’atténuant len tem en t, lon gu em en te t régulièrement eu
u n e pointe recourbée en d essous ou contournée, peu repliées sur leur nervurc
médiane, boi d ées de dénis bien régulières, peu profondes et peu aiguës, un
peu pendantes sur des pétioles de moyenne force, longs et presque étalés.
C a r a c tè r e s a i l la u t d c l ’a rb r c : teinte générale du feuillage d ’uu vert
jaunâtre ; pousses d ’été non colorées ct duveteuses sur une grande partie dc
leur longueur.
F ru it petit ou souvent moyen, presque sphérique et uni dans son contour,
légèrement un peu plus atténué du côté de la qu eu e , atteignant sa plus grande
épaisseur au miiieu d e sa hauteur; au-dessus et au-dessous de c e point,
s ’arrondissant par des courbes de mêm e longueur et presque également
conve.xes.
P e a u un peu épaisse et ferme, d’abord d ’un vert intense semé do larges
points bruns, assez nombreux. A la maturité, cam m cn c em en t d e s e p tembre,
le vert fondamental passe au jauiie-pallle, dont on n ’aperçoit le plus
souvent q u ’une très-petite étend ue, car il est presque entièrement recouvert
d ’une couche de rouille épaisse qu i se dore un peu du côté du soleil ct laisse
apercevoir les po ints devenus grisâtres.
OEil moyen, exactement ouvert, à divisions grisâtres, co rnées, étalées
appliquées à la base du fruit, qui s ’arrondit autour de lu i sans former de cavité
n i de dépression.
Qn cu c longue, assez forte, ligueuse, d ’im bruu fon c é, souvent c ou rb é e ,
attachée dans une petite cavité ou dépression.
Chair fine, fondante, abondante eu eau très-sucrée, hautement parfumée,
constituant un fruit de première qualité.
COLLINS
'N - 5 0 ’
The F r u ils an d the fr u it- tr e e s o f Am er ica . Downisg, 1864. Page 482.
D ic tio n n a ire de pomologie. Andué Lehoy. Page 570 b
V a rié té o b ten u e p a r M. A. COLLINS, de W a te r tow n (Massachusetts),
e t p ré s en té e p o u r la p rem iè re fois, en 1848, à la Société d’h o rtic u ltu
r e de c e t E ta t.
A rb re d ’u ne végétation modérée sur cognassier, disposé naturellement à la
forme pyramidale. Sa haute lig e , sur f r a n c ,s ed é v e lo p p e len tcm c iite tn e prend
pas de grandes dimensions, mais elle forme une tête régulière, et sa fertilité est
précoce.
Variete à introduire dans le verger aussi bien que dans le jardin fru itier;
elle est saine, d ’une grande fécondité, e t son fruit, qui rappelle, par sou apparence
et par sou goût, celui de l ’ancien Doyenné blanc, est d ’u n e maturité
plus hâtive, sans cependant l ’égaler en qualité.
D E S C R I P T I O N
B am e a u x de moyenne force, courts et â entre-noeuds courts, d ’un grisbruu
du côté du .soleil, d ’un gris verdâtre du côté de l ’om bre; lenticelles gris jau nâtre,
larges, nombreuses, peu apparentes.
Bou tons à b o is petits, coniques, courts, à pointe souvent recourbée vers
le rameau, auquel ils sont à peu près parallèles, soutenus sur des supports
I C ’e st 'a toi’t q u e M. A n d r é L e ro y a ttr ib u e a la G ollius dos A iiié ric a ia a le s sy n o n ym e s de
Cliai’b o n n iè rc , C olin n o ir , M a lc o n n a îlre , M é c o n n a ître , doiuKÎs a nno v a rié té tr è s - r é p am lu e
d a n s le D a u p h in é e t d a n s le d ép av ten icn t de la L o ir e , où e lle e st c u ltiv é e de tem ps im m ém o ria
l. Un sim p le co u p d ’oe il r e n d to u te c o n fu sio n im p o s s ib le e n tr e c e s deu x v a rié té s . L a Collins
p o r te d a n s le fa c ie s de son a rb r e c t d a n s l ’a sp e c t dc so u f r u i t le s tr a c e s s en s ib le s d e s a d e sc end
a n c e dc l'a iic ic n D o y en n é b la n c . L a C h a rb o n n iè re , ou C olin n o ir, d o n t le s n om s se r a p p o r te n t
si b ien a la te in te som b re de son b o is , de so n feu illag e e t dc son f r u i t , e t se c om p lè te n t en co re
dc l a sy n o n ym ie de M é c o n n a îtr e , fa is a n t s a n s d o u te a llu s io n a son ap p a re n c e p e u fla tteu se ,
n ’a a u c u n tr a i t de re s s em b la n c e ave c la C o llin s , a u f e u illa g e d 'u n v e r t g a i, a u f ru it fra p p é des
p lu s vives co u le u rs a t t i r a n t le r e g a rd ii d is ta n c e ; e t s i l ’o b s e rv a tio n sc co n c e n tre s u r c e s deux
v a r ié té s , ce so n t to u s le s o rg a n e s q u i diffe ren t e n tr e eux.
I