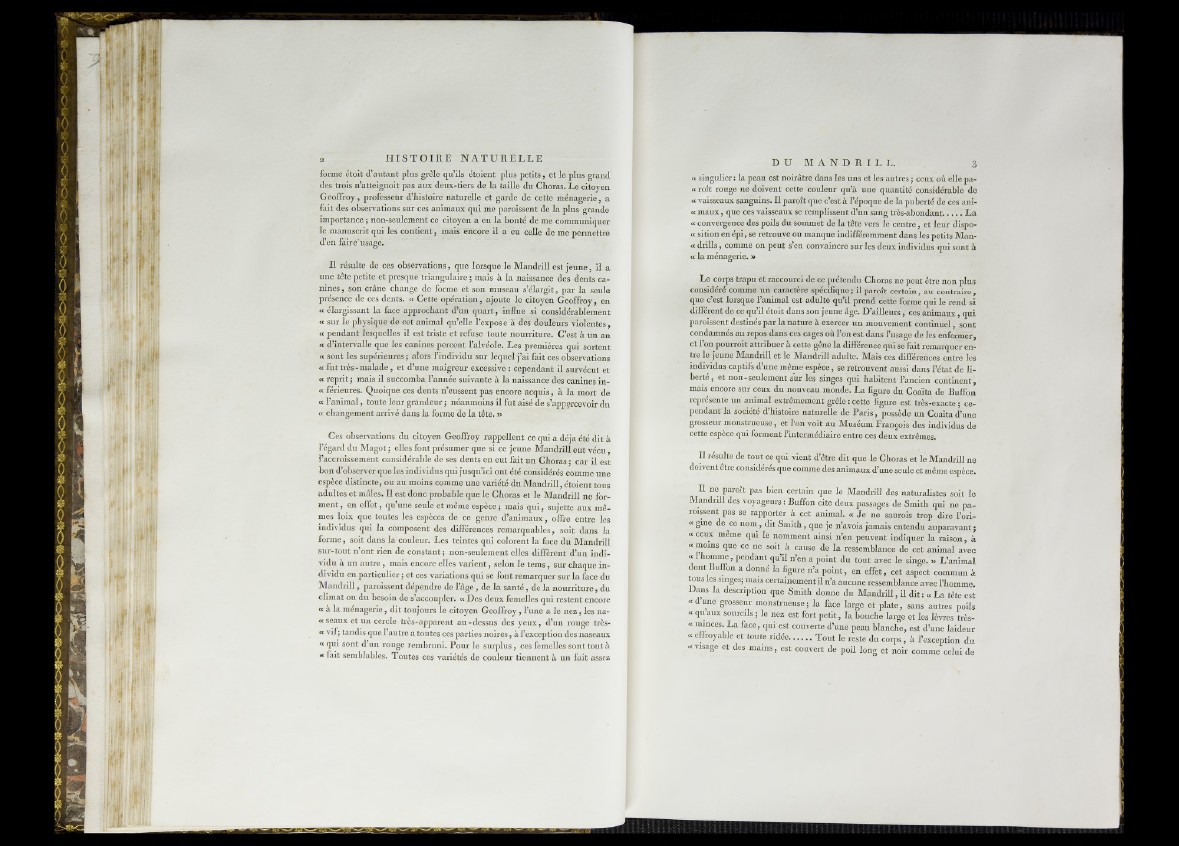
H I S T O I R E N A T U R E L L E
forme ¿toit d’autant plus grêle qu’ils étoient plus petits, et le plus grand
des trois n’atteignoit pas aux deux-tiers de la taille du Choras. Le citoyen
Geoffroy, professeur d’histoire naturelle et garde de cette ménagerie, a
fait des observations sur ces animaux qui me paraissent de la plus grande
importance ; non-seulement ce citoyen a eu la bonté de me communiquer
le manuscrit qui les contient, mais encore il a eu celle de me permettre
d’en faire'usage.
Il résulte de ces observations, que lorsque le Mandrill est jeune, il a
une tête petite et presquë triangulaire ; mais à la naissance des dents canines
, son crâne change de forme et son museau s’élargit, par la seule
présence de ces dents. « Cette opération, ajoute le citoyen Geoffroy, en
CC élargissant la face approchant d’un quart, influe si considérablement
« sur le physique de cet animal qu’elle l’expose à dés douleurs violentes,
« pendant lesquelles il est triste et refuse toute nourriture. C’est à un an
« d’intervalle que les canines percent l’alvéole. Les premières qui sortent
« sont les supérieures ; alors l’individu sur lequel j’ai fait ces observations
« fut très-malade, et d’une maigreur excessive : cependant.il survécut et
« reprit ; mais il succomba l’année suivante à la naissance des canines in-
« férieures. Quoique ces dents n’eussent pas encore acquis, à la mort de
« l’animal, toute leur grandeur ; néanmoins il fut aisé de s’appçrcevoir du
« changement arrivé dans la forme de la tête. »
Ces observations du citoyen Geoffroy rappellent ce qui a déjà été dit à
l’égard du Magot ; elles font présumer que si ce jeune Mandrill eut vécu,
l’accroissement considérable de ses dents en eut fait un Choras • car il est
bon d’observer que les individus qui jusqu’ici ont été considérés comme une
espèce distincte, ou au moins comme une variété du Mandrill, étoient tous
adultes et mâles. R est donc probable que le Choras et le Mandrill ne forment,
en effet, qu’une seule et même espèce; mais qui, sujette aux mêmes
loix que toutes les espèces de ce genre d’animaux, offre entre les
individus qui la composent des différences remarquables, soit dans la
forme, soit dans la couleur. Les teintes qui colorent la face du Mandrill
sur-tout n’ont rien de constant ; non-seulement elles diffèrent d’un individu
à un autre, mais encore elles varient, selon le tems, sur chaque individu
en particulier ; et ces variations qui se font remarquer sur la face du
Mandrill, paraissent dépendre de l’âge, de la santé, de la nourriture, du
climat ou du besoin de s’accoupler. « Des deux femelles qui restent encore
« a la ménagerie, dit toujours le citoyen Geoffroy, l’une a le nez, les na-
« seaux et un cercle très-apparent au-dessus des yeux, d’un rouge très-
ci vif; tandis que l’autre a toutes ces parties noires, à l’exception des naseaux
« qui sont d’un rouge rembruni. Pour le surplus, ces femelles sont tout à
« fait semblables. Toutes ces variétés de couleur tiennent à un fait assez
D U M A N D R I L L . 3
« singulier : la peau est noirâtre dans les uns et les autres ; ceux où elle pa-
« roît rouge ne doivent cette couleur qu’à une quantité considérable de
« vaisseaux sanguins. Il paraît que c’est à l’époque de la puberté de ces ani-
« maux, que ces vaisseaux se remplissent d’un sang très-abondant La
« convergence des poils du sommet de la tête vers le centre, et leur disposition
en épi, se retrouve ou manque indifféremment dans les petits Man-
« drills, comme on peut s’en convaincre sur les deux individus qui sont à
« la ménagerie. »
Le corps trapu et raccourci de ce prétendu Choras ne peut être non plus
considéré comme un caractère spécifique ; il paraît certain, au contraire
que c’est lorsque l’animal est adulte qu’il prend cette forme qui le rend si
différent de ce qu’il étoit dans son jeune âge. D’ailleurs, ces animaux, qui
paraissent destinés par la nature à exercer un mouvement continuel, sont
condamnés au repos dans ces cages où l’on est dans l’usage de les enfermer,
et l’on pourrait attribuer à cette gêne la différence qui se fait remarquer entre
le jeune Mandrill et le Mandrill adulte. Mais ces différences entre les
individus captifs d’une même espèce, se retrouvent aussi dans l’état de liberté,
et non-seulement sur les singes qui habitent l’ancien continent,
mais encore sur ceux du nouveau monde. La figure du Coaïta de Buffon
représente un animal extrêmement grêle : cette figure est très-exacte ; cependant
la société d’histoire naturelle de Paris, possède un Coaïta d’une
grosseur monstrueuse, et l’on voit au Muséum François des individus de
cette espèce qui forment l’intermédiaire entre ces deux extrêmes.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le Choras et le Man^ll ne
doivent être considérés que comme des animaux d’une seule et même espèce.
Il ne paraît pas bien certain que le Mandrill des naturalistes soit le
Mandrill des voyageurs : Buffon cite deux passages de Smith qui ne paraissent
pas se rapporter à cet animal. « Je ne saurais trop dire l’ori-
“ gme de ce nom, dit Smith, que je n’avois jamais entendu auparavant;
« ceux même qui le nomment ainsi n’en peuvent indiquer la raison, à
« moins que ce ne soit à cause de la ressemblance de cet animal avec
J °I*™Le ’ Pen<lant qu’il n’en a point du tout avec le singe. » L’animal
dont Buffon a donné la figure n’a point, en effet, cet aspect commun à
tous les singes; mais certainement il n’a aucune ressemblance avec l’homme.
Dans la description que Smith donne du Mandrill, il dit: «La tête est
«dune grosseur monstrueuse; la face large et plate, sans autres poils
« qu aux sourcils ; le nez est fort petit, l'a, bouche large et les lèvres très-
« minces. La face, qui est couverte d’une peau blanche, est d’une laideur
« effroyable et toute ridée Tout le reste du corps, à l’exception du
«visage et des mains, est couvert de poil long et noir comme celui de