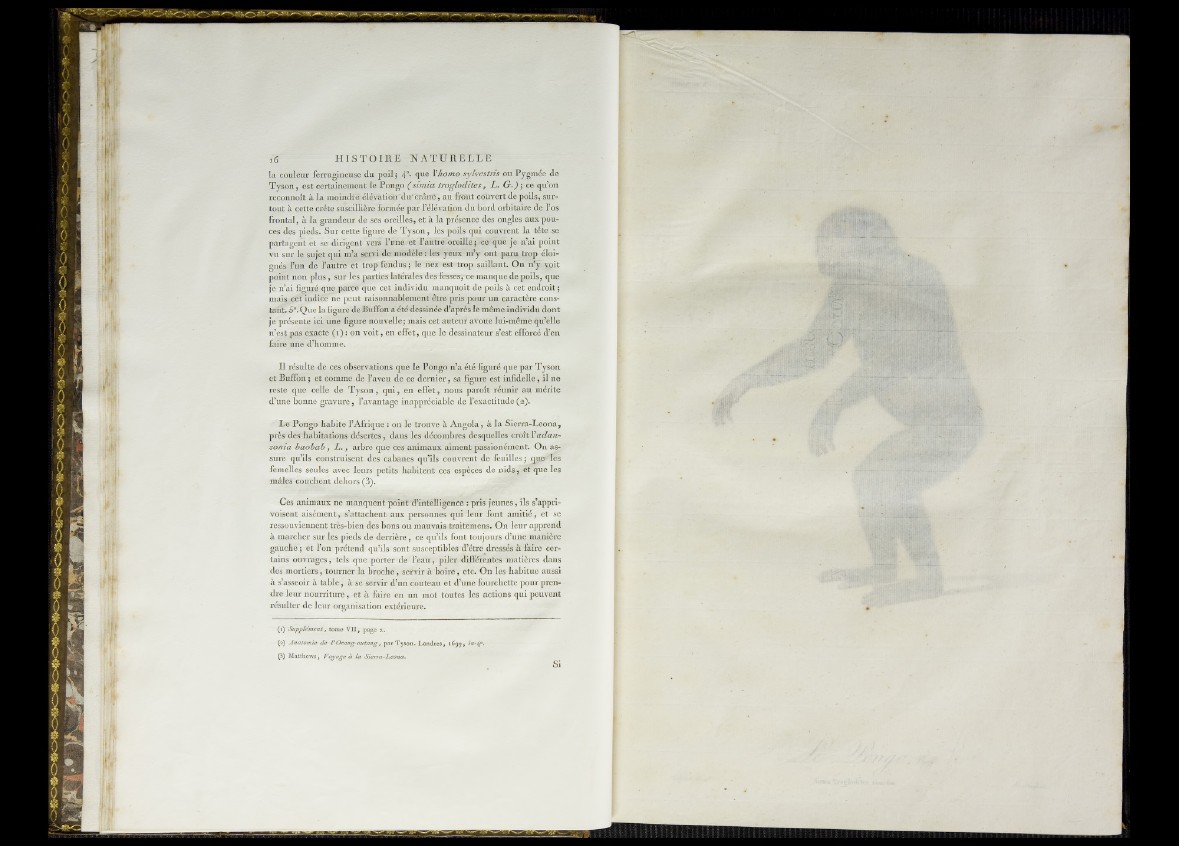
i6 H I S T O IR E NATU R E L L E
la couleur ferrugineuse du poil ; 4°- que YAomo sylvestris ou Pygmée de
Tyson, est certainement le Pongo ( simia troglodites, L. G.) ; ce qu’on
reconnoît à la moindfè élévation du’crâne, au front couvert de poils, surtout
à cette crête suscillière formée par l’élévation du bord orbitaire de l’os
frontal, à la grandeur de ses oreilles, et à la présence des ongles aux pouces
des pieds. Sur cette figure de Tyson, les poils qui couvrent la tête se
partagent et se dirigent vers l’une et l’autre oreille ; ce que je n’ai point
vu sur le sujet qui m’a servi de modèle : les yeux m’y ont paru trop éloignés
l’un de l’autre et trop fendus ; le nez est trop saillant. On n’y ypit
point non plus, sur les parties latérales des fesseaj-ce manque de poils, que
je n’ai figuré que parce que cet individu manquoit de poils à cet endroit ;
mais, cet indice ne peut raisonnablement être pris pour un caractère constant.
5°. Que la figure de Buffon a été dessinée d’après le même individu dont
je présente ici une figure nouvelle; mais cet auteur avoue lui-même qu’elle
n’est pas exacte (1) : on voit, en effet, que le dessinateur s’est efforcé d’en
faire une d’homme.
Il résulte de ces observations que le Pongo n’a été figuré que par Tyson
et Buffon ; et comme de l’aveu de ce dernier, sa figure est infidelle, il ne
reste que celle de Tyson, qui, en effet, nous paroît réunir au mérite
d’une bonne gravure, l’avantage inappréciable de l’exactitude (2).
Le Pongo habite l’Afrique : on le trouve à Angola, à la Sierra-Leona,
près des habitations désertes, dans les décombres desquelles croît Vadan-
sonia baobab , L ., arbre que ces animaux aiment passionément. On assure
qu’ils construisent des cabanes qu’ils couvrent de feuilles ; quelles
femelles seules avec leurs petits habitent ces espèces de nids,, et que les
mâles couchent dehors (3).
Ces animaux ne manquent-point d’intelligence : pris jeunes, ils s’apprivoisent
aisément, s’attachent aux personnes qui leur font amitié, et se
ressouviennent très-bien des bons ou mauvais traitemens. On leur apprend
à marcher sur les pieds de derrière, ce qu’ils font toujours d’une manière
gauche ; et l’on prétend qu’ils sont susceptibles d’être dressés à faire certains
ouvrages, tels que porter de l’eau, piler différentes matières dans
des mortiers, tourner la broche, servir à boire, etc. On les habitue aussi
à s’asseoir à table, à se servir d’un couteau et d’une fourchette pour prendre
leur nourriture, et à faire en un mot toutes les actions qui peuvent
résulter de leur organisation extérieure.
(ï) Supplément, tome VII, page 2.
(2) Anatomie de l*Orang-outang, par Tyson. Londres, 1699, in-4°.
(3) Matthews, Voyage à la Sierra-Leona.
Si