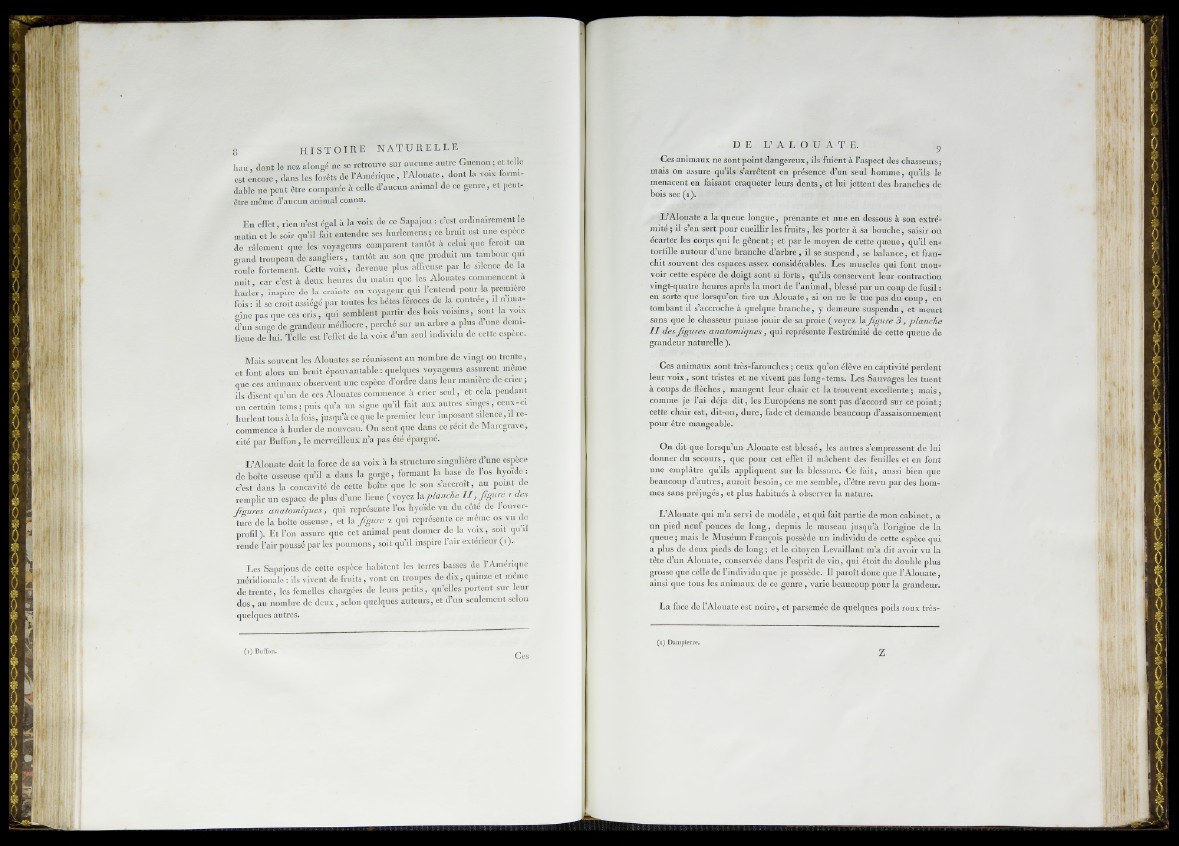
8 h i s t o i r e n a t u r e l l e
liau, dont le nez alongé ne se retrouve sur aucune autre Guenon ; et telle
est encore, dans les forêts de l’Amérique, l’Alouate, dont la voix formidable
ne peut être comparée à celle d’aucun anhnàl dè ce genre, et peut-
être même d’aucun animal connu.
En effet, rien n’est égal à la voix de ce Sapajou c’est ordinairement le
matin et le soir qu’il fait entendre ses hurlemens ce bruit est une espèce
de râlement que les voyageurs comparent tantôt à celui que ferait un
grand troupeau de sangliers, tantôt au son que produit un tambour qui
roule fortement. Cette voix, devenue plus affreuse par le silence de la
nuit, car c’est à deux heures du matin que les Alouates commencent à
hurler, inspire de la crainte au voyageur qui l’entend pour la première
fois : il se croit assiégé par toutes les bêtes féroces de la contrée, il n imagine
pas que ces cris, qui semblent partir des bois voisins, sont la voix
d’un singe de grandeur médiocre, perché sur un arbre a plus d’une deim-
lieue de lui. Telle est l’effet de la voix d’un seul individu de cette espèce.
Mais souvent les Alouates se réunissent au nombre de vingt ou trente,
et font alors un bruit épouvantable : quelques voyageurs assurent même
que ces animaux observent une espèce d’ordre dans leur manière de crier ;
ils disent qu’un de ces Alouates commence à crier seul,' et cela pendant
un certain tèms ; puis qu’a un signe qu’il fait aux autres singes, ceux-ci
hurlent tous à la fois, j usqu’à ce que le premier leur imposant silence, il recommence
à hurler de nouveau. On sent que dans ce récit de Marcgrave,
cité par Buffon, le merveilleux n’a pas été épargné.
L’Alouate doit la force de sa voix à la structure singulière d’une espèce
de boîte osseuse qu’il a dans la gorge, formant la base de l’os hyoïde:
c’est dans la concavité de cette boîte que le son s’accroît, au point de
remplir un espace de plus d’une lieue (voyez la planche I I , figure 1 des
figures anatomiques, qui représente l’os hyoïde vu du côté de l’ouverture
de la boîte osseuse, et \& figure 2 qui représente ce même os vu de
profil). Et l’on assure que cet animal peut donner de là voix, soit qui!
rende l’air poussé par les poumons, soit qu’il inspire l’air extérieur (1).
Les Sapajous de cette espèce habitent les terres basses de l’Amérique
méridionale : ils vivent de fruits, vont en troupes de dix, quinze et meme
de trente, les femelles chargées de leurs petits, qu’elles portent sur leur
dos, au nombre de deux, selon quelques auteurs, et d’un seulement selon
quelques autres.
(i) Buffon. Ces
D E L’ A L O U A T E. 9
Ces animaux ne sont point dangereux, ils fuient à l’aspect des chasseurs:
mais on assure qu’ils s’arrêtent en présence d’un seul homme, qu’ils le
menacent en faisant craqueter leurs dents, et lui jettent des branches de
bois sec (i). .
L’Alouate a la queue longue, prenante et nue en dessous à son extrémité
; il s’en sert pour cueillir les fruits, les porter à sa bouche, saisir ou
écarter les corps qui le gênent ; et par le moyen de cette queue, qu’il entortille
autour d’une branche d’arbre, il se suspend, se balance, et franchit
souvent des espaces assez considérables. Les muscles qui font mouvoir
cette espèce de doigt sont si forts, qu’ils conservent leur contraction
vingt-quatre heures après la mort de l’animal, blessé par un coup de fusil :
en sorte que lorsqu’on tire un Alouate, si on ne le tue pas du coup, en
tombant il s’accroche à quelque branche, y demeure suspendu, et meurt
sans que le chasseur puisse jouir de sa proie (voyez lafigure 3 , planche
I I des figures anatomiques , qui représente l’extrémité de cette queue de
grandeur naturelle ).
Ces animaux sont très-farouches ; ceux qu’on élève en captivité perdent
leur voix, sont tristes et ne vivent pas long-tems. Les Sauvages les tuent
à coups de flèches , mangent leur chair et la trouvent excellente ; mais,
comme je l’ai déjà dit, les Européens ne sont pas d’accord sur ce point ;
cette chair est, dit-on, dure, fade et demande beaucoup d’assaisonnement
pour être mangeable.
On dit que lorsqu’un Alouate est blessé, les autres s’empressent de lui
donner du secours, que pour cet effet il mâchent des feuilles et en font
une emplâtre qu’ils appliquent sur la blessure. Ce fait, aussi bien que
beaucoup d’autres, auroit besoin, ce me semble, d’être revu par des hommes
sans préjugés, et plus habitués à observer la nature.
L’Alouate qui m’a servi de modèle, et qui fait partie de mon cabinet, a
un pied neuf pouces de long, depuis le museau jusqu’à l’origine de la
queue ; mais le Muséum François possède un individu de cette espèce qui
a plus de deux pieds de long ; et le citoyen Levaillant m’a dit avoir vu la
tête d’un Alouate, conservée dans l’esprit de vin, qui étoit du double plus
grosse que celle de l’individu que je possède. Il paroi t donc que l’Alouate,
ainsi que tous les animaux de ce genre, varie beaucoup pour la grandeur.
La face de l’Alouate est noire, et parsemée de quelques poils roux très-
( i ) Dampierre. z