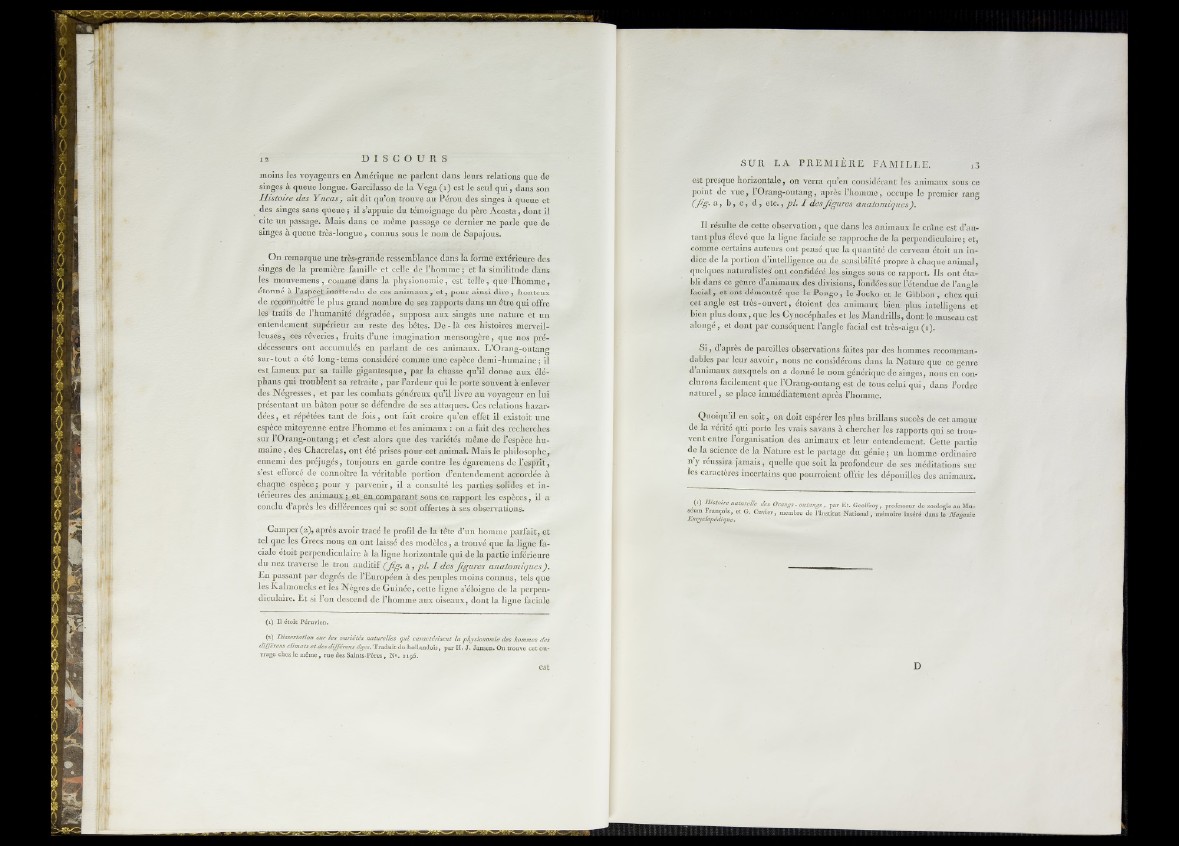
D I S C O U R S
moins les voyageurs en Amérique ne parlent dans leurs relations que de
singes à queue longue. Garcilasso de la Yega (1) est le seul qui, dans son
Histoire des Yncas, ait dit qu’on trouve au Pérou des singes à queue et
des singes sans queue ; il s’appuie du témoignage du père Acosta, dont il
cite un passage. Mais dans ce même passage ce dernier ne parle que de
singes à queue très-longue, connus sous le nom de Sapajous.
On remarque une très-grande ressemblance dans la forme extérieure des
singes de la première famille et celle de l’homme ; çt la similitude dans
les mouvemens, comme dans la physionomie, est*telle, que l’homme,
étonné à l’aspectrinattendu de ces animaux, et, pour ainsi dire, honteux
de reeonnortre le plus grand nombre de ses rapports dans un être qui offre
les traits de l’humanité dégradée, supposa aux singes une nature et un
entendement supérieur au reste des bêtes. De - là ces histoires merveilleuses,
ces rêveries, fruits d’une imagination mensongère, que nos prédécesseurs
ont accumulés en parlant de ces animaux. L’Orang-outang
sur-tout a été long-tems considéré comme une espèce demi - humaine j il
est fameux par_sa taille gigantesque, par la chasse qu’il donne aux élé-
phans qui troublent sa retraite , par l’ardeur qui le porte souvent à enlever
des Négresses, et par les combats généreux qu’il livre au voyageur en lui
présentant un bâton pour se défendre de ses attaques. Ces relations hazar-
dées, et répétées tant de fois, ont fait croire qu’en effet il existoit une
espèce mitoyenne entre l’homme et les animaux : on a fait des recherches
sur l’Orang-outang ; et c’est alors que des variétés même de l’espèce humaine
, des Chacrelas, ont été prises pour cet animal. Mais le philosophe,
ennemi des préjugés, toujours en garde contre les égaremens de l’esprit,
s’est efforcé de connoître la véritable portion d’entendement accordée à
chaque espèce ; pour y parvenir, il a consulté les parties solides et intérieures
des animaux.; >et ,j3n_comp;araiit sous ce rapport les espèces, il a
conclu d’après les différences qui se sont offertes à ses observations.
Camper (2), après avoir tracé le profil de là tête d’un homme parfait, et
tel que les Grecs nous en ont laissé des modèles, a trouvé que la ligne faciale
étoit perpendiculaire à la ligne horizontale qui de la partie inférieure
du nez traverse le trou auditif ( fig . a , pl. I des figures anatomiques).
En passant par degrés de l’Européen à des peuples moins connus, tels que
les K.almoucks et les Nègres de Guinée, cette ligne s’éloigne de la perpendiculaire.
Et si l’on descend de l’homme aux oiseaux, dont la ligne faciale
(1) Il étoit Péruvien.
(2) Dissertation sur les variétés naturelles qui caractérisent la physionomie des hommes des
différens climats et des dijférens âges. Traduit du hollandois, par H. J. Jansen. On trouve cet ouvrage
chez le même, rue des Saints-Pères, N°. 1195.
est
SUR LA PREMIÈRE FAMILLE. i3
est presque horizontale, on verra qu’en considérant les animaux sous ce
point de vue, l’Orang-outang, après l’homme, occupe le premier rang
(Jig- a , b, c , d , etc., pl. I des figures anatomiques ).
Il résulte de cette observation, que dans les animaux le crâne est d’autant
plus élevé que la ligne faciale se rapproche de la perpendiculaire j et,
comme certains auteurs ont pensé que la quantité de cerveau étoit un indice
de la portion d’intelligence ou de sensibilité propre à chaque animal,
quelques naturalistes? ont considéré les singes sous ce rapport. Ils ont établi
dans ce génre d’animaux des divisions, fondées sur l’étendue de l’angle
facial, et ont démontré que le Pongo, le Jocko et le Gibbon, chez qui
cet angle est très - ouvert, étoient des animaux bien plus intelligens et
bien plus doux, que les Cynocéphales et les Mandrills, dont le museau est
alongé, et dont par conséquent l’angle facial ést très-aigu (1).
Si, d’apres de pareilles observations faites par des hommes recomman-
dables par leur savoir, nous ne considérons dans la Nature que ce genre
d animaux auxquels on a donné le nom générique de singes, nous en conclurons
facilement que l’Orang-outang est de tous celui qui, dans l’ordre
naturel, se place immédiatement après l’homme.
Quoiqu’il en soit, on doit espérer les plus brillans succès de cet amour
de la vérité qui porte les vrais savans à chercher les rapports qui se trouvent
entre l’organisation des animaux et leur entendement. Cette partie
de la science de la Nature est le partage du génie j un homme ordinaire
n y réussira jamais, quelle que soit la profondeur de ses méditations sur
les caractères incertains que pourroient offrir les dépouilles des animaux.
(1) Histoire naturelle des Orangs-outangs, par Et. Geoffroy, professeur de zoologie au Muséum
rançois, et G. Cuvier, membre de l’Institut National, mémoire inséré dans le Magasin
Encyclopédique.
D