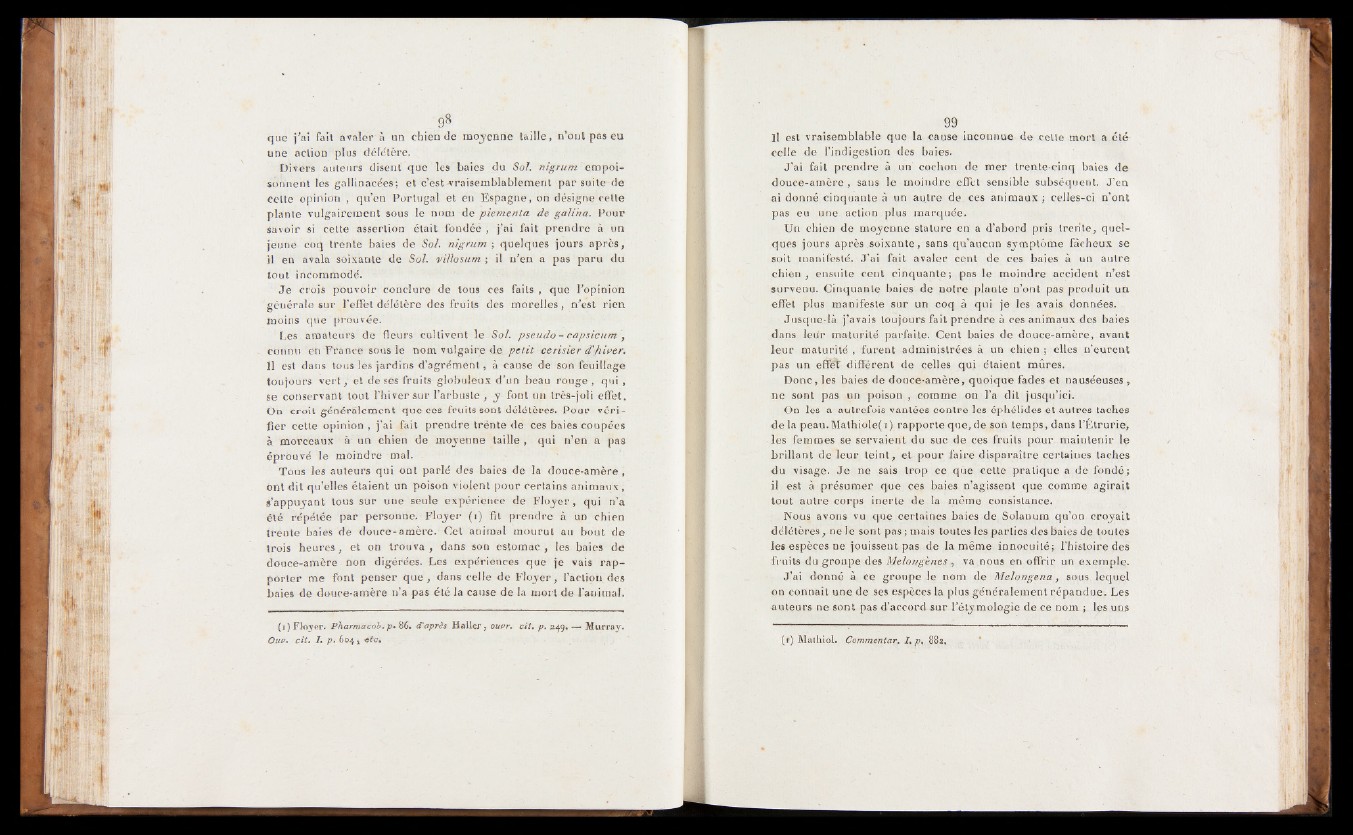
que fai fait avaler à un chien de moyenne taille, n’ont pas eu
une action plus délétère.
Divers auteurs disent que les baies du Sol. nigrum empoisonnent
les gallinacées; et c’est-vraisemblablement par suite-de
cette opinion , qu’en Portugal et en Espagne, on désigne celte
plante vulgairement sous le nom de piementa de galina. Pour
Savoir si cette assertion était fondée , j’ai fait prendre à un
jeune coq trente baies de Sol. nigrum ; quelques jours après,
il en avala soixante de Sol. vfflosum ; il n’en a pas paru du
tout incommodé.
Je crois pouvoir conclure de tous ces faits , que l’opinion
générale sur l’effet délétère des fruits des morelles, n’est rien
moins que prouvée.
Les amateurs de fleurs cultivent le Sol. pseudo - capsicum,
connu en France sous le nom vulgaire de petit cerisier d'hiver.
11 est dans tous les jardins d’agrément, à cause de son feuillage
toujours vert, et de ses fruits globuleux d’.un beau rouge , qui,
se conservant tout l’hiver sur l’arbuste, y font un très-joli effet.
On croit généralement que ces fruits sont délétères. Pour vérifier
cette opinion , j’ai fait prendre trënte de ces baies coupées
à morceaux à un chien de moyenne taille , qui n’en a pas
éprouvé le moindre mal.
Tous les auteurs qui ont parlé des baies de la douce-amère ,
ont dit qu’elles étaient un poison violent pour certains animaux,
s’appuyant tous sur une seule expérience de Floyer, qui n’a
été répétée par personne. Floyer (i) fit prendre à un chien
trente baies dé douce-amère. Oet animal mourut au bout de
trois heures, et on trouva , dans son estomac , les baies de
douce-amère non digérées. Les expériences que je vais rapporter
me font penser que , dans celle de Floyer, l’action des
baies de douce-amère n’a pas été la cause de la mort de l'animal.
(i) Ftcvyer. PKarmàcob;p. 86. d’après Haller, ourr. cit. p. 249« — Murray.
Ouf. cit. 1. p. 604, etc.
Il est vraisemblable que la cause Inconnue de celle mort a été
celle de l’indigestion des baies.
J’ai fait prendre à un cochon de mer trente-cinq baies de
douce-amère , sans le moindre effet sensible subséquent. J’en
ai donné cinquante à un autre de ces animaux ; celles-ci n’ont
pas eu une action plus marquée.
Un chien de moyenne stature en a d’abord pris trente, quelques
jours après soixante, sans qu’aucun symptôme fâcheux se
soit manifesté. J’ai fait avaler cent de ces baies à un autre
chien , ensuite cent cinquante; pas le moindre accident n’est
survenu. Cinquante baies de notre plante n’ont pas produit un
effet plus manifeste sur un coq à qui je les avais données.
Jusque-là j’avais toujours fait prendre à ces animaux des baies
dans ledr maturité parfaite. Cent baies de douce-amère, avant
leur maturité , furent administrées à un chien ; elles n’eurent
pas un efieî différent de celles qui étaient mûres.
Donc, les baies de douce-amère, quoique fades et nauséeuses,
ne sont pas un poison , comme on l’a dit jusqu’ici.
On les a autrefois vantées contre les éphélides et autres taches
de la peau. Malhiole( 1) rapporte que, de son temps, dans l’Étrurie,
les femmes se servaient du suc de ces fruits pour maintenir le
brillant de leur teint, et pour faire disparaître certaines taches
du visage. Je ne sais trop ce que celte pratique a de fondé;
il est à présumer que ces baies n’agissent que comme agirait
tout autre corps inerte de la même consistance.
Nous avons vu que certaines baies de Solanum qu’on croyait
délétères, ne le sont pas ; mais toutes les parties des baies de toutes
les espèces ne jouissent pas de la même innocuité; l’histoire des
fruits du groupe des Melong'enes , va nous en offrir un exemple.
J’ai donné à ce groupe le nom de Melongena, sous lequel
on connaît une de ses espèces la plus généralement répandue. Les
auteurs ne sont pas d’accord sur l’étymologie de ce nom ; les uns
(s) Matkiol. Commenter. I. p, 28a,