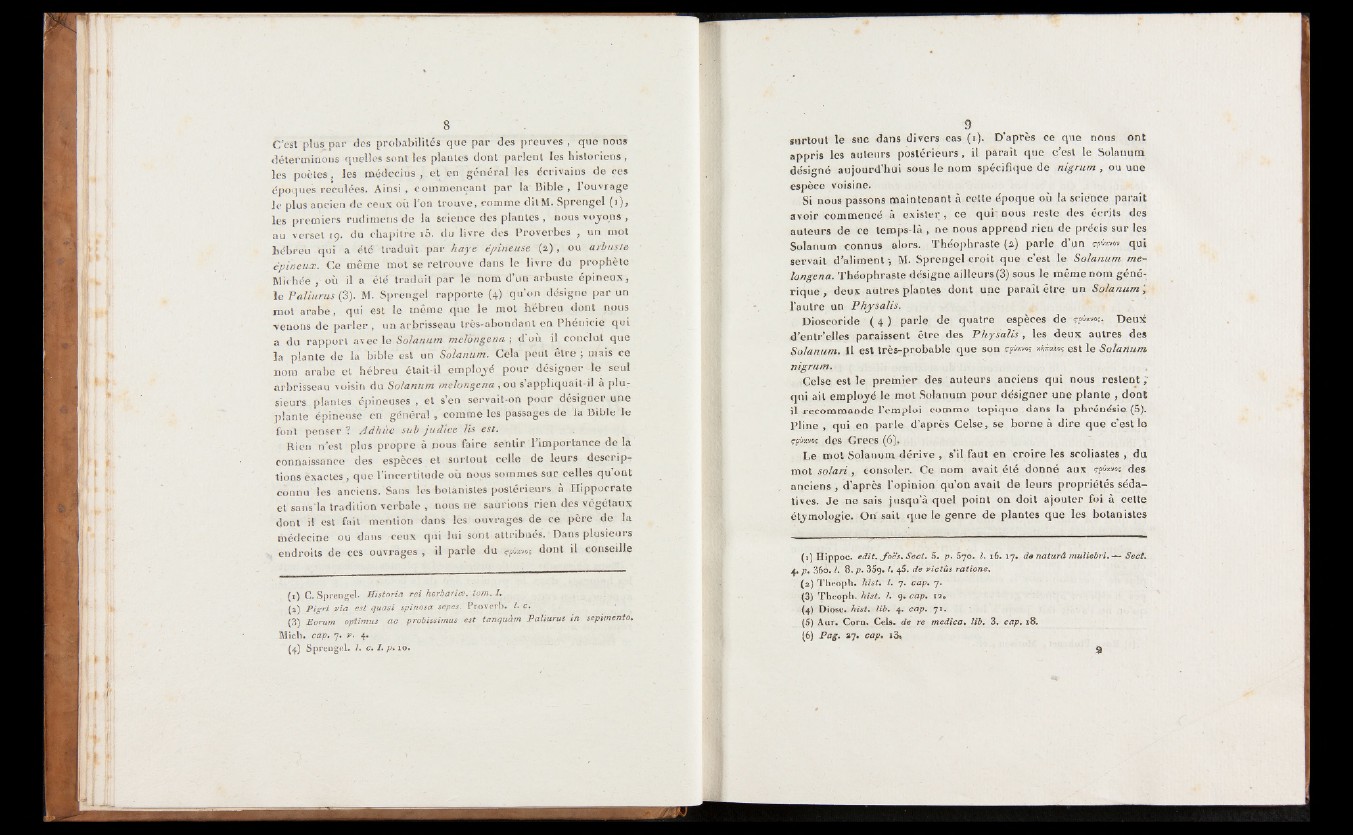
C’est plus par des probabilités que par des preuves , que nous
déterminons quelles sont les plantes dont parlent les historiens,
les poètes, les médecins , et en général les écrivains de ces
époques reculées. Ainsi , commençant par la- Bible , 1 ouvrage
le plus ancien de ceux où l’on trouve, comme dilM. Sprengel (i),
les premiers rudimens de la science des plantes , nous voyons ,
au verset 19. du chapitre i5. du livre des Proverbes , un mot
hébreu qui a été traduit par haye épineuse {%) , ou arbuste
épineux. Ce même mot se retrouve dans le livre du prophète
Michéë , où il a été traduit par le nom d’un arbuste épineux,
le Paliurus (3). M. Sprengel rapporte (4) qu’on désigne par un
mot arabe, qui est le même que le mot hébreu dont nous
venons de parler , un arbrisseau très-abondant en Phénicie qui
a du rapport avec le Solanum melongena ; d où il conclut que
la plante de la bible est un Solanum. Cela peut être ; mais ce
nom arabe et hébreu était-il employé pour désigner le seul
arbrisseau voisin du Solanum melongena , ou s’appliquait-il à plur
sieurs plantes épineuses , et s’en servait-on pour désigner une
plante épineuse en général , comme les passages de la Bible le
font penser ? Adhàc sub judice lis est.
Rien n’est plus propre à nous faire sentir l’importance de la
connaissance des espèces et surtout celle de leurs descriptions
exactes, que l ’incertitude où nous sommes sur celles qu ont
connu les anciens. Sans lés botanistes postérieurs à Hippocrate
et sans la tradition verbale , nous ne saurions rien des végétaux
dont il est fait mention dans les ouvrages de ce père de la
médecine ou dans ceux qui lui sont attribués. Dans plusieurs
v, endroits de ces ouvrages , il parle du qnJxvos dont il conseille
I ft!
(1) C. Sprengel. Historié rei herbarioe. tom. I.
(a) Pigri via est quasi spinosa sapes. Proverb. 1. c.
(3) Eorum optimus ac probissimus est tanquàm Paliurus in sepimento.
Mich. cap. 7. v. 4.
(4) Sprengel. 1. c .I .p n o .
surtout le sac dans divers cas (1). D’après ce que nous ont
appris les auteurs postérieurs , il paraît que c’est le Solauum
désigné aujourd’hui sous le nom spécifique de nigrum , ou une
espèce voisine.
Si nous passons maintenant à celte époque où la science paraît
avoir .commencé à exister , ce qui* nous reste des écrits des
auteurs de ce lerops-ià , ne nous apprend rieu de précis sur les
Solanum connus alors. Théophraste (2) parle d’un qui
servait d’aliment •, M. Sprengel croit que c’est le Solanum melongena.
Théophraste désigne ailleurs (3) sous le même nom générique
, deux autres plantes dont une paraît être un Solanum ',
l’autre un Pkysalis.
Dioscoride (4 ) parle de quatre espèces de-çp^vcç. Deux
d’entr’elles paraissent être des Pkysalis , les deux autres des
Solanum. Il est très-probable que son s-pvxïoç «W*: est le Solarium
nigrum.
Celse est le premier des auteurs anciens qui nous restent ;
qui ait employé le mot Solanum pour désigner une plante , dont
il recommande l’emploi comme topique dans la phrénésie. (5).
Pline , qui en parle d’après Celse, se borne à dire que c’est le
çpvy.voç des Grecs (6),
Le mot Solanum dérive , s’il faut en croire les scoliastes , du
mot solari, consoler. Ce nom avait été donné aux cp"*v°s des
anciens, d’après l’opinion qu’on avait de leurs propriétés sédatives.
Je ne sais jusqu’à quel point on doit ajouter foi à cette
étymologie. Où sait que le genre de plantes que les botanistes
(1) Hippoc. edit, Joe$. Sect. 5. p. 570. 1. 16. 17* de naturd muliebri.~~ Sect.
4. p. 36o. I. 8. p. 35945. de victus ratiqne.
(2) Tbeoph. hist. 1. 7. cap. 7.
(3) Theoph. hist. I. 9. cap. 12*
(4) Diosc. hist. lib. 4. cap. 71.
(5) Aar. Corn. Cels, de re medica. lib. 3. cap. 18.
(6) Pag. 27. cap. i3*