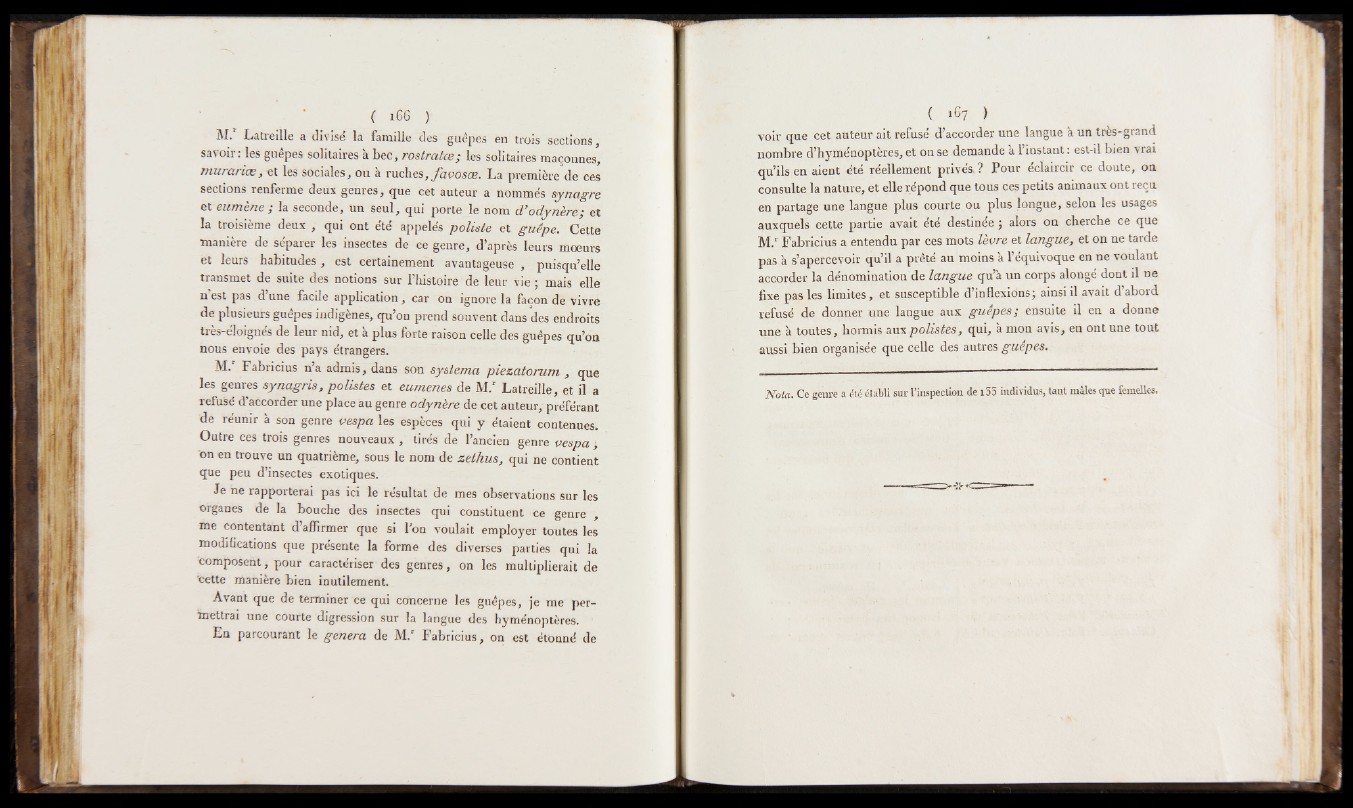
M. Latreille a divisé la famille des guêpes en trois sections,
savoir: les guêpes solitaires à bec, rostratoe; les solitaires maçonnes,
murariæ, et les sociales, ou à ruches, favosæ. La première de ces
sections renferme deux genres, que cet auteur a nommés synagre
et eumène; la seconde, un seul, qui porte le nom d’odynère; et
la troisième deux , qui ont été appelés poliste et guêpe. Cette
maniéré de sepaier les insectes de ce genre, d’après leurs moeurs
et leurs habitudes, est certainement avantageuse , puisqu’elle
transmet de suite des notions sur l’histoire de leur vie ; mais elle
n est pas d une facile application, car on ignore la façon de vivre
de plusieurs guêpes indigènes, qu’on prend souvent dans des endroits
tres-éloignes de leur nid, et a plus forte raison celle des guêpes qu’on
nous envoie des pays étrangers.
M. Fabricius n’a admis, dans son sysiema piezatorum , que
les genres synagris, polistes et eumenes de M.r Latreille, et il a
refusé d’accorder une place au genre odynère de cet auteur, préférant
de réunir à son genre vespa les espèces qui y étaient contenues.
Outre ces trois genres nouveaux , tirés de l’ancien genre vespa >,
on en trouve un quatrième, sous le nom de zethus, qui ne contient
que peu d’insectes exotiques.
Je ne rapporterai pas ici le résultat de mes observations sur les
organes de la bouche des insectes qui constituent ce genre
me contentant d affirmer que si l’on voulait employer toutes les
modifications que présente la forme des diverses parties qui la
composent, pour caractériser des genres, on les multiplierait de
cette manière bien inutilement.
Avant que de terminer ce qui concerne les guêpes, je me permettrai
une courte digression sur la langue des hyménoptères.
En parcourant le généra de M.' Fabricius, on est étonné de
voir que cet auteur ait refusé d’accorder une langue à un très-grand
nombre d’hyménoptères, et on se demande à l’instant: est-il bien vrai
qu’ils en aient été réellement prives.? Pour éclaircir ce doute, on
consulte la nature, et elle répond que tous ces petits animaux ont reçu
en partage une langue plus courte ou plus longue, selon les usages
auxquels cette partie avait été destinée; alors on cherche ce que
M.r Fabricius a entendu par ces mots lèvre et langue, et on ne tarde
pas à s’apercevoir qu’il a prêté au moins à l’équivoque en ne voulant
accorder la dénomination de langue qu’à un corps alongé dont il ne
fixe pas les limites, et susceptible d’inflexions; ainsi il avait d abord
refusé de donner une langue aux guêpes; ensuite il en a donne
une à toutes, hormis aux polistes, qui, à mon avis, en ont une tout
aussi bien organisée que celle des autres guêpes.
Nota. Ce genre a été établi sur l’inspection de 155 individus, tant mâles que femelles.