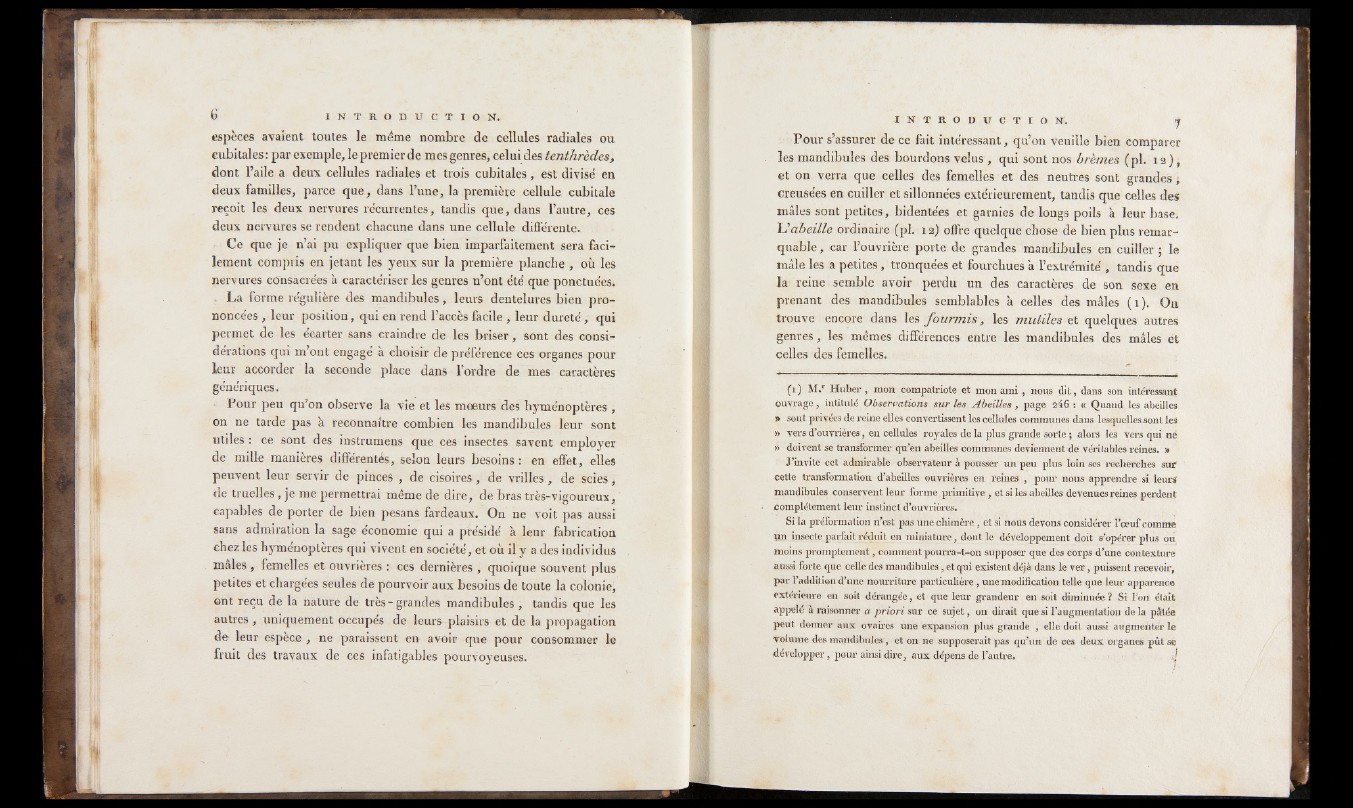
espèces avaient toutes le même nombre de cellules radiales ou
cubitales: par exemple, le premier de mes genres, celui des tenthrèdes,
dont l’aile a deux cellules radiales et trois cubitales, est divise' en
deux familles, parce que, dans l’une, la première cellule cubitale
reçoit les deux nervures récurrentes, tandis que, dans l’autre, ces
deux nervures se rendent chacune dans une cellule différente.
Ce que je n’ai pu expliquer que bien imparfaitement sera facilement
compris en jetant les yeux sur la première planche , où les
nervures consacrées à caractériser les genres n’ont été que ponctuées.
La forme régulière des mandibules, leurs dentelures bien prononcées
, leur position, qui en rend l’accès facile , leur dureté, qui
permet de les écarter sans craindre de les briser, sont des considerations
qui m’ont engagé à choisir de préférence ces organes pour
leur accorder la seconde place dans l’ordre de mes caractères
génériques.
Pour peu qu’on observe la vie et les moeurs des hyménoptères ,
on ne tarde pas à reconnaître combien les mandibules leur sont
utiles : ce sont des instrumens que ces insectes savent employer
de mille manières différentés, selon leurs besoins : en effet, elles
peuvent leur servir de pinces , de cisoires , de vrilles, de scies,
de truelles, je me permettrai même de dire, de bras très-vigoureux,
capables de porter de bien pesans fardeaux. On ne voit pas aussi
sans admiration la sage économie qui a présidé à leur fabrication
chez les hyménoptères qui vivent en société, et où il y a des individus
males, femelles et ouvrières : ces dernières , quoique souvent plus
petites et chargées seules de pourvoir aux besoins de toute la colonie,
©nt reçu de la nature de très-grandes mandibules , tandis que les
autres, uniquement occupés de leurs plaisirs et de la propagation
de leur espèce , ne paraissent en avoir que pour consommer le
fruit des travaux de ces infatigables pourvoyeuses.
Pour s’assurer de ce fait intéressant, qu’on veuille bien comparer
les mandibules des bourdons velus , qui sont nos brèmes ( pl. 12),
et on verra que celles des femelles et des neutres sont grandes ;
creusées en cuiller et sillonnées extérieurement, tandis que celles des
mâles sont petites, bidentées et garnies de longs poils à leur base.
L ’abeille ordinaire (pl. 12) offre quelque chose de bien plus remarquable
, car l’ouvrière porte de grandes mandibules en cuiller ; le
mâle les a petites , tronquées et fourchues à l’extrémité , tandis que
la reine.semble avoir perdu un des caractères de son sexe en
prenant des mandibules semblables à celles des mâles (1). On
trouve encore dans les fourmis , les mutiles et quelques autres
genres, les mêmes différences entre les mandibules des mâles et
celles des femelles.
(1 ) M.r H u b e r , mon compatriote et mon ami , nous d it, dans son intéressant
ouvrage, intitulé Observations sur les Abeilles , page 246 : « Quand les abeilles
» sont privées de reine elles convertissent les cellules communes dans lesquelles sont les
» vers d’ouvrières, en cellules royales de la plus grande sorte 5 alors les vers qui né
» doivent se transformer qu’en abeilles communes deviennent de vérilables reines. »
J’invite cet admirable observateur à pousser un peu plus loin scs recherches suif
cette transformation d’abeilles ouvrières en reines , pour nous apprendre si leurtf
mandibules conservent leur forme primitive, et si les abeilles devenues reines perdent
complètement leur instinct d’ouvrières.
Si la préformation n’est pas une chimère, et si nous devons considérer l’oeuf comme
un insecteparfaitréduit en miniature, dont le développement doit s’opérer plus ou
moins promptement, comment pourra-t-on supposer que des corps d’une contexture
aussi forte que celle des mandibules, et qui existent déjà dans le v e r , puissent recevoir,
par l ’addition d’une nourriture particulière , une modification telle que leur apparence
extérieure en soit dérangée, et que leur grandeur en soit diminuée ? Si l’on était
appelé à raisonner a p riori sur ce sujet, on dirait que si l ’augmentation de la pâtée
peut donner aux ovaires une expansion plus grande , elle doit aussi augmenter le
volume des mandibules, et on ne supposerait pas qu’un de ces deux organes pût se
développer, pour ainsi dire, aux dépens de l ’autre. g . . sj