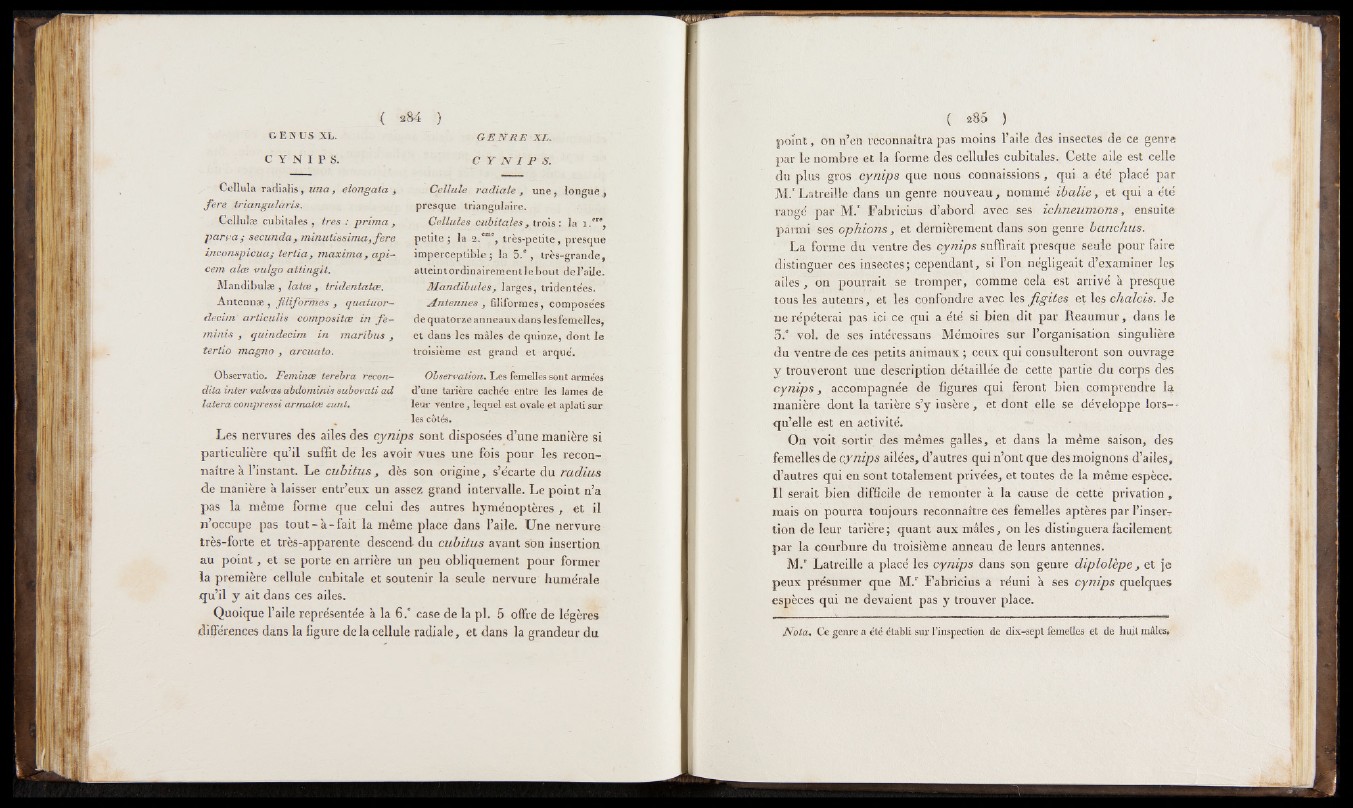
GENUS XL. GENRE XL.
C Y N I P S. C Y N I P S.
Cellula radialis, una, elongata >
fere triangularis.
Ccllulas cubitales , tres : prima ,
parva; secunda, minutissima,fere
inconspicua; tertia, maxima, api-
cem alee vulgo attingit.
Mandibulae , latce , tridentatce.
Antennae , filiformes , quatuor-
decim articulis compositce in f e -
minis , quindecim in maribus ,
tertio magno , arcuato.
Cellule radiale , u n e , longue,,
presque triangulaire.
Cellules cubitales, trois: la 1 . " ',
petite ; la 2.'“ ', très-petite, presque
imperceptible; la 5. ' , très-grande,
atteint ordinairement 1 e bout del’aile.
Mandibules, larges, tridente'es.
Antennes , filiformes, composées
de quatorze anneaux dans lesfemelles,
et dans les mâles de quinze, dont le
troisième est grand et arque.
Observatio. Femince terebra rècon- Observation. Les femelles sont armées
dita inter valvas abdominis subovati ad d’une tarière cachée entre les lames de
latera compressi armatæ sunt. leur rentre, lequel est orale et aplati sur
les cotés.
Les nervures des ailes des cynips sont dispose’es d’une manière si
particulière qu’il suffit de les avoir vues une fois pour les reconnaître
à l’instant. Le cubitus, dès son origine, s’écarte du radius
de manière à laisser entr’eux un assez grand intervalle. Le point n’a
pas la même forme que celui des autres hyménoptères , et il
n’occupe pas tout - à - fait la même place dans l’aile. Une nervure
très-forte et très-apparente descend du cubitus avant son insertion
au point, et se porte en arrière un peu obliquement pour former
la première cellule cubitale et soutenir la seule nervure humérale
qu’il y ait dans ces ailes.
Quoique l’aile représentée à la 6.” case de la pl. 5 offre de légères
différences dans la figure de la cellule radiale, et dans la grandeur du
point, on n’en reconnaîtra pas moins l'aile des insectes de ce genre
par le nombre et la forme des cellules cubitales. Cette aile est celle
du plus gros cynips que nous connaissions, qui a. été placé par
M.'Latreille dans un genre nouveau, nommé ibalie, et qui a été
rangé par M.r Fabricius d’abord avec ses ichneumons, ensuite
parmi ses opfiions, et dernièrement dans son genre banchus.
La forme du ventre des cynips suffirait presque seule pour faire
distinguer ces insectes; cependant, si l’on négligeait d’examiner les
ailes , on pourrait se tromper, comme cela est arrivé à presque
tous les auteurs, et les confondre avec les figites et les chalcis. Je
ne répéterai pas ici ce qui a été si bien dit par Reaumur, dans le
3.' vol. de ses intéressans Mémoires sur l’organisation singulière
du ventre de ces petits animaux ; ceux qui consulteront son ouvrage
y trouveront une description détaillée de cette partie du corps des
cynips, accompagnée de figures qui feront bien comprendre la
manière dont la tarière s’y insère , et dont elle se développe lors-»
qu’elle est en activité.
On voit sortir des mêmes galles, et dans la même saison, des
femelles de cynips ailées, d’autres qui n’ont que des moignons d’ailes,
d’autres qui en sont totalement privées, et toutes de la même espèce.
Il serait bien difficile de remonter à la cause de cette pri vation ,
mais on pourra toujours reconnaître ces femelles aptères par l’inserr
tion de leur tarière; quant aux mâles, on les distinguera facilement
par la courbure du troisième anneau de leurs antennes.
M.r Latreille a placé les cynips dans son genre diplolèpe, et je
peux présumer que M.r Fabricius a réuni à ses cynips quelques
espèces qui ne devaient pas y trouver place.