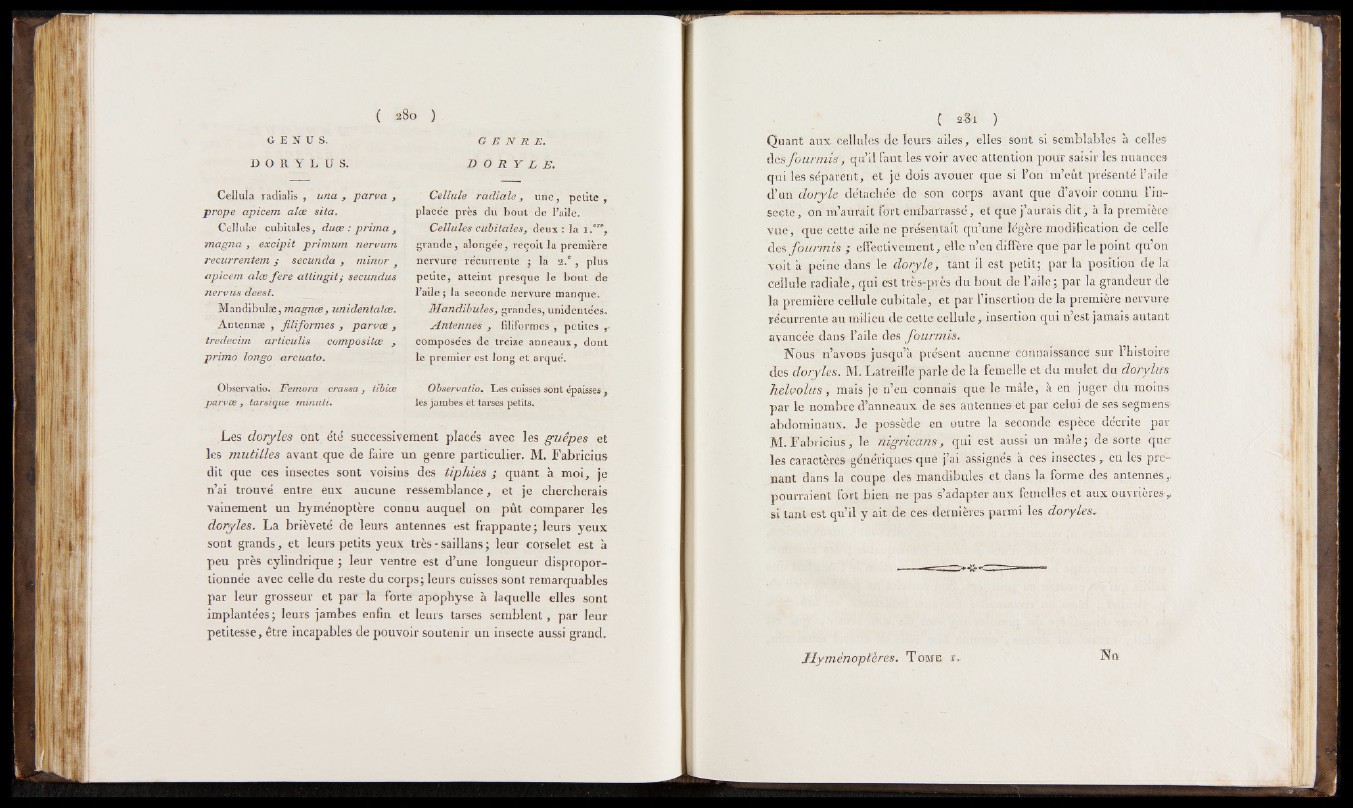
G E N" U S.
D O R Y L U S.
Cellula radialis , una , parva ,
p rope apicem aloe sila.
Cellulæ cubitales, duce : prima ,
magna, excipit primum nervum
recurrentem y secunda , minor
apicem aloe fere attingily secundus
nervus deest.
Mandibulæ, magnoe, unidèntatoe.
Antennee , filiformes , parvoe ,
tredecim articulis compositoe ,
primo longo arcuato.
Observatio. Femora crassa, tibiae
parvoe , tarsique minuti.
GENRE.
D O R Y L E.
Cellule radiale, u n e , petite ,
place'e près du bout de l ’aile.
Cellules cubitales, deux : la X.°r%
grande, alonge’e , reçoit la première
nervure re'currente ; la 2.“ , plus
petite, atteint presque le bout de
l ’aile; la seconde nervure manque.
Mandibules, grandes, unidentees.
Antennes , filiformes , petites r
compose'es de treize anneaux, dont
le premier est long et arque.
Observatio. Les cuisses sont épaisses ,
les jambes et tarses petits.
Les doryles ont été successivement places avec les guêpes et
les mutilles avant que de faire un genre particulier. M. Fabricius
dit que ces insectes sont voisins des tiphies ; quant à moi, je
n’ai trouvé entre eux aucune ressemblance, et je chercherais
vainement un byménoptère connu auquel on pût comparer les
doryles. La brièveté de leurs antennes est frappante ; leurs yeux
sont grands, et leurs petits yeux très - saillans ; leur corselet est à
peu près cylindrique ; leur ventre est d’une longueur disproportionnée
avec celle du reste du corps; leurs cuisses sont remarquables
par leur grosseur et par la forte apophyse à laquelle elles sont
implantées; leurs jambes enfin et leurs tarses semblent, par leur
petitesse, être incapables de pouvoir soutenir un insecte aussi grand.
Quant aux cellules de leurs ailes, elles sont si semblables à celles
Aesfourmis, qu’il faut les voir avec attention pour saisir les nuances
qui les séparent, et je' dois avouer que si l’on m’eût présenté l’aile
d’un doryle détachée de son corps avant que d’avoir connu l’insecte
, on m’aurait fort embarrassé, et que j’aurais dit, à la première
vue, que cette aile ne présentait qu’une légère modification de celle
des fourmis ; effectivement, elle n’en diffère que par le point qu’on
voit h peine dans le doryle, tant il est petit; par la position de la
cellule radiale, qui est très-prés du bout de l’aile; par la grandeur de
la première cellule cubitale, et par l’insertion de la première nervure
récurrente au milieu de cette cellule , insertion qui n’est jamais autant
avancée dans l’aile des fourmis.
Nous n’avons jusqu’à présent aucune connaissance' sur l’histoire
des doryles. M. Latreifle parle de la femelle et du mulet du dorylus
helvolus, mais je n’en connais que le mâle, à en juger du moins
par le nombre d’anneaux de ses antennes et par celui de ses segmens
abdominaux. Je possède en outre la seconde espèce décrite par
M. Fabricius, le nigricans, qui est aussi un mâle; de sorte que
les caractères génériques que j’ai assignés a ces insectes, en les prenant
dans la coupe des mandibules et dans la forme des antennes,,
pourraient fort bien ne pas s’adapter aux femelles et aux ouvrières-,
si tant est qu’il y ait de ces dernières parmi les doryles,
Hym énop tèr es . T om e r . Nu