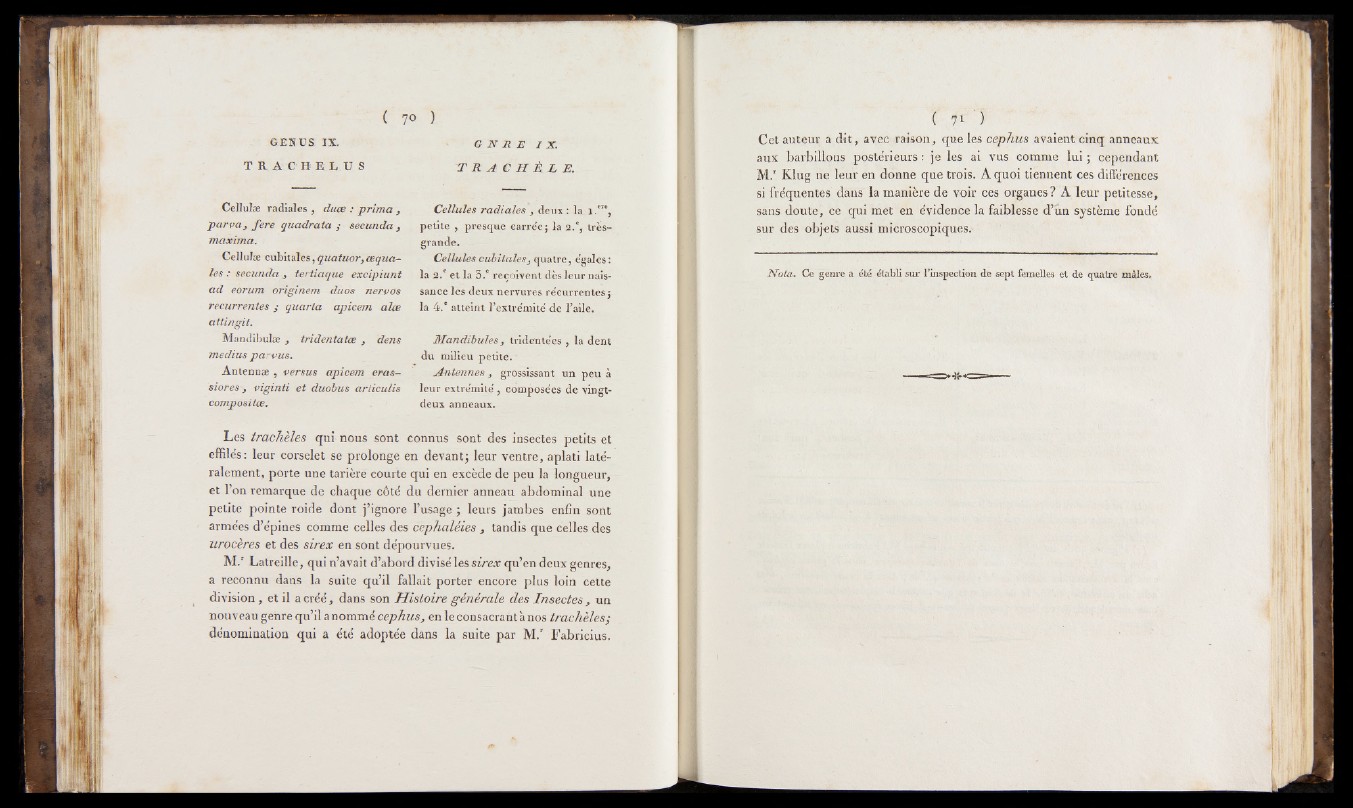
T R A C H E L U S
G N R E I X .
T R A C H È L E.
Cellulæ radiales , duce : prima ,
parva, fere quadraia ; secunda ,
maxima.
Cellulæ cubitales, quatuor, cequates
: secunda , tertiaque excipiunt
ad eorum originem duos nervos
récurrentes ,• quarta apicem alce
attingit.
Mandibulæ , tridentatoe , dens
médius parvus.
Anterraæ , versus apicem eras—
siores, viginti et duobus articulis
composiice.
Cellules radiales , deux : la l
petite , presque carréej la a.", trës-
grande.
Cellules cubitales, quatre, e’gales :
la a. et la 3.“ reçoivent dès leur naissance
les deux nervures récurrentes j
la 4.' atteint l ’extre’mité de l ’aile.
Mandibules, tridente’es , la dent
du milieu petite.
Antennes, grossissant un peu à
leur extre'mite’ , composées de vingt-
deux anneaux.
Les i(rachètes qui nous sont connus sont des insectes petits et
effilés: leur corselet se prolonge en devant; leur ventre, aplati latéralement,
porte une tarière courte qui en excède de peu la longueur,
et l’on remarque de chaque côté du dernier anneau abdominal une
petite pointe roide dont j’ignore l’usage ; leurs jambes enfin sont
armées d’épines comme celles des cephaléies , tandis que celles des
urocères et des sir ex en sont dépourvues.
M.r Latreille, qui n’avait d’abord divisé les sir ex qu’en deux genres,
a reconnu dans la suite qu’il fallait porter encore plus loin cette
division, et il a créé, dans son Histoire générale des Insectes, un
nouveau genre qu’il a nommé cephus, en le consacrant à nos trachèles;
dénomination qui a été adoptée dans la suite par M.r Fabricius.
( 71 )
Cet auteur a dit, avec raison, que les cephus avaient cinq anneaux;
aux barbillons postérieurs : je les ai vus comme lui ; cependant
M.r Klug ne leur en donne que trois. A quoi tiennent ces différences
si fréquentes dans la manière de voir ces organes ? A leur petitesse,
sans doute, ce qui met en évidence la faiblesse d’un système fondé
sur des objets aussi microscopiques.^
Nota. Ce genre a été établi sur l’inspection de sept femelles et de quatre mâles.