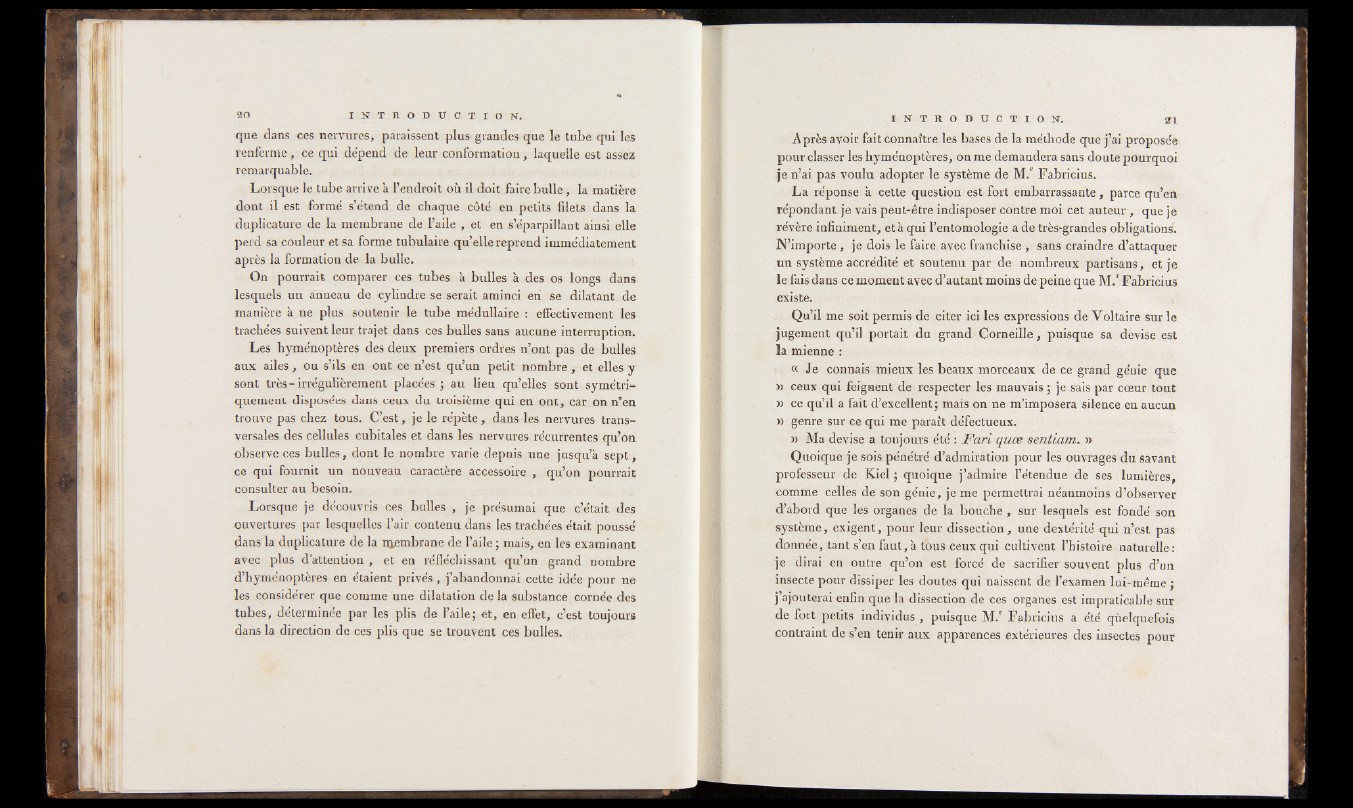
que dans ces nervures, paraissent plus grandes que le tube qui les
renferme, ce qui dépend de leur conformation, laquelle est assez
remarquable.
Lorsque le tube arrive à l’endroit où il doit faire bulle, la matière
dont il est formé s’étend de chaque côté en petits filets dans la
duplicature de la membrane de l’aile , et en s’éparpillant ainsi elle
perd sa couleur et sa forme tubulaire qu’elle reprend immédiatement
après la formation de la bulle.
On pourrait comparer ces tubes à bulles à des os longs dans
lesquels un anneau de cylindre se serait aminci en se dilatant de
manière à ne plus soutenir le tube médullaire : effectivement les
trachées suivent leur trajet dans ces bulles sans aucune interruption.
Les hyménoptères des deux premiers ordres n’ont pas de bulles
aux ailes, ou s’ils en ont ce n’est qu’un petit nombre, et elles y
sont très-irrégulièrement placées ; au lieu qu’elles sont symétriquement
disposées dans ceux du troisième qui en ont, car on n’en
trouve pas chez tous. C’est, je le répète, dans les nervures transversales
des cellules cubitales et dans les nervures récurrentes qu’on
observe ces bulles, dont le nombre varie depuis une jusqu’à sept,
ce qui fournit un nouveau caractère accessoire , qu’on pourrait
consulter au besoin.
Lorsque je découvris ces bulles , je présumai que c’était des
ouvertures par lesquelles l’air contenu dans les trachées était poussé
dans la duplicature de la njcmbrane de l’aile ; mais, en les examinant
avec plus d’attention , et en réfléchissant qu’un grand nombre
d’hyménoptères en étaient privés, j’abandonnai cette idée pour ne
les considérer que comme une dilatation de la substance cornée des
tubes, déterminée par les plis de l’aile; et, en effet, c’est toujours
dans la direction de ces plis que se trouvent ces bulles.
Après avoir fait connaître les bases de la méthode que j’ai proposée
pour classer les hyménoptères, on me demandera sans doute pourquoi
<je n’ai pas voulu adopter le système de M.' Fabricius.
La réponse à cette question est fort embarrassante, parce qu’en
répondant je vais peut-être indisposer contre moi cet auteur, que je
révère infiniment, et à qui l’entomologie a de très-grandes obligations.
N’importe , je dois le faire avec franchise , sans craindre d’attaquer
un système accrédité et soutenu par de nombreux partisans, et je
le fais dans ce moment avec d’autant moins de peine que M.r Fabricius
existe.
Qu’il me soit permis de citer ici les expressions de Voltaire sur le
jugement qu’il portait du grand Corneille, puisque sa devise est
la mienne :
« Je connais mieux les beaux morceaux de ce grand génie que
» ceux qui feignent de respecter les mauvais ; je sais par coeur tout
» ce qu’il a fait d’excellent ; mais on ne m’imposera silence en aucun
» genre sur ce qui me parait défectueux.
» Ma devise a toujours été : Fari quoe sentiam. »
Quoique je sois pénétré d’admiration pour les ouvrages du savant
professeur de Kiel ; quoique j’admire l’étendue de ses lumières,
comme celles de son génie, je me permettrai néanmoins d’observer
d’abord que les organes de la bouche, sur lesquels est fondé son
système, exigent, pour leur dissection, une dextérité qui n’est pas
donnée, tant s’en faut, à tous ceux qui cultivent l’histoire naturelle:
je dirai en outre qu’on est forcé de sacrifier souvent plus d’un
insecte pour dissiper les doutes qui naissent de l’examen lui-même ;
j’ajouterai enfin que la dissection de ces organes est impraticable sur
de fort petits individus , puisque M.r Fabricius a été quelquefois
contraint de s’en tenir aux apparences extérieures des insectes pour