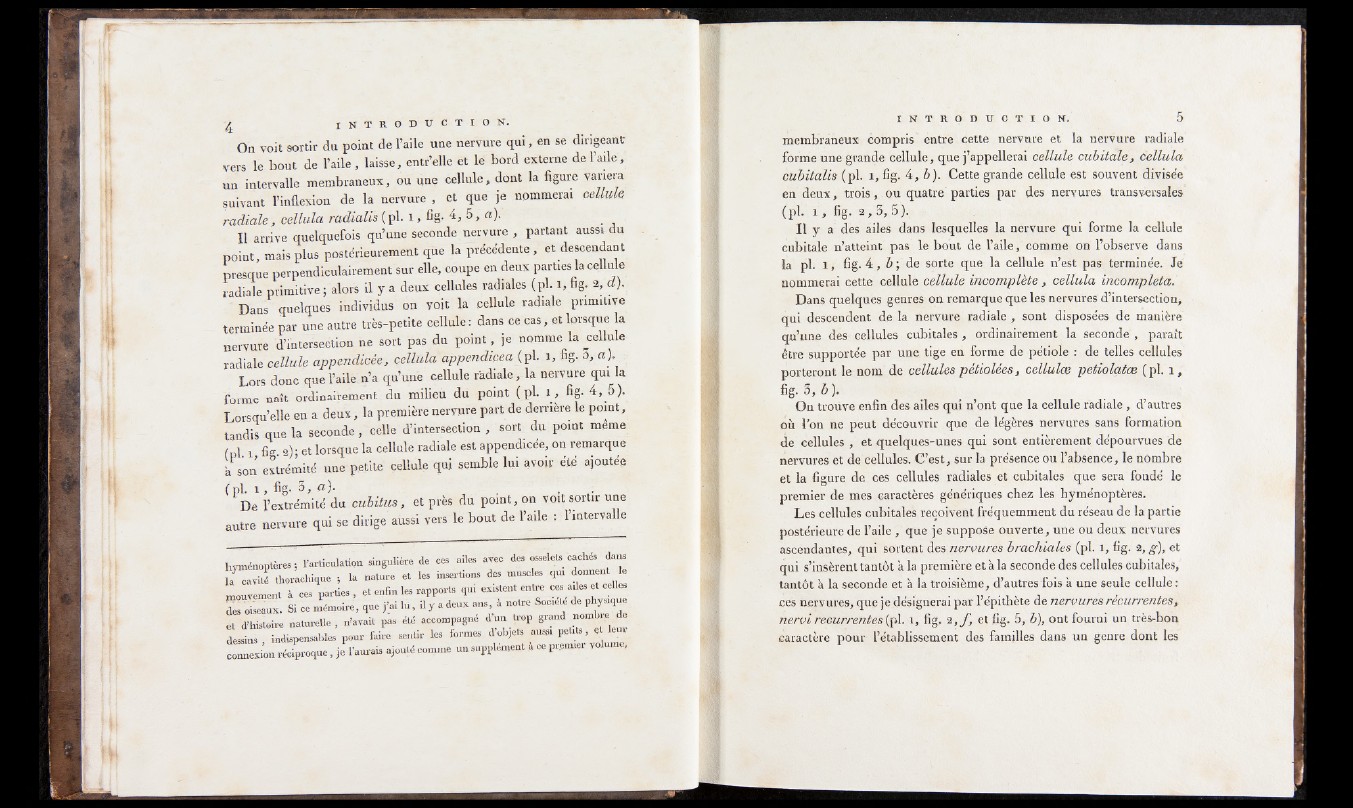
On voit sortir dn point, de l’aile une nervure qui, eu se dirigeant
vers le bout de l’aile, laisse, entr’elle et le bord externe de 1 aile,
un intervalle membraneux, ou une cellule, dont la figure variera
suivant l’inflexion de la nervure , et que je nommera! cellule
radiale, cellula radialis (pl. 1 , fig. 4, 5 , a).
Il arrive quelquefois qu’une seconde nervure , partant aussi du
point, mais plus postérieurement que la précédente , et descendant
presque perpendiculairement sur elle, coupe en deux parties la cellule
radiale primitive; alors il y a deux cellules radiales (pl. i, fig« 2, d).
Dans quelques individus on voit la cellule radiale primitive
terminée par une autre très-petite cellule: dans ce cas, et lorsque la
nervure d’intersection ne sort pas du point, je nomme la ^cellule
radiale cellule appendicée, cellula appendiçea ( pl. I, fig. d, a).
Lors donc que l’aile n’a qu’une cellule radiale, la nervure qui la
forme naît ordinairement du milieu du point (pl. i , fig- 4 , 5).
Lorsqu’elle en a deux, la première nervure part de derrière le point,
tandis que la seconde, celle d’intersection , sort du point meme
(pl. i fig. 2); et lorsque la cellule radiale est appendicée, on remarque
à son extrémité une petite cellule qui semble lui avoir ete ajoutée
(pl. î , fig. 3, a).
De l’extrémité du cubitus, et près du point, on voit sortir une
autre nervure qui se dirige aussi vers le bout de l’aile : l’intervalle
hyménoptères; l’articulation singulière de ces ades avec des osselets cachés dans
C a v i t é thorachique ; la nature et les insertions des muscles qui donnent le
mouvement à ces parties , et enfin les rapports qui existent entre ces ailes et celles
des oiseaux. Si ce mémoire, que j’ai lu , il y a deux ans, à notre Société de physiqu
et d’histoire naturelle , n’avait pas été accompagné dun trop grand nombre d
dessins , indispensables pour faire sentir les formes d’objets aussi petits, 1 leur
connexion réciproque, je l’aurais ajouté comme un supplément a ce piemiei yo u ,
membraneux compris entre cette nervure et la nervure radiale
forme une grande cellule, que j’appellerai cellule cubitale, cellula
cubitalis (pl. î, fig. 4, b). Cette grande cellule est souvent divisée
en deux, trois, ou quatre parties par des nervures transversales
(pl. î , fig. 2 , 3, 5 ),
Il y a des ailes dans lesquelles la nervure qui forme la cellule
cubitale n’atteint pas le bout de l’aile, comme on l’observe dans
la pl. 1, fig. 4 , 6; de sorte que la cellule n’est pas terminée. Je
nommerai cette cellule cellule incomplète, cellula incompleta.
Dans quelques genres on remarque que les nervures d’intersection,
qui descendent de la nervure radiale, sont disposées de manière
qu’une des cellules cubitales , ordinairement la seconde , paraît
être supportée par une tige en forme de pétiole : de telles cellules
porteront le nom de cellules pétiolées, celluloe petiolatoe (pl. î ,
fig. 3, b ).
On trouve enfin des ailes qui n’orit que la cellule radiale, d’autres
où l ’on ne peut découvrir que de légères nervures sans formation
de cellules , et quelques-unes qui sont entièrement dépourvues de
nervures et de cellules. C’est, sur la présence ou l’absence, le nombre
et la figure de ces cellules radiales et cubitales que sera fondé le
premier de mes caractères génériques chez les hyménoptères.
Les cellules cubitales reçoivent fréquemment du réseau de la partie
postérieure de l’aile , que je suppose ouverte, une ou deux nervures
ascendantes, qui sortent des nervures brachiales (pl. 1, fig. 2, g), et
qui s’insèrent tantôt à la première et à la seconde des cellules cubitales,
tantôt à la seconde et à la troisième, d’autres fois a une seule cellule:
ces nervures, que je désignerai par l’épithète de nervures récurrentes,
nervi récurrentes (pl. i, fig, 2, f , et fig. 5, b), ont fourni uu très-bon
caractère pour l’établissement des familles dans un genre dont les