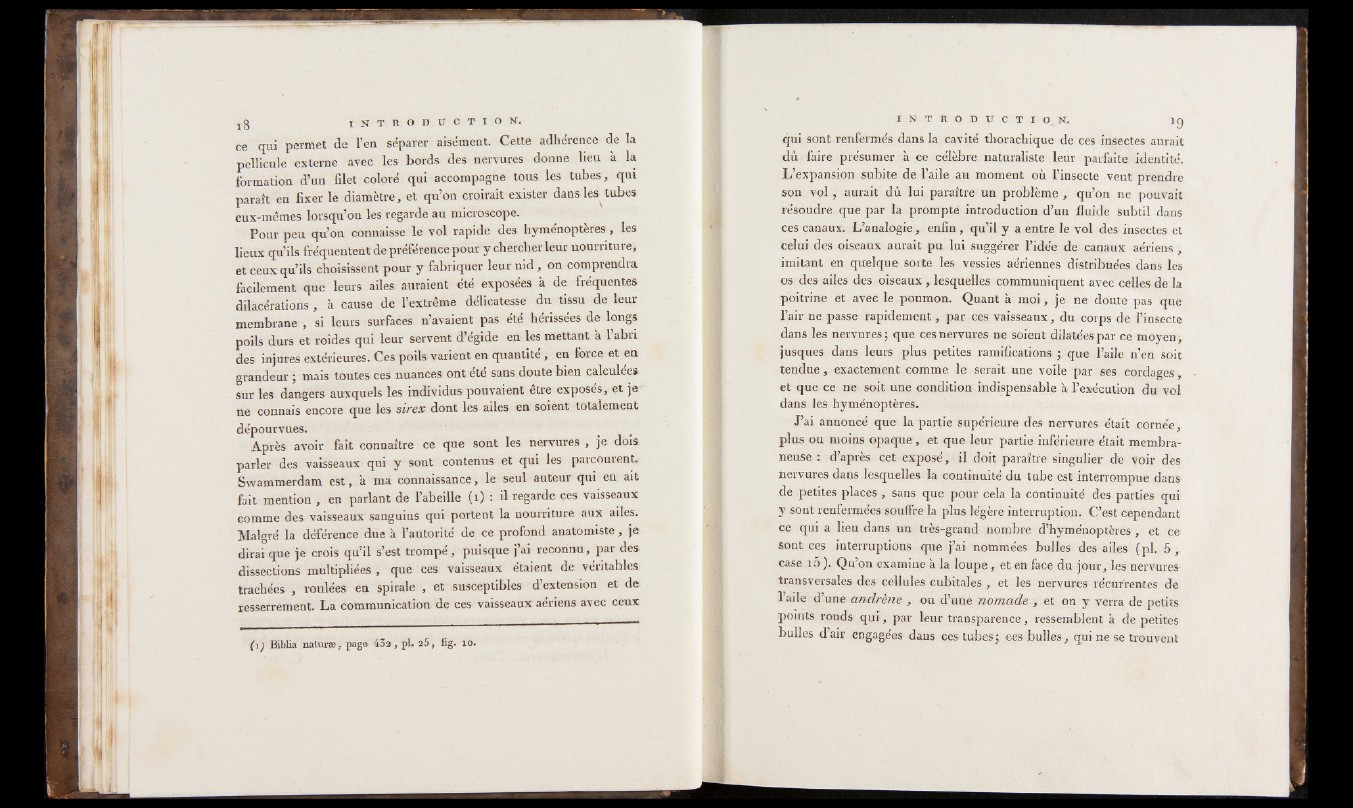
ce qui permet de l’en séparer aisément. Cette adhérence de la
pellicule externe avec les bords des nervures donne lieu à la
formation d’un filet coloré qui accompagne tous les tubes, qui
parait en fixer le diamètre, et qu’on croirait exister dans les^ tubes
eux-mêmes lorsqu’on les regarde au microscope.
Pour peu qu’on connaisse le vol rapide des hyménoptères, les
lieux qu’ils fréquentent de préférence pour y chercher leur nourriture,
et ceux qu’ils choisissent pour y fabriquer leur nid , on comprendra
facilement que leurs ailes auraient été exposées k de fréquentes
dilacérations, à cause de l’extrême délicatesse du tissu de leur
membrane , si leurs surfaces n’avaient pas été hérissées de longs
poils durs et roides qui leur servent d’égide en les mettant k l’abri
des injures extérieures. Ces poils varient en quantité , en force et en
grandeur ; mais toutes ces nuances ont été sans doute bien calculées
sur les dangers auxquels les individus pouvaient être exposes, et je
ne connais encore que les sirex dont les ailes en soient totalement
dépourvues.
Après avoir fait connaître ce que sont les nervures , je dois
parler des vaisseaux qui y sont contenus et qui les parcourent.
Swammerdam est, a ma connaissance, le seul auteur qui en ait
fait mention , en parlant de l’abeille (1) : il regarde ces vaisseaux
comme des vaisseaux sanguins qui portent la nourriture aux ailes.
Malgré la déférence due k l’autorité de ce profond anatomiste, je
dirai que je crois qu’il s’est trompé, puisque j’ai reconnu, par des
dissections multipliées , que ces vaisseaux étaient de véritables
trachées , roulées en spirale , et susceptibles d’extension et de
resserrement. La communication de ces vaisseaux aeriens avec ceux
( i ) Biblia naturæ, page 43a , pl. 25, fig. 10.
qui sont renfermés dans la cavité thorachique de ces insectes aurait
dû faire présumer k ce célèbre naturaliste leur parfaite identité.
L ’expansion subite de l’aile au moment où l’insecte veut prendre
son v o l, aurait du lui paraître un problème , qu’on ne pouvait
résoudre que par la prompte introduction d’un fluide subtil dans
ces canaux. L’analogie, enfin , qu’il y a entre le vol des insectes et
celui des oiseaux aurait pu lui suggérer l’idée de canaux aériens ,
imitant en quelque sorte les vessies aériennes distribuées dans les
os des ailes des oiseaux , lesquelles communiquent avec celles de la
poitrine et avee le poumon. Quant k moi, je ne doute pas que
l’air ne passe rapidement, par ces vaisseaux, du corps de l’insecte
dans les nervures; que ces nervures ne soient dilatées par ce moyen,
jusques dans leurs plus petites ramifications ; que l’aile n’en soit
tendue, exactement comme le serait une voile par ses cordages
et que ce ne soit une condition indispensable k l’ex-écution du vol
dans les hyménoptères.
J’ai annoncé que la partie supérieure des nervures était cornée,
plus ou moins opaque, et que leur partie inférieure était membraneuse
: d’après cet exposé, il doit paraître singulier de voir des
nervures dans lesquelles la continuité du tube est interrompue dans
de petites places , sans que pour cela la continuité des parties qui
y sont renfermées souffre la plus légère interruption. G’est cependant
ce qui a lieu dans un très-grand nombre d’hyménoptères ,, et ce
sont ces interruptions que j’ai nommées bulles des ailes ( pl. 5 ,
case i 5). Qu’on examine k la loupe, et en face du jour, les nervures:
transversales des cellules cubitales, et les nervures récurrentes de
l’aile d’une andrène , ou d’une nomade , et on y verra de petits
points ronds qui, par leur transparence, ressemblent k de petites
bulles d’air engagées dans ces tubes ; ces bulles, qui ne se trouvent