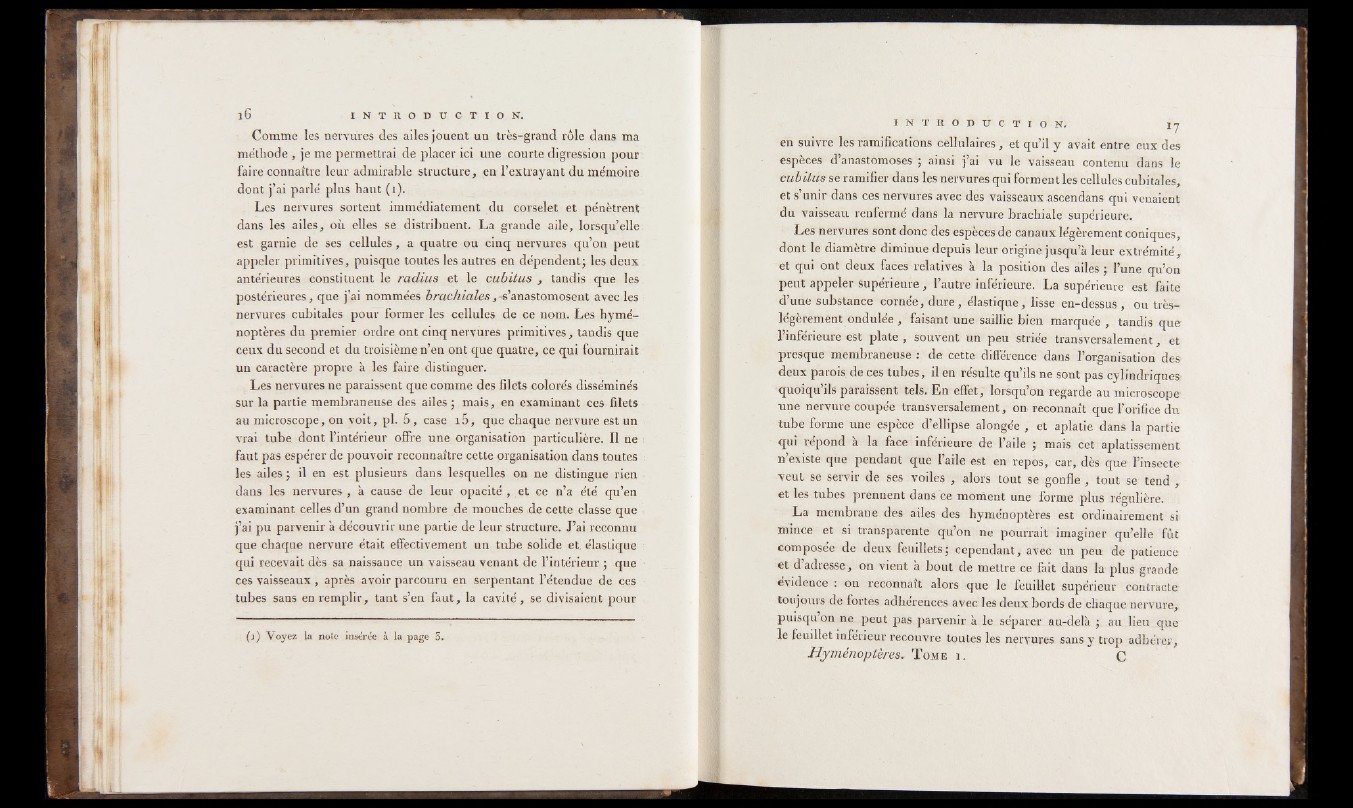
Comme les nervures des ailes jouent un très-grand rôle dans ma
méthode , je me permettrai de placer ici une courte digression pour
faire connaître leur admirable structure, en l’extrayant du mémoire
dont j’ai parlé plus haut (t).
Les nervures sortent immédiatement du corselet et pénètrent
dans les ailes, où elles se distribuent. La grande aile, lorsqu’elle
est garnie de ses cellules, a quatre ou cinq nervures qu’on peut
appeler primitives, puisque toutes les autres en dépendent; les deux
antérieures constituent le radius et le cubitus , tandis que les
postérieures, que j’ai nommées brachiales , «s’anastomosent avec les
nervures cubitales pour former les cellules de ce nom. Les hyménoptères
du premier ordre ont cinq nervures primitives, tandis que
ceux du second et du troisième n’en ont que quatre, ce qui fournirait
un caractère propre à les faire distinguer.
Les nervures ne paraissent que comme des filets colorés disséminés
sur la partie membraneuse des ailes; mais, en examinant ces filets
au microscope, on voit, pl. 5 , case i 5, que chaque nervure est un
vrai tube dont l’intérieur offre une organisation particulière. Il ne
faut pas espérer de pouvoir reconnaître cette organisation dans toutes
les ailes ; il en est plusieurs dans lesquelles on ne distingue rien
dans les nervures, à cause de leur opacité, et ce n’a été qu’en
examinant celles d’un grand nombre de mouches de cette classe que
j’ai pu parvenir à découvrir une partie de leur structure. J’ai reconnu
que chaque nervure était effectivement un tube solide et, élastique
qui recevait dès sa naissance un vaisseau venant de l’intérieur ; que
ces vaisseaux , après avoir parcouru en serpentant l’étendue de ces
tubes sans en remplir, tant s’en faut, la cavité, se divisaient pour
( j) Voyez la note insérée à la page 5.
en suivre les ramifications cellulaires, et qu’il y avait entre eux des
especes d’anastomoses ; ainsi j’ai vu le vaisseau contenu dans le
cubitus se ramifier dans les nervures qui forment les cellules cubitales,
et s’unir dans ces nervures avec des vaisseaux ascendans qui venaient
du vaisseau renfermé dans la nervure brachiale supérieure.
Les nervures sont donc des espèces de canaux légèrement coniques,
dont le diamètre diminue depuis leur origine jusqu’à leur extrémité,
et qui ont deux faces relatives à la position des ailes ; l’une qu’on
peut appeler supérieure, l’autre inférieure. La supérieure est faite
d’une substance cornée, dure , élastique, lisse en-dessus , ou très-
légèrement ondulée , faisant une saillie bien marquée, tandis que
l’inférieure est plate , souvent un peu striée transversalement, et
presque membraneuse : de cette différence dans l’organisation des
deux pai ois de ces tubes, il en resuite qu ils ne sont pas cylindriques
quoiqu’ils paraissent tels. En effet, lorsqu’on regarde au microscope
une nervure coupée transversalement, on reconnaît que l’orifice du
tube forme une espèce d’ellipse alongée , et aplatie dans la partie
qui répond a la face inferieure de l’aile ; mais cet aplatissement
n existe que pendant que l’aile est en repos, car, dès que- l’insecte'
veut se servir de ses voiles , alors tout se gonfle , tout se tend ,
et les tubes prennent dans ce moment une forme plus régulière.
La membrane des ailes des hyménoptères est ordinairement si
mince et si transparente qu’on ne pourrait imaginer qu’elle fût
composée de deux feuillets; cependant, avec un peu de patience
et d adiesse, on vient a bout de mettre ce fait dans la plus grande
evidence : on reconnaît alors que le feuillet supérieur contracte
toujours de fortes adhérences avec les deux bords de chaque nervure,
puisqu on ne peut pas parvenir à le séparer au-delà ; au lieu que
le feuillet inférieur recouvre toutes les nervures sans y trop adhérer,
Hyménoptères. T ome i . G