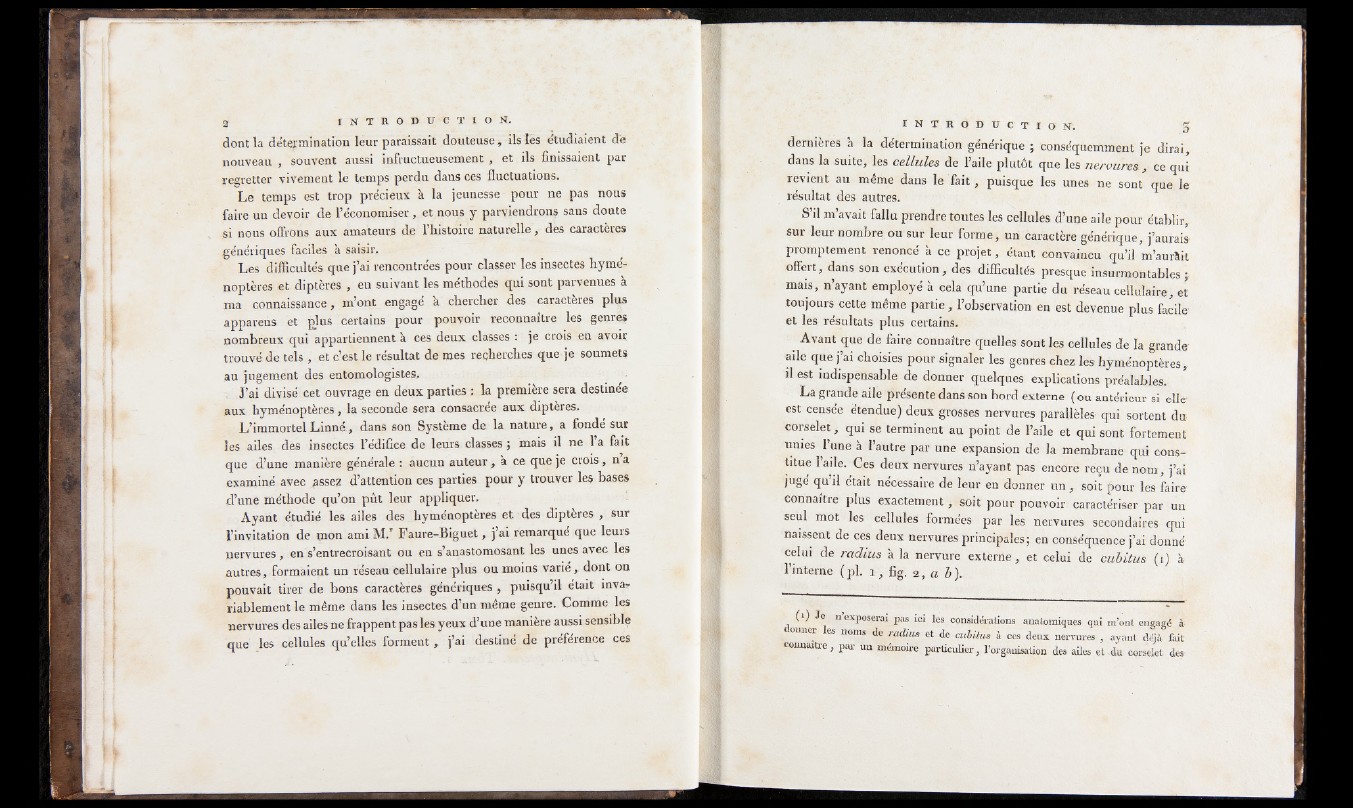
dont la détermination leur paraissait douteuse, ils les étudiaient de
nouveau , souvent aussi infructueusement , et ils finissaient par
regretter vivement le temps perdu dans ces fluctuations.
Le temps est trop précieux à la jeunesse pour ne pas nous
faire un devoir de l’économiser, et nous y parviendrons sans doute
si nous offrons aux amateurs de l’histoire naturelle, des caractères
génériques faciles à saisir.
Les difficultés que j’ai rencontrées pour classer les insectes hyménoptères
et diptères , en suivant les méthodes qui sont parvenues à
ma connaissance, m’ont engage a chercher des caractères plus
apparens et glus certains pour pouvoir reconnaître les genres
nombreux qui appartiennent à ces deux classes : je crois en avoir
trouvé de tels , et c’est le résultat de mes recherches que je soumets
au jugement des entomologistes.
J’ai divisé cet ouvrage en deux parties : la première sera destinée
aux hyménoptères, la seconde sera consacrée aux diptères.
L ’immortel Linné, dans son Système de la nature, a fonde sur
les ailes des insectes l’édifice de leurs classes j mais il ne la fait
que d’une manière générale : aucun auteur, à ce que je crois, n a
examiné avec assez d’attention ces parties pour y trouver les bases
d’une méthode qu’on pût leur appliquer.
Ayant étudié les ailes des hyménoptères et des diptères , sur
l’invitation de mon ami M.' Faure-Biguet, j’ai remarqué que leurs
nervures, en s’entrecroisant ou en s’anastomosant les unes avec les
autres, formaient un réseau cellulaire plus ou moins varié, dont on
pouvait tirer de bons caractères génériques , puisqu’il était invar
riablement le même dans les insectes d’un même genre. Comme les
nervures des ailes ne frappent pas les yeux d’une manière aussi sensible
que les cellules qu’elles forment , j’ai destiné de préférence ces
dernieres a la détermination generique ; conséquemment je dirai,
dans la suite, les cellules de l’aile plutôt que les nervures. | ce qui
revient au même dans le fa it, puisque les unes ne sont que le
résultat des autres.
S’il m’avait fallu prendre toutes les cellules d’une aile pour établir,
sur leur nombre ou sur leur forme, un caractère générique, j’aurais-
promptement renoncé à ce projet, étant convaincu qu’il m’aurait
offert, dans son exécution, des difficultés presque insurmontables
mais, n’ayant employé à cela qu’une partie du réseau cellulaire, et
toujours cette même partie, l’observation en est devenue plus facile-
et les résultats plus certains.
Avant que de faire connaître quelles sont les cellules de la grande
aile que j’ai choisies pour signaler les genres chez les hyménoptères,
il est indispensable de donner quelques explications préalables.
La grande aile présente dans son bord externe (ou antérieur si elle
est censée étendue) deux grosses nervures parallèles qui sortent du
corselet, qui se terminent au point de l’aile et qui sont fortement
unies l’une à l’autre par une expansion de la membrane qui constitue
l’aile. Ces deux nervures n’ayant pas encore reçu de nom, j’ai
juge quil était necessaire de leur en donner un, soit pour les faire
connaître plus exactement, soit pour pouvoir caractériser par un
seul mot les cellules formées par les nervures secondaires qui
naissent de ces deux nervures principales j en conséquence j’ai donné
celui de radius à la nervure extèrne, et celui de cubitus (i) à
l’interne (pl. 1 , fig. 2, a b).
(1) Je n exposerai pas ici les considérations anatomiques qui m’ont engagé à
onnei les noms de radius et de cubitus à ces deux nervures , ayant déjà fait
connaître, par. un mémoire particulier, l ’organisation des ailes et.du corselet des