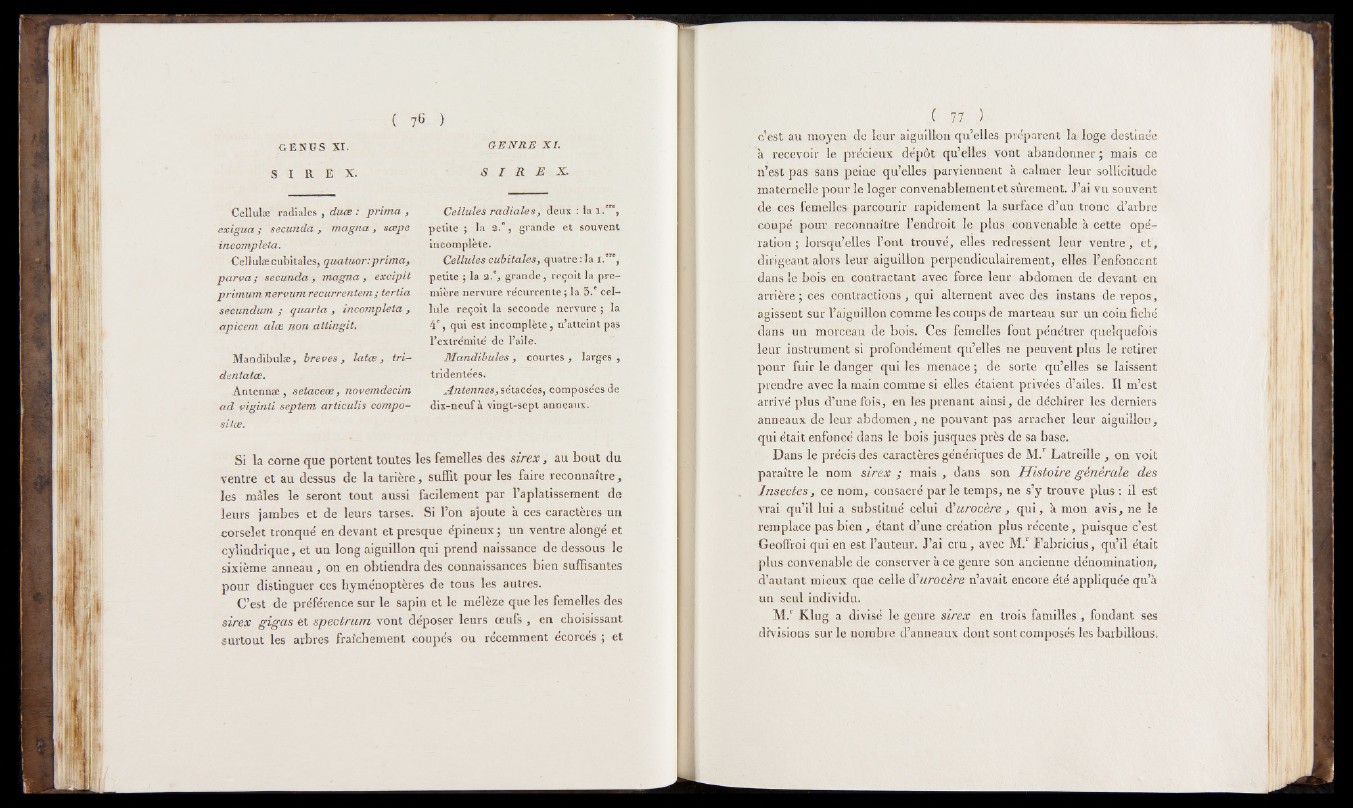
G E N U S XI. G E N R E XI .
S I R E X.
Cellulæ radiales , duce : p r im a ,
e x ig u a ,- secunda , magna , soepe
incompleta.
Cellulæ cubitales, qu a tu o r :p r im a ,
p a r v a ; s e c u n d a , m a g n a , e x c ip it
p r im um nervum recurrentern y tertia
seeundum ; q u a r ia , incompleta ,
apicem aloe n o n a ttingit.
Mandibulæ, b r e v e s , la toe , t r i -
dentatoe.
Antennæ, s e ta c eoe , novemdecim
a d v ig in ti septem a r ticu lis composites.
S I R E X .
C e llu le s r a d ia le s , deux : la l . ,
petite ; la 3.“ , grande et souvent
incomplète.
C e llu le s cu b ita le s , quatre : la i l , ' ,
petite ; la 3.% grande , reçoit la première
nervure re'currente ; la 5.' cellule
reçoit la seconde nervure ; la
4' , qui est incomplète, n’atteint pas
l ’extre'mité de l’aile.
M a n d ib u le s , courtes , larges ,
tridentées.
A n te n n e s , se'tace'es, compose'es de
dix-neuf à vingt-sept anneaux.
Si la corne que portent toutes les femelles des sirex, au bout du
ventre et au dessus de la tarière, suffit pour les faire reconnaître,
les mâles le seront tout aussi facilement par l’aplatissement de
leurs jambes et de leurs tarses. Si l’on ajoute à ces caractères un
corselet tronque' en devant et presque e'pineux ; un ventre alongé et
cylindrique, et un long aiguillon qui prend naissance de dessous le
sixième anneau, on en obtiendra des connaissances bien suffisantes
pour distinguer ces hyménoptères de tous les autres.
C’est de préférence sur le sapin et le mélèze que les femelles des
sirex gigets et spectrum vont déposer leurs oeufs , en choisissant
surtout les arbres fraîchement coupés ou récemment écorcés ; et
( 77 )
c’est au moyen de leur aiguillon qu’elles préparent la loge destinée
à recevoir le précieux dépôt qu’elles vont abandonner ; mais ce
n’est pas sans peine qu’elles parviennent à calmer leur sollicitude
maternelle pour le loger convenablement et sûrement. J’ai vu souvent
de ces femelles parcourir rapidement la surface d’un tronc d’arbre
coupé pour reconnaître l’endroit le plus convenable à cette opération
; lorsqu’elles l’ont trouvé, elles redressent leur ventre, et,
dirigeant alors leur aiguillon perpendiculairement, elles l’enfoncent
dans le bois en contractant avec force leur abdomen de devant en
arrière ; ces contractions , qui alternent avec des instans de repos,
agissent sur l’aiguillon comme les coups de marteau sur un coin fiché
dans un morceau de bois. Ces femelles font pénétrer quelquefois
leur instrument si profondément qu’elles ne peuvent plus le retirer
pour fuir le danger qui les menace ; de sorte qu’elles se laissent
prendre avec la main comme si elles étaient privées d’ailes. Il m’est
arrivé plus d’une fois, en les prenant ainsi, de déchirer les derniers
anneaux de leur abdomen, ne pouvant pas arracher leur aiguillon,
qui était enfoncé dans le bois jusques près de sa base.
Dans le précis des caractères génériques de M.r Latreille , on voit
paraître le nom sirex ; mais , dans son Histoire générale des
Insectes, ce nom, consacré par le temps, ne s’y trouve plus : il est
vrai qu’il lui a substitué celui ééurocère , qui, à mon avis, ne le
remplace pas bien , étant d’une création plus récente, puisque c’est
Geoffroi qui en est l’auteur. J’ai cru, avec M.r Fabricius, qu’il était
plus convenable de conserver à ce genre son ancienne dénomination,
d’autant mieux que celle d'urocère n’avait encore été appliquée qu’à
un seul individu.
M.r Klug a divisé le genre sirex en trois familles , fondant ses
divisions sur le nombre d’anneaux dont sont composés les barbillons.