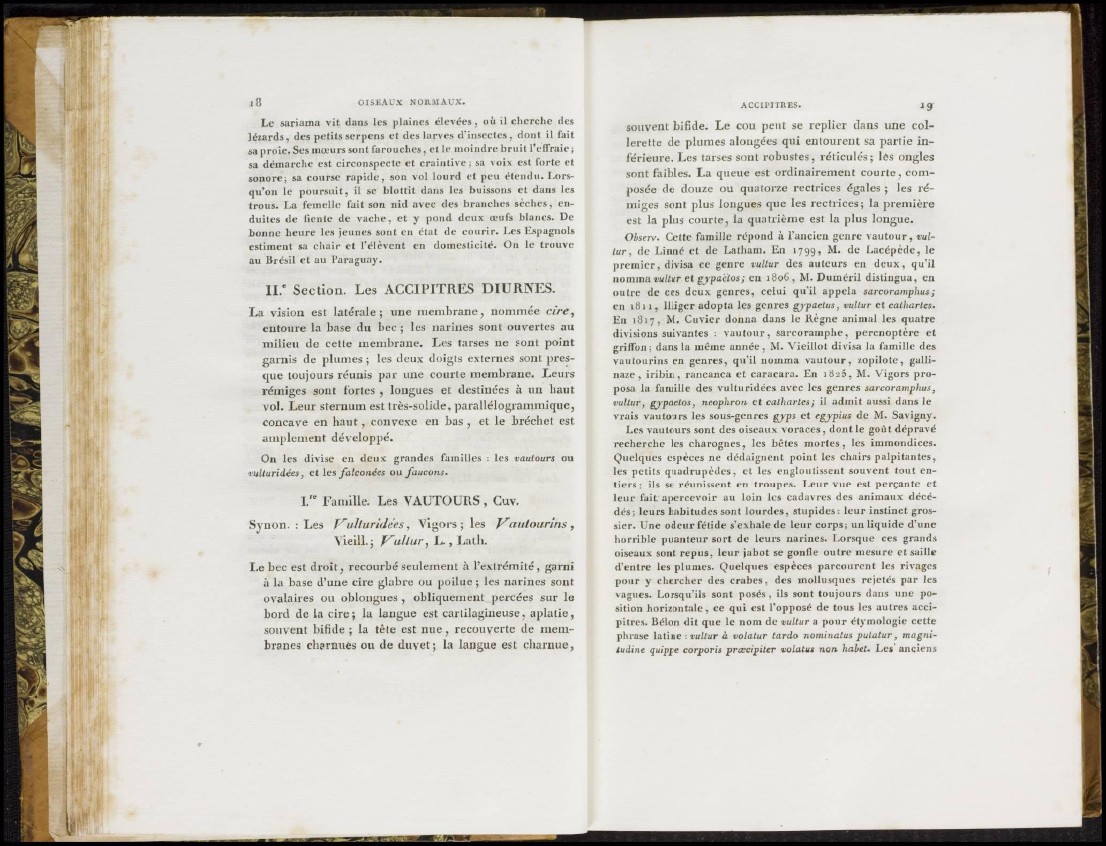
Le sariama vit dans les plaines élevées, où il cherche des
lézards, des petits serpens et des larves d'insectes , dont il fait
sa proie. Ses moeurs sont farouches, et le moindre bruit l'effraie ;
sa démarche est circonspecte et craintive ; sa voix est forte et
sonore; sa course rapide, son vol lourd et peu étendu. Lorsqu'on
le poursuit, il se blottit dans les buissons et dans les
trous. La femelle fait son nid avec des branches sèches, enduites
de fiente de vache, et y pond deux oeufs blancs. De
bonne heure les jeunes sont en état de courir. Les Espagnols
estiment sa chair et l'élèvent en domesticité. On le trouve
au Brésil et au Paraguay.
II.' Section. Les ACCIPITRES DIURNES.
La vision est latérale; une membrane, nommée cire,
entoure la base du bec ; les narines sont ouvertes au
milieu de cette membrane. Les tarses ne sont point
garnis de plumes ; les deux doigts externes sont presque
toujours réunis par une courte membrane. Leurs
rémiges sont fortes , longues et destinées à un haut
vol. Leur sternum est très-solide, parallélogrammique,
concave en haut , convexe en bas , et le bréchet est
amplement développé.
On les divise en deux grandes familles . les vautours ou
rulturidées, et les falconées ou faucons.
Ve Famille. Les VAUTOURS , Cuv.
Synon. : Les Vvlturide'es, Vigors; les J^aulourins ,
Vieill. j J^ullur, L., Lath.
Le bec est droit, recourbé seulement à l'extrémité, garni
à la base d'une cire glabre ou poilue ; les narines sont
ovalaires ou oblongues , obliquement percées sur le
bord de la cire; la langue est cartilagineuse, aplatie,
souvent bifide ; la tête est nue, recouverte de membranes
chprnues ou de duvet; la langue est charnue,
souvent bifide. Le cou peut se replier dans une collerette
de plumes alongées qui entourent sa partie i n férieure.
Les tarses sont robustes, réticulés; les ongles
sont faibles. La queue est ordinairement courte, composée
de douze ou quatorze rectrices égales ; les r é miges
sont plus longues cpie les rectrices; la première
est la plus courte, la quatrième est la plus longue.
Observ. Cette famille répond à l'ancien genre vautour, vultur,
de Linné et de Latham. En 1799, M. de Lacépède, le
premier, divisa ce genre vultur des auteurs en deux, qu'il
nomma vultur et gypaètos; en 1806 , M. Duméril distingua, en
outre de ces deux genres, celui qu'il appela sarcoramphus;
en 1811, Illiger adopta les genres gj'paetus, vultur et cathartes.
En 1817, M. Cuvier donna dans le Règne animal les quatre
divisions suivantes : vautour, sarcoramphe, perenoptère et
griffon: dans la même année, M. Vieillot divisa la famille des
vautourins en genres, qu'il nomma vautour, zopilote, gallinaze
, iribin, rancanca et caracara. En 1825, M. Vigors proposa
la famille des vulturidées avec les genres sarcoramphus,
vultur, gypaetos, ncophron et cathartes; il admit aussi dans le
vrais vautours les sous-genres gyps et egypius de M. Savigny.
Les vautours sont des oiseaux voraces, dont le goût dépravé
recherche les charognes, les bêtes mortes, les immondices.
Quelques espèces ne dédaignent point les chairs palpitantes,
les petits quadrupèdes, et les engloutissent souvent tout entiers
; ils se réunissent en troupes. Leur vue est perçante et
leur fait apercevoir au loin les cadavres des animaux décédés;
leurs habitudes sont lourdes, stupides: leur instinct grossier.
Une odeur fétide s'exhale de leur corps; un liquide d'une
horrible puanteur sort de leurs narines. Lorsque ces grands
oiseaux sont repus, leur jabot se gonfle outre mesure et saille
d'entre les plumes. Quelques espèces parcourent les rivages
pour y chercher des crabes, des mollusques rejetés par les
vagues. Lorsqu'ils sont posés, ils sont toujours dans une position
horizontale, ce qui est l'opposé de tous les autres accipitres.
Bélon dit que le nom de vultur a pour étymologie cette
phrase latine : vultur à volatur tardo nominatus putatur, magnitudine
quippe corporis précipiter volatus non habeU Les anciens