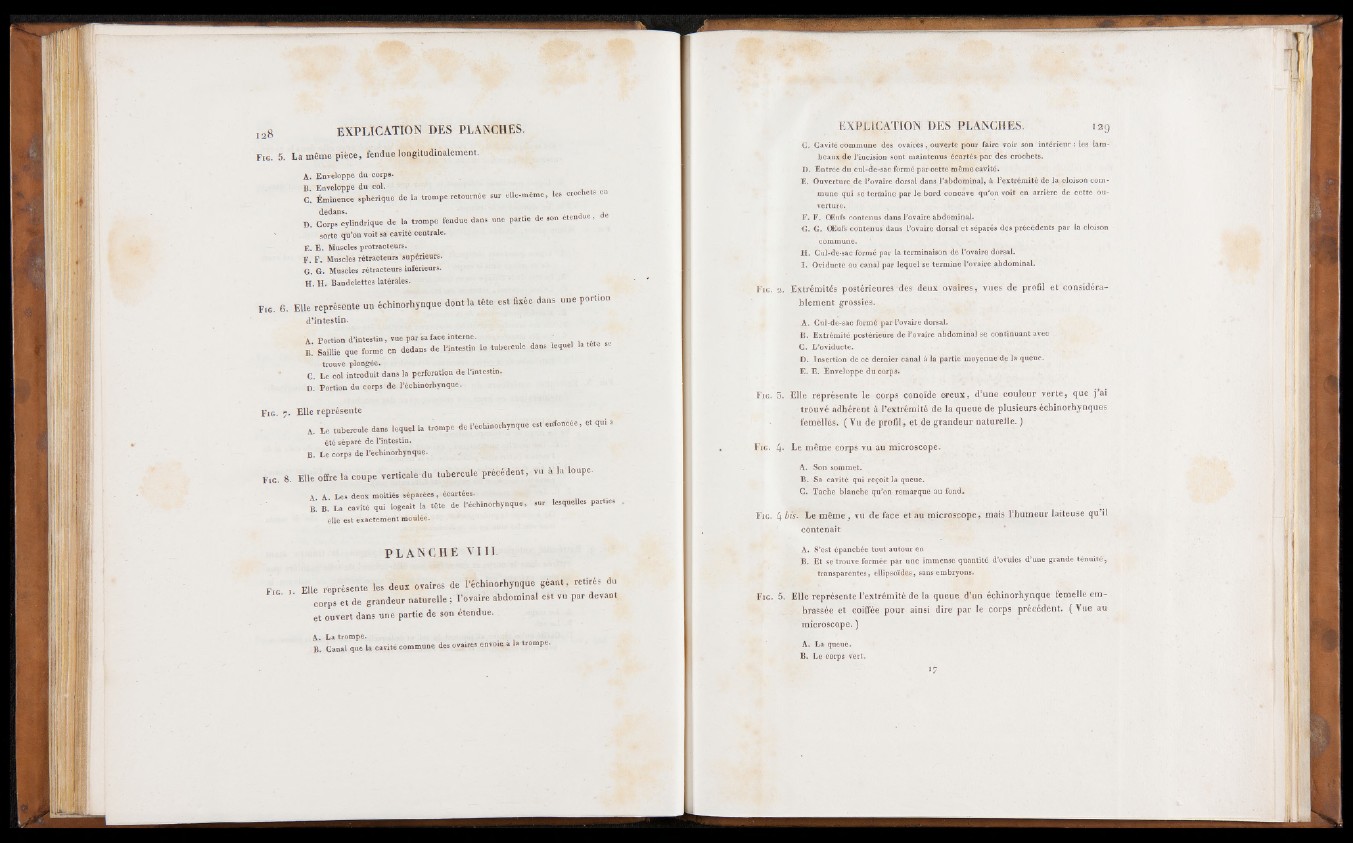
Ia8 EXPLICATION DES PLANCHES.
Fig. 5. La même pièce, fendue longitudinalement.
A. Enveloppe du corps.
B. Enveloppe du col.
G. Éminence sphérique de la trompe retournée sur elle-même, les
dedans.
D. Corps cylindrique de la trompe fendue dans une partie de son
sorte qu’on voit sa cavité centrale.
E. E. Muscles protracteurs.
F. F. Muscles rétracteurs supérieurs.
G. G. Muscles rétracteurs inférieurs.
H. H. Bandelettes latérales.
crochets en
étendue , de
F ig . 6 . E l le r e p r é s e n t e u p é ch in o rh y n q u e d o n t la te te e s t fix e e d an s u n e p o r tio n
d ’in te s t in .
A. Portion d’intestin, vue par sa face interne. g , .
B. Saillie que forme en dedans de l’intestin le tubercule dans lequel
trouve plongée.
C. l e col introduit dans la perforation de l’intestin,
ïi Portion du corps de l’échinorhynque.
F ig . 7. Elle représente
A. Le tubercule dans lequel la trompe de l’échioorhynque est enfoncée , et qui a
été séparé de l’intestin.
B. Le corps de l’échinorhynque.
F,G. 8. Elle offre la coupe yerticale du tubercule précédent, vu à la loupe.
A A. Les deux moitiés séparées, écartées.
B; B. La cavité qui logeait la tête de l’échinorhynque, sur lesquelles parties ,
elle est exactement moulée.
PLANCHE VIII
F ig .
Elle représente les deux ovaires de l’échinorhynque géant, retirés du
corps et de grandeur naturelle ; l ’ovaire abdominal est vu par devant
et ouvert dans une partie de son étendue.
A. La trompe.
B. Canal que la cavité commune des ovaires envoie à la trompe.
EXPLICATION DES PLANCHES 129
C. Cavité commune des ovaires, ouverte pour faire voir son intérieur : les lambeaux
de l’incision sont maintenus écartés par des crochets.
D. Entrée du cul-de-sac formé par cette même cavité.
E. Ouverture de l’ovaire dorsal dans l’abdominal, à l’extrémité de la cloison commune
qui sé termine par le bord concave qu’on voit en arrière de cette ouverture.
F. F. OEnfs contenus dans l’ovaire abdominal.
G. G. OEufs contenus" dans l’ovaire dorsal et séparés des précédents par la cloison
commune.
H. Cul-de-sac formé par la terminaison de l’ovaire dorsal.
I. Oviducte ou canal par lequel se termine l’ovaire abdominal.
F ig. 2. Extrémités postérieures des deux ovaires, vues de profil et considérablement
grossies.
A. Cul-de-sac formé par l’ovaire dorsal.
B. Extrémité postérieure de l’ovaire abdominal se continuant avec
G. L’oviducte.
D. Insertion de cè dernier canal à la partie moyenne de la queue.
E. E. Enveloppe du corps.
Fig. 5. Elle représente le corps conoïde creux, d’une couleur verte, que j ’ai
trouvé adhérent à l’extrémité de la queue de plusieurs échinorhynques
femelles. (V u de profil, et de grandeur naturelle. )
F ig. 4* Ee même corps vu au microscope.
A. Son sommet.
B. Sa cavité qui reçoit la queue.
C. Tache blanche qu’on remarque au fond.
F ig. 4 Ee même , vu de face et au microscope, mais l ’humeur laiteuse qu’ il
contenait
A. S’est épanchée tout autour en
B. Et se trouve formée par une immense quantité d’ovules d’une grande ténuité',
transparentes, ellipsoïdes, sans embryons.
F ig. 5. Elle représente l’extrémité de la queue d’un échinorhynque femelle embrassée
et coiffée pour ainsi dire par le corps précédent. (V u e au
microscope. )
A. La queue.
B. Le corps vert.