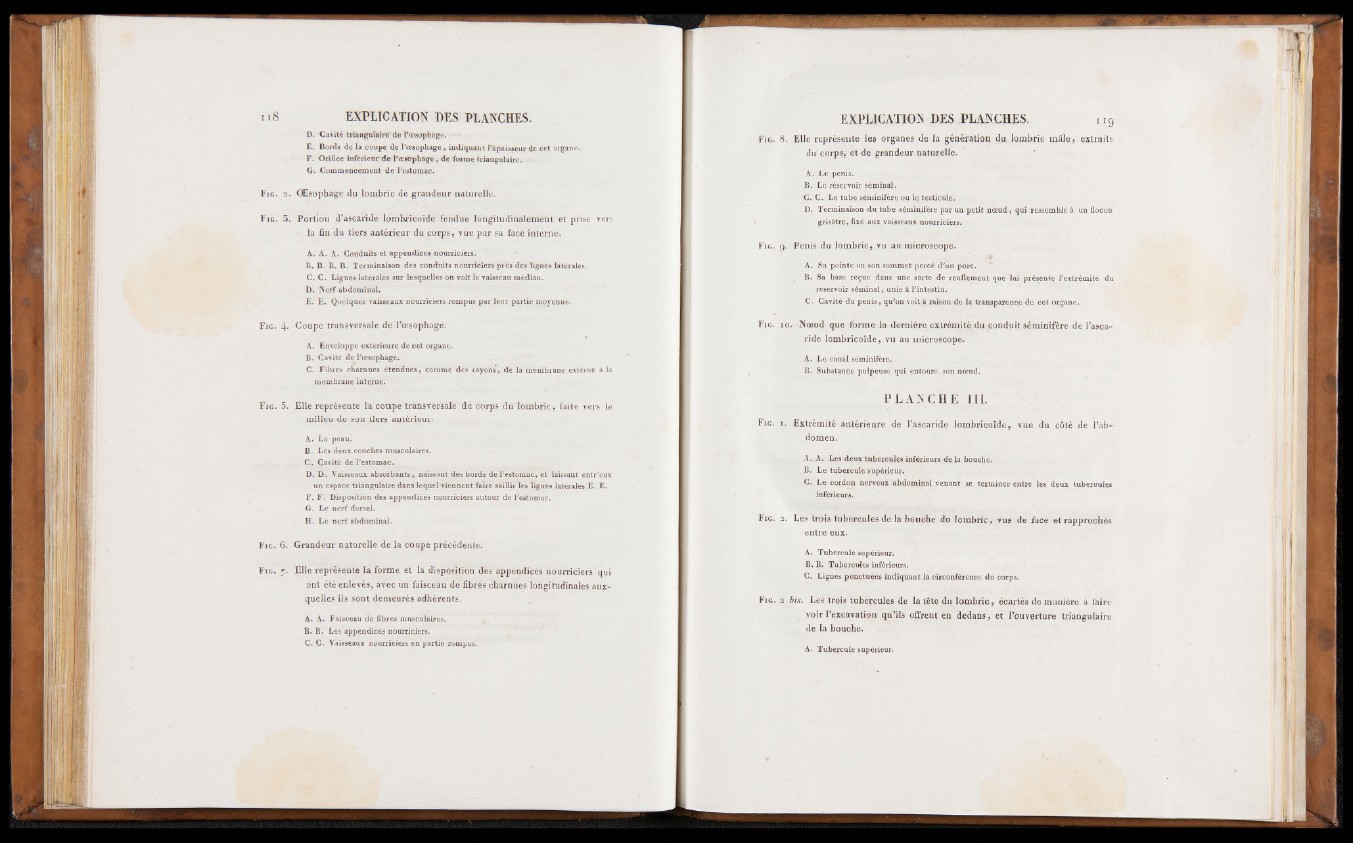
n8 EXPLICATION DES PLANCHES.
D. Cavité triangulaire de l'oesophage. ■
E. Bords de la coupe de l'oesophage, indiquant l'épaisseur de cet organe.
F. Orifice inférieur de l'oesophage, de forme triangulaire.
G. Commencement de l'estomac.
F ig. 2. OEsophage du lombric de graudeur naturelle.
F ig. 3 . Portion d’ascaride lomhricoïde fendue longitudinalement et prise vers
| la fin du tiers antérieur du corps, vue par sa face interne.
A. A. A. Conduits et appendices nourriciers.
B. B. B. B. Terminaison des conduits nourriciers près des lignés latérales.
C. C. Lignes latérales sur lesquelles on voit le vaisseau médian.
D. Nerf abdominal.
E. E. Quelques vaisseaux nourriciers rompus par leur partie moyenne.
F ig . 4. Coupe transversale de l’oesophage.
A. Enveloppe extérieure de cet organe.
B. Cavité de l’oesophage.
C. Fibres charnues étendues, comme des rayons, de la membrane externe à la
membrane interne.
Fig. 5. Elle représente la coupe transversale du corps du lombric, faite vers le
milieu de son tiers antérieur.
A. La peau.
B . Les deux couches musculaires.
C. Cavité de l'estomac.
D. D.. Vaisseaux absorbants, naissant des bords de l'estomac, et laissant entr’eux
un espace triangulaire dans lequel viennent faire saillir les lignes latérales E. E.
F. F. Disposition des appendices nourriciers autour de l'estomac.
G. Le nerf dorsal.
H. Le nerf abdominal.
F ig. 6 . Grandeur naturelle de la coupe précédente.
F ig. n. Elle représente la forme et la disposition des appendices nourriciers qui
ont été enlevés, avec.un faisceau de fibres charnues longitudinales auxquelles
ils sont demeurés adhérents.
A. A. Faisceau de fibres musculaires.
B. B. Les appendices nourriciers.
C. C. Vaisseaux nourriciers en partie rompus.
EXPLICATION DES PLANCHES. “ 9
Fig. 8. Elle représente les organes de la génération du lombric mâle, extraits
du corps, et de grandeur naturelle.
A. Le penis.
B. Le réservoir séminal.
G. C. Le tube séminifère ou le testicule.
D. Terminaison du tube séminifère par un petit noeud, qui ressemble à un flocon"
grisâtre, fixé aux vaisseaux nourriciers.
F ig . 9. Penis du lombric, vu au mioroscope.
A. Sa pointe ou son sommet percé d'un pore. “
. B. Sa base reçue dans une sorte de renflement que lui présente l'extrémité du
réservoir séminal, unie à l’intestin.
C. Cavité du penis, qu’on voit à raison de la transparence de cet organe.
F ig. io . Noeud que forme la dernière extrémité du conduit séminifère de l ’ascaride
lombricoïde, vu au microscope.
A. Le canal séminifère.
B. Substance pulpeuse qui entoure son noeud.
PL ANCHE III.
F ig. 1. Extrémité antérieure de l’ascaride lombricoïde, vue du côté de l’abdomen.
A. A. Les deux tubercules inférieurs de la bouche.
B. Le tubercule supérieur.
C. Le cordon nerveux abdominal venant se terminer entre les deux tubercules
inférieurs.
F ig. 2. Les trois tubercules de la bouche du lombric, vus de face et rapprochés
entre eux.
A. Tubercule supérieur.
B. B. Tubercules inférieurs.
C. Lignes ponctuées indiquant la circonférence du corps.
F ig . 2 bis. Les trois tubercules de la tête du lombric, écartés de manière à faire
voir l’excavation qu’ils offrent en dedans, et l’ouverture triangulaire
de la bouche.
A. Tubercule supérieur.