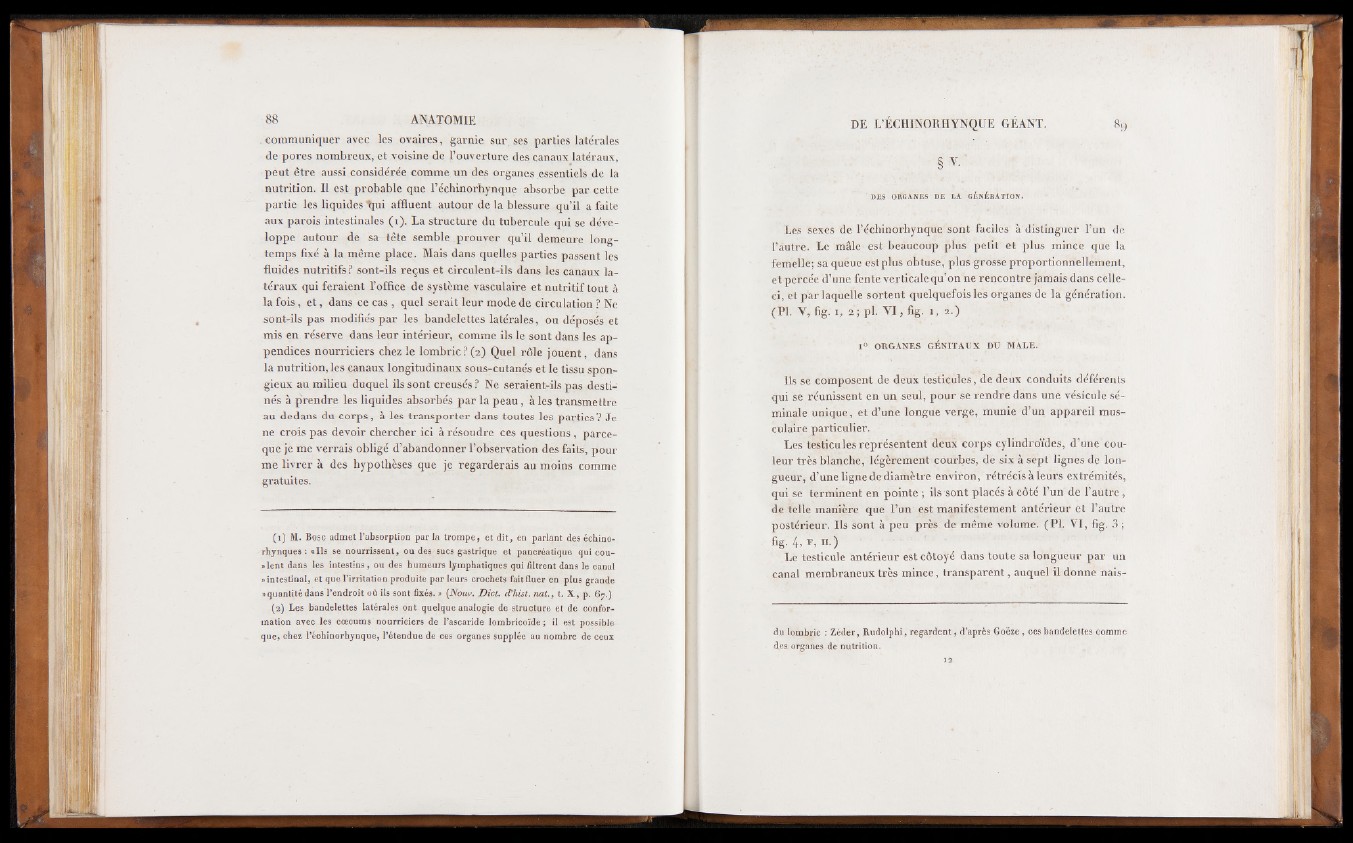
. communiquer avec les ovaires, garnie sur. ses parties latérales
de pores nombreux, et voisine de l’ouverture des canaux latéraux,
peut être aussi considérée comme un des organes essentiels de la
nutrition. Il est probable que l’échinorhynque absorbe par cette
partie les liquides Tjui affluent autour de la blessure qu’il a faite
aux parois intestinales (i). La structure du tubercule qui se développe
autour de sa tête semble prouver qu’il demeure longtemps
fixé à la même place. Mais dans quelles parties passent les
fluides nutritifs P sont-ils reçus et circulent-ils dans les canaux latéraux
qui feraient l’office de système vasculaire et nutritif tout à
la fois, e t, dans ce cas , quel serait leur mode de circulation ? Ne
sont-ils pas modifiés par les bandelettes latérales, ou déposés et
mis en réserve dans leur intérieur, comme ils le sont dans les appendices
nourriciers chez le lombric? (2) Quel rôle jouent, dans
la nutrition, les canaux longitudinaux sous-cutanés et le tissu spongieux
au milieu duquel ils sont creusés ? Ne seraient-ils pas destinés
à prendre les liquides absorbés par la peau, à les transmettre
au dedans du corps, à les transporter dans toutes les parties ? Je
ne crois pas devoir chercher ici à résoudre ces questions, parce-
que je me verrais obligé d’abandonner l’observation des faits, pour
me livrer à des hypothèses que je regarderais au moins comme
gratuites. 1
(1) M. Bosc admet l’absorption par la trompe, et dit, en parlant des échino-
rhynques : «Ils se nourrissent, ou des sucs gastrique et pancréatique qui cou-
» lent dans les intestins, ou des humeurs lymphatiques qui filtrent dans le canal
» intestinal, et que l’irritation produite par leurs crochets fait fluer en plus grande
»quantitédans l’endroit où ils sont fixés. » (Nouv. Dict. d’hist. nat., t. X , p. 6e.)
(a) Les bandelettes latérales ont quelque analogie de structure et de conformation
avec les cæcums nourriciers de l’ascaride lombricoïde ; il est possible
que, chez l’échinorhynque, l’étendue de ces organes supplée au nombre de ceux
%n :
DES OB'GANES DE LA GÉNÉRATION.
Les sexes de l’échinorhynque sont faciles à distinguer l’un de
l’autre. Le mâle est beaucoup plus pelit et plus mince que la
femelle; sa queue est plus obtuse, plus grosse proportionnellement,
et percée d’une fente verticale qu’on ne rencontre jamais dans celle-
ci, et par laquelle sortent quelquefois les organes de la génération.
(PI. Y, fig. 1, 2; pl. Y I , fig. 1, 2.)
1° ORGANES GÉNITAUX DU MALE.
Ils se composent de deux testicules', de deux conduits déférents
qui se réunissent en un seul, pour se rendre dans unë vésicule séminale
unique, et d’une longue verge, munie d’un appareil musculaire
particulier.
Les testicules représentent deux corps cylindroïdes, d’une couleur
très blanche, légèrement courbes, de six à sept lignes de longueur,
d’une ligne de diamètre environ, rétrécis à leurs extrémités,
qui se terminent en pointe ; ils sont placés à côté l’un de l’autre,
de telle manière que l’un est manifestement antérieur et l’autre
postérieur. Ils sont à peu près de même volume. (Pl. VI, fig. 3 ;
fig. 4, *3 H-)
Le testicule antérieur est côtoyé dans toute sa longueur par un
canal membraneux très mince, transparent, auquel il donne naisdu
lombric : Zèder, Jtudolphi, regardent, d’après Goëze, ces bandelettes comme
des. organes de nutrition.