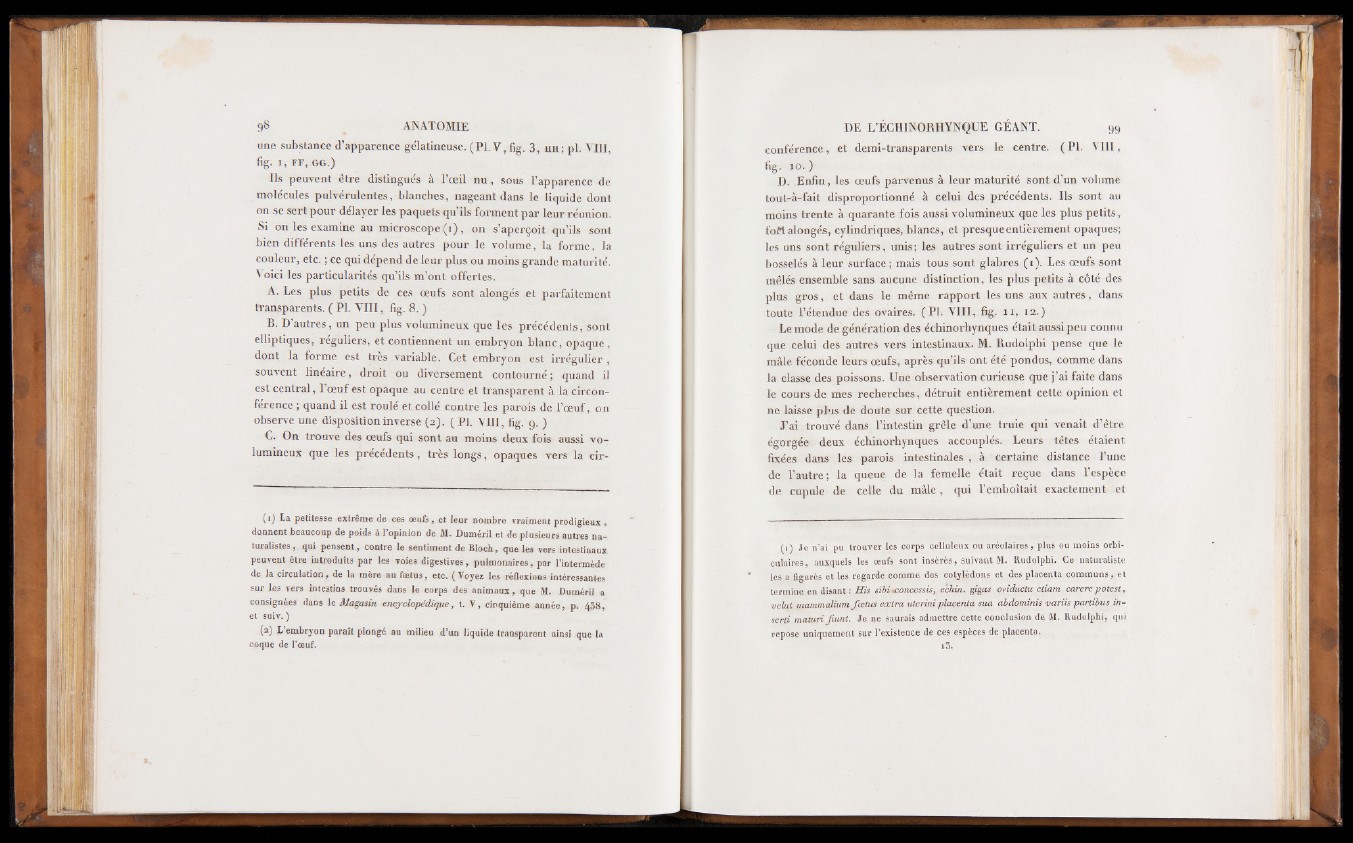
une substance d’apparence gélatineuse. (PI. V,fig. 3, h h ; pl. VIII,
fig. I, FF, GG.)
Ils peuvent être distingués à l’oeil nu, sous l’apparence de
molécules pulvérulentes, blanches, nageant dans le liquide dont
on se sert pour délayer les paquets qu’ils forment par leur réunion.
Si on les examine au microscope ( i) , on s’aperçoit qu’ils sont
bien différents les uns des autres pour le volume, la forme, la
couleur, etc. ; ce qui dépend de leur plus ou moins grande maturité.
Voici les particularités qu’ils m’ont offertes.
A. Les plus petits de ces oeufs sont alongés et parfaitement
transparents. ( Pl. VIII, fig. 8. )
B. D’autres, un peu plus volumineux que les précédents, sont
elliptiques, réguliers, et contiennent un embryon blanc, opaque ,
dont la forme est très variable. Cet embryon est irrégulier ,
souvent linéaire, droit ou diversement contourné ; quand il
est central, l’oeuf est opaque au centre et transparent à la circonférence
; quand il est roulé et collé contre les parois de l’oeuf, on
observe une disposition inverse (2). (Pl. VIII, fig. 9. )
C. On trouve des oeufs qui sont au moins deux fois aussi volumineux
que les précédents, très longs, opaques vers la cir-
(1) La petitesse extrême de ees oeufs, et leur nombre vraiment prodigieux ,
donnent beaucoup de poids à l’opinion de M. Duméril et de plusieurs autres naturalistes,.
qui pensent, contre le sentiment de Bloch, que les vers intestinaux
peuvent être introduits par les voies digestives, pulmonaires, par l’intermède
de la circulation, de la mère au foetus, etc. (Voyez les réflexions intéressantes
sur les vers intestins trouvés dans le corps des animaux, .que M. Duméril a
consignées dans le Magasin encyclopédique, t. V , cinquième année, p. 43S,
et suiv. )
(h) L embryon paraît plonge au milieu d’ùn liquide transparent ainsi que la
coque de l’oeuf.
conférence, et demi-transparents vers le centre. ( Pl. VIII,
f i g . 1 0 . )
D. Enfin, les oeufs parvenus à leur maturité sont d’un volume
tout-à-fait disproportionné à celui des précédents. Ils sont au
moins trente à quarante fois aussi volumineux que les plus petits,
foît alongés, cylindriques, blancs, et presque entièrement opaques;
les uns sont réguliers, unis; les autres sont irréguliers et un peu
bosselés à leur surface ; mais tous sont glabres (1). Les oeufs sont
mêlés ensemble sans aucune distinction, les plus petits à côté des
plus gros, et dans le même rapport les uns aux autres, dans
toute l’étendue des ovaires. (Pl. VIII, fig. 11, 12.)
Le mode de génération des échinorhynques était aussi peu connu
que celui des autres vers intestinaux. M. Rudolphi pense que le
mâle féconde leurs oeufs, après qu’ils ont été pondus, comme dans
la classe des poissons. Une observation curieuse que j’ai faite dans
le cours de mes recherches, détruit entièrement cette opinion et
ne laisse plus de doute sur cette question.
J’ai trouvé dans l’intestin grêle d’une truie qui venait d’être
égorgée deux échinorhynques accouplés. Leurs têtes étaient
fixées dans les parois intestinales , à certaine distance l’une
de l’autre; la queue de la femelle était reçue dans l’espèce
de cupule de celle du mâle, qui l’emboîtait exactement et 1
(1) Je n’ai pu trouver les corps celluleux ou aréolaires, plus ou moins orbi-
culaires, auxquels les oeufs sont insérés, suivant Ml. Rudolphi. Ce naturaliste
les a figurés et les regarde comme des cotylédons et des placenta communs, et
termine en disant: His sibi concessis, echin. gigas oviductu etiam carere potest,
velut mammalium foetus extra uterini placenta sua abdominis variis partibus in-
serti maturi fLunt. Je ne saurais admettre cette conclusion de M. Rudolphi, qui
repose uniquement sur l’existence de ces espèces de placenta.