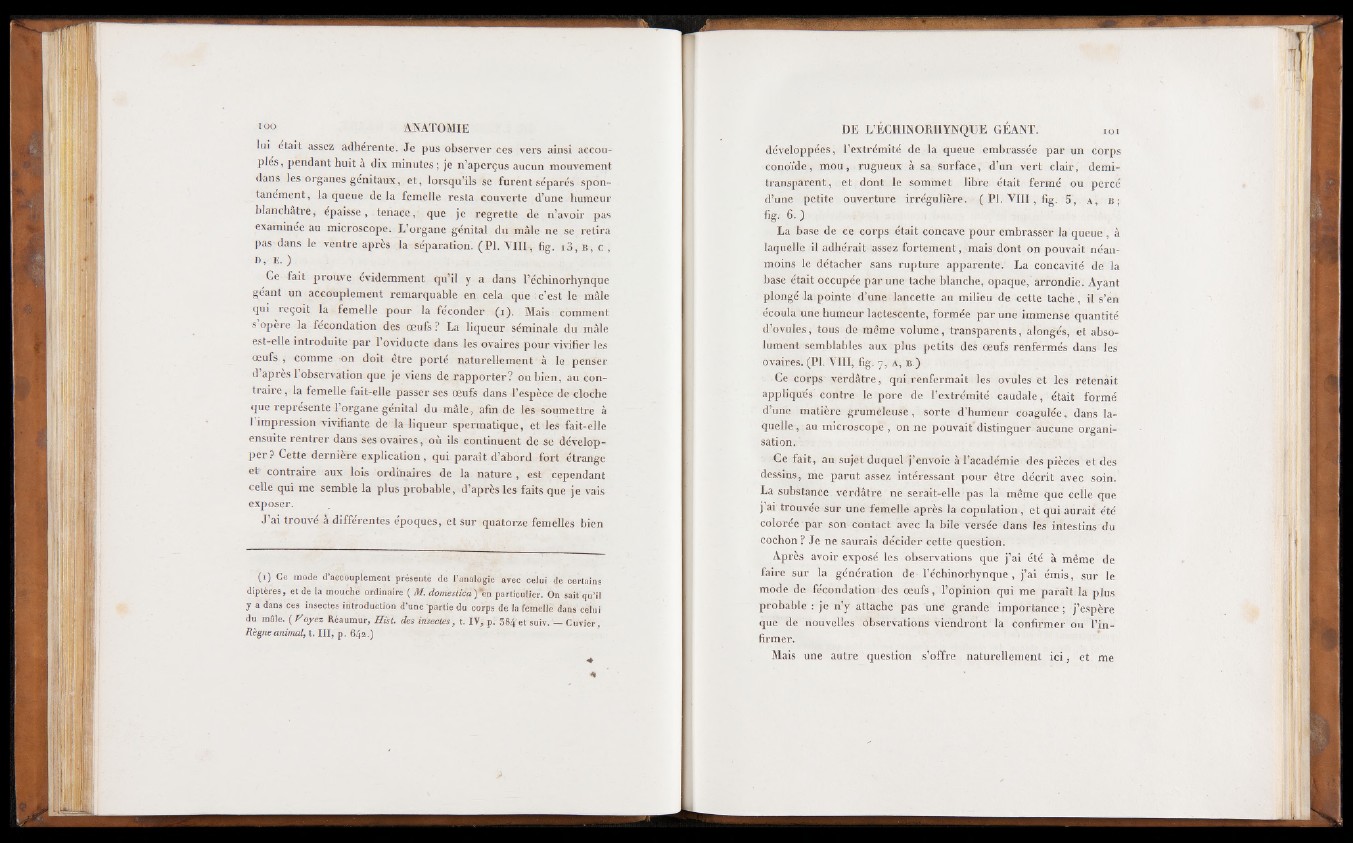
lui était assez adherente. Je pus observer ces vers ainsi accouples
, pendant huit a dix minutes ; je n’aperçus aucun mouvement
dans les organes génitaux, et, lorsqu’ils se furent séparés spontanément,
la queue delà femelle resta couverte d’une humeur
blanchâtre^ épaisse, , tenace,' que je regrette de n’avoir pas
examinée au microscope. L’organe génital du mâle ne se retira
pas dans le ventre après la séparation. (PI. VIII, fig. i 3 , b , c ,
B , E. )
Ge fait prouve évidemment qu’il y a dans l’échinorhynque
géant un accouplement remarquable en cela que : c’est le mâle
qui reçoit la femelle pour la féconder (i). Mais comment
s opéré la fécondation des oeufs? La liqueur séminale du mâle
est-elle introduite par 1 oviducte dans les ovaires pour vivifier les
oeufs , comme -on doit etre porté, naturellement à le. penser
d apres 1 observation que je viens de rapporter? ou bien, au contraire
, la femelle fait-elle passer ses oeufs dans l’espèce de cloche
que représente l’organe génital du mâle, afin de les soumettre à
l’impression vivifiante de la liqueur spermatique, et les fait-elle
ensuite rentrer dans ses ovaires, où ils continuent de se développer
? Cette dernière explication, qui paraît d’abord fort étrange
etr contraire aux lois ordinaires de la nature, est cependant
celle qui me semble la plus probable, d’après les faits que je vais
exposer.
J’ai trouvé à différentes époques, et sur quatorze femelles bien
( i) Ce mode d’accouplement présenté dé l’analogie avec celui de certains
diptères, et de la mouché ordinaire ( M. domestica)*cn particulier. On sait qu’il
y a dans ces insectes introduction d’une’partie du corps de la femelle dans celui
du mâle. ( Voyez Réaumur, Hist. des insectes, t. IV, p. 584' et suiv. — Cuvier,
Règne animal, t. III, p. 64a.)
DE L’ÉCHINORHYNQUE GÉANT,
développées, l’extrémité de la queue embrassée par un corps
conoïde, mou, rugueux à sa surface, d’un vert clair, demi-
transparent, et dont le sommet libre était fermé ou percé
d’une petite ouverture irrégulière. ( PI. VIII, fig. 5 , a , b ;
fig. 6.)
La base de ce corps était concave pour embrasser la queue , à
laquelle il adhérait assez fortement, mais dont on pouvait néanmoins
le détacher sans rupture apparente. La concavité de la
base était occupée par une tache blanche, opaque, arrondie. Ayant
plongé la pointe d’une lancette au milieu de cette tache, il s’èn
écoula une humeur lactescente, formée par une immense quantité
d’ovules, tous de même volume, transparents, alongés, et absolument
semblables aux plus petits des oeufs renfermés dans les
ovaires. (PI. VIII, fig. 7, A, B .)
Ce corps verdâtre, qui renfermait les ovules et les retenait
appliqués contre le pore de l’extrémité caudale, était formé
d’une matière grumeleuse , sorte d’humeur coagulée, dans laquelle,
au microscope, on ne pouvait'distinguer aucune organisation.
.
Ce fait, au sujet duquel j’envoie à l’académie des pièces et des
dessins, me parut assez intéressant pour être décrit avec soin.
La substance verdâtre ne serait-elle pas la même que celle que
j ai trouvée sur une femelle après la copulation , et qui aurait été
colorée par son contact avec la bile versée dans les intestins du
cochon ? Je ne saurais décider cette question.
Après avoir exposé les observations que j’ai été à même de
faire Sur la génération de l’échinorhynque, j’ai émis, sur le
mode de fécondation des oeufs, l’opinion qui me paraît la plus
probable : je n’y attache pas une grande; importance; j’espère
que de nouvelles Observations viendront la confirmer ou l’infirmer.
Mais une autre question s’offre naturellement ic i, et me