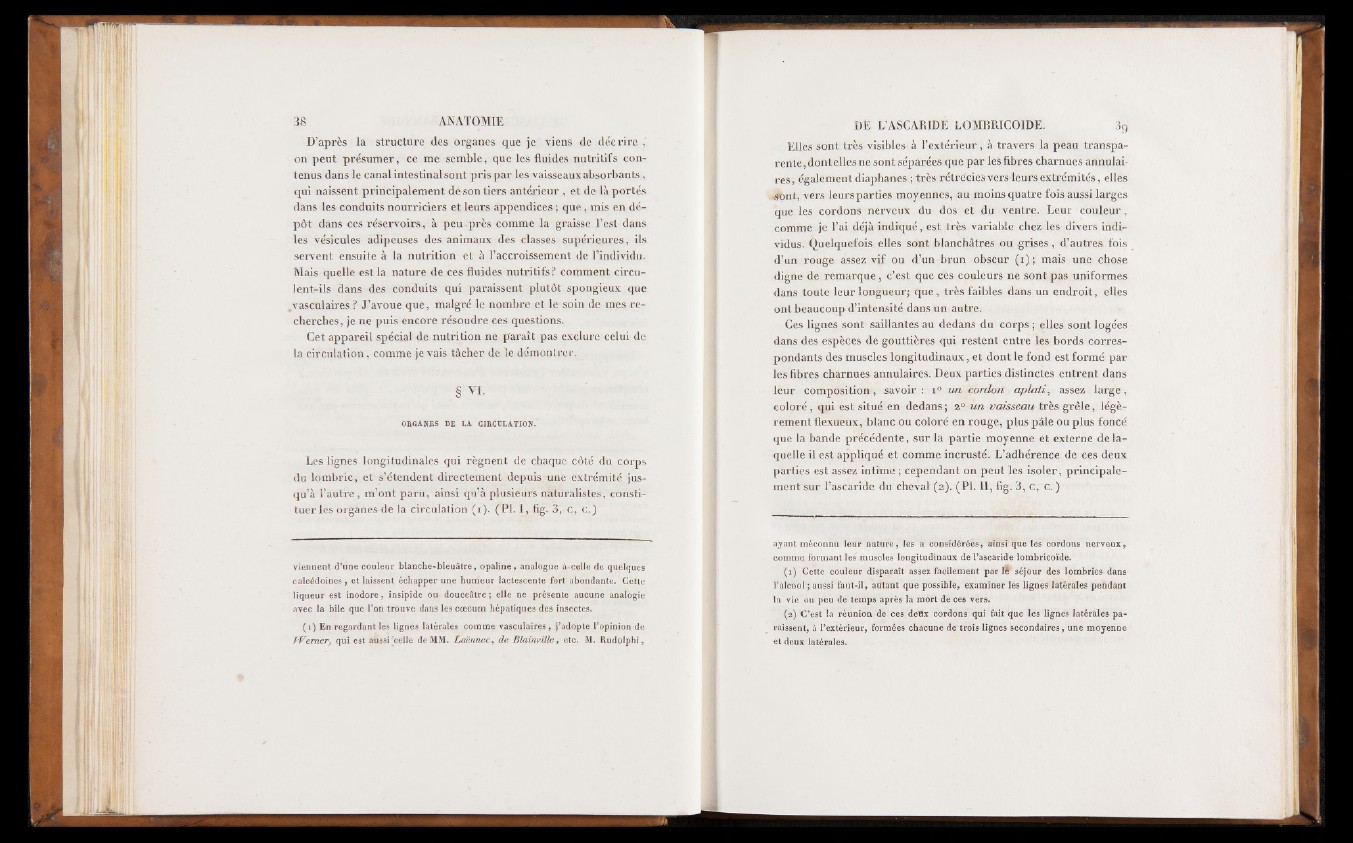
D’après la structure des organes que je viens de décrire ,
on peut présumer, ce me semble, que les fluides nutritifs contenus
dans le canal intestinal sont pris par les vaisseaux absorbants,
qui naissent principalement de son tiers antérieur , et de là portés
dans les conduits nourriciers et leurs appendices ; que, mis en dépôt
dans ces réservoirs, à peu-près comme la graisse l’est dans
les vésicules adipeuses des animaux des classes supérieures, ils
servent ensuite à la nutrition et à l’accroissement de l’individu.
Mais quelle est la nature de ces fluides nutritifs? comment circulent
ils dans des conduits qui paraissent plutôt spongieux que
.vasculaires ? J’avoue que, malgré le nombre et le soin de mes recherches,
je ne puis encore résoudre ces questions.
Cet appareil spécial de nutrition ne paraît pas exclure celui de
la circulation, comme je vais tâcher de le démontrer.
§ VI.
ORGANES DE LA CIRCULATION.
Les lignes longitudinales qui régnent de chaque côté du corps
du lombric, et s’étendent directement depuis une extrémité jusqu’à
l’autre, m’ont paru, ainsi qu’à plusieurs naturalistes, constituer
les organes de la circulation (i). (PL I, fig. 3j c, c.)
viennent d’une couleur blanche-bleuâtre, opaline, analogue à.celle de quelques
calcédoines, et laissent échapper une humeur lactescente fort abondante. Cette
liqueur est inodore, insipide ou douceâtre ; elle ne présente aucune analogie
avec la bile que l’on trouve dans les cæcum hépatiques des insectes.
( 1) En regardant les lignes latérales comme vasculaires, j’adopte l’opinion de
tVc.rner, qui est aussi (celle de MM. Laënnec, de Blainville, etc. M. Kudolphi,
Elles sont très visibles à l’extérieur, à travers la peau transparente,
dont elles ne sont séparées que par les fibres charnues annulaires
, également diaphanes ; très rétrécies vers leurs extrémités, elles
sont, vers leurs parties moyennes, au moins quatre fois aussi larges
que les cordons nerveux du dos et du ventre. Leur couleur,
comme je l’ai déjà indiqué, est très variable chez les divers individus.
Quelquefois elles sont blanchâtres ou grises , d’autres fois
d’un rouge assez vif ou d’un brun obscur (i) ; mais une chose
digne de remarque , c’est que ces couleurs ne sont pas uniformes
dans toute leur longueur; que, très faibles dans un endroit, elles
ont beaucoup d’intensité dans un autre.
Ces lignes sont saillantes au dedans du corps ; elles sont logées
dans des espèces de gouttières qui restent entre les bords correspondants
des muscles longitudinaux, et dont le fond est formé par
les fibres charnues annulaires. Deux parties distinctes entrent dans
leur composition, savoir : i° un cordon aplati, assez large,
coloré, qui est situé en dedans ; 2° un vaisseau très grêle, légèrement
flexueux, blanc ou coloré en rouge, plus pâle ou plus foncé
que la bande précédente, sur la partie moyenne et externe de laquelle
il est appliqué et comme incrusté. L’adhérence de ces deux
parties est assez intime ; cependant on peut les isoler, principalement
sur l’ascaride du cheval (2). (PL II, fig. 3, c, c.)
ayant méconnu leur nature, les a considérées, 'ainsi que les cordons nerveux,
comme formant les-muscles longitudinaux de l’ascaride lombricoide.
(1) Cette couleur disparaît assez facilement par lï’ séjour des lombrics dans
l’alcool; aussi faut-il, autant que possible, examiner les lignes latérales pehdant
la vie ou peu de temps après la mort de ces vers.
(2) C’est la réunion de ces detlx cordons qui fait que les lignes latérales paraissent,
à l’extérieur, formées chacune de trois lignes secondaires, une moyenne
et deux latérales.