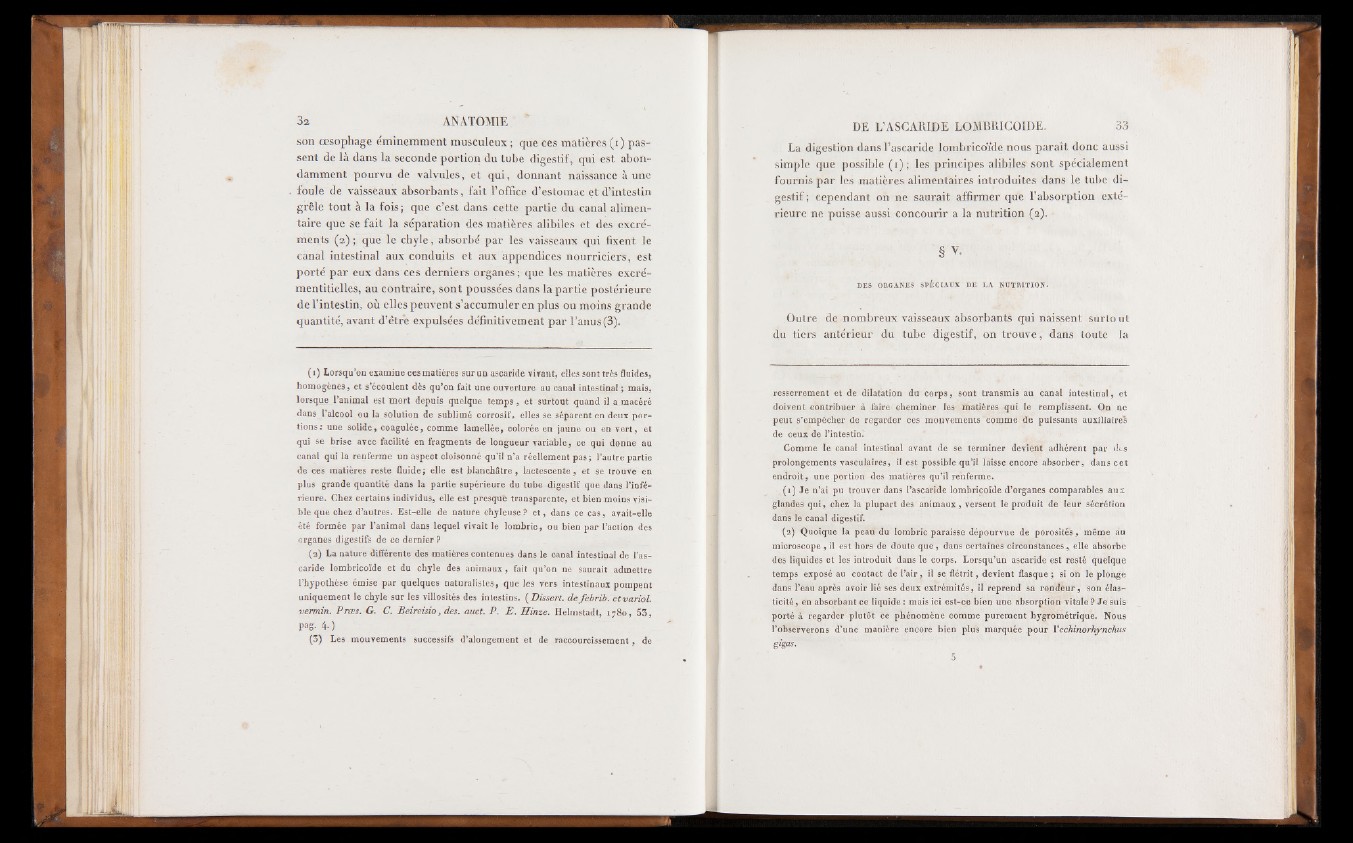
son oesophage éminemment musculeux ; que ces matières (i) passent
de là dans la seconde portion du tube digestif, qui est abondamment
pourvu de valvules, et qui, donnant naissance à une
foule de vaisseaux absorbants, fait l’office d’estomac et d’intestin
grêle tout à la fois; que c’est dans cette partie du canal alimentaire
que se fait la séparation des matières alibiles et des excréments
(2) ; que le chyle, absorbé par les vaisseaux qui fixent le
canal intestinal aux conduits et aux appendices nourriciers, est
porté par eux dans ces derniers organes; que les matières excré-
mentitielles, au contraire, sont poussées dans la partie postérieure
de l’intestin, où elles peuvent s’accumuler en plus ou moins grande
quantité, avant d’être expulsées définitivement par l ’anus (3).
( 1) Lorsqu’on examine ces matières sur un ascaride virant, elles sont très fluides,
homogènes, et s'écoulent dès qu'on fait une ouverture au canal intestinal ; mais,
lorsque l’animal est mort depuis quelque temps, et surtout quand il a macéré
dans l’alcool ou la solution de sublimé corrosif, elles se séparent en deux portions:
une solide, coagulée, comme lameltée, colorée en jaune ou en vert, et
qui se brise avec facilité en fragments de longueur variable, ce qui donne au
canal qui la renferme un aspect cloisonné qu’il n’a réellement pas; l’autre partie
de ces matières reste fluide; elle est blanchâtre, lactescente, et se trouve en
plus grande quantité dans la partie supérieure du tube digestif que dans l’inférieure.
Chez certains individus, elle est presqufe transparente, et bien moins visible
que chez d’autres. Est-elle de nature chyleuse? et, dans ce cas, avait-elle
été formée par l’animal dans lequel vivait le lombric, ou bien par l’action des
organes digestifs de ce dernier ?
(a) La nature différente des matières contenues dans le canal intestinal de l’ascaride
lombricoïde et du chyle des animaux, fait qu’on ne saurait admettre
l’hypothèse émise par quelques naturalistes, que les vers intestinaux pompent
uniquement le chyle sur les villosités des intestins. (Dissert. defebrib. etvariol.
verrnin. Proes. G. C. Beireisio, des. auct. P. E . Hinze. Helmstadt, 1780, 53,
pag. 4.)
(3) Les mouvements successifs d’alongement et de raccourcissement, de
DE L’ASCARIDE LOMBRICOÏDE.
La digestion dans l’ascaride lombricoïde nous paraît donc aussi
simple que possible (1) ;, les principes alibiles sont spécialement
fournis par les matières alimentaires introduites dans le tube digestif
; cependant on ne saurait affirmer que l’absorption extérieure
ne puisse aussi concourir a la nutrition (2).
§V .
DES ORGANES SPÉCIAUX DE LA NUTRITION.
Outre de nombreux vaisseaux absorbants qui naissent surtout
du tiers antérieur du tube digestif, on trouve , dans toute la
resserrement et de dilatation du corps, sont transmis au canal intestinal, et
doivent contribuer à faire cheminer les matières qui le remplissent. On ne
peut s’empêcher de regarder ces mouvements comme de puissants auxiliaires
de ceux de l’intestin^
Comme le canal intestinal avant de se terminer devient adhérent par (ks
prolongements vasculaires, il est possible qu’il laisse encore absorber, dans cet
endroit, une portion des matières qu’il renferme.
(1) Je n’ai pu trouver dans Tascaride lombricoïde d’organes comparables aux
glandes qui, chez la plupart des: animaux, versent le produit de leur sécrétion
dans le canal digestif.
(2) Quoique la peau du lombric paraisse dépourvue de porosités, même au
microscope, il est hors de doute que, dans certaines circonstances, elle absorbe
des liquides et les introduit dans le corps. Lorsqu’un ascaride est resté quelque
temps exposé au contact de l’air, il se flétrit, devient flasque ; si on le plonge
dans l’eau après avoir lié ses deux extrémités, il reprend sa rondeur, son élasticité,
en absorbant ce liquide : mais ici est-ce bien une absorption vitale P Je suis
porté à regarder plutôt ce phénomène comme purement hygrométrique. Nous
l’observerons d’une manière encore bien plus marquée pour V echinorhynchus
gigas.