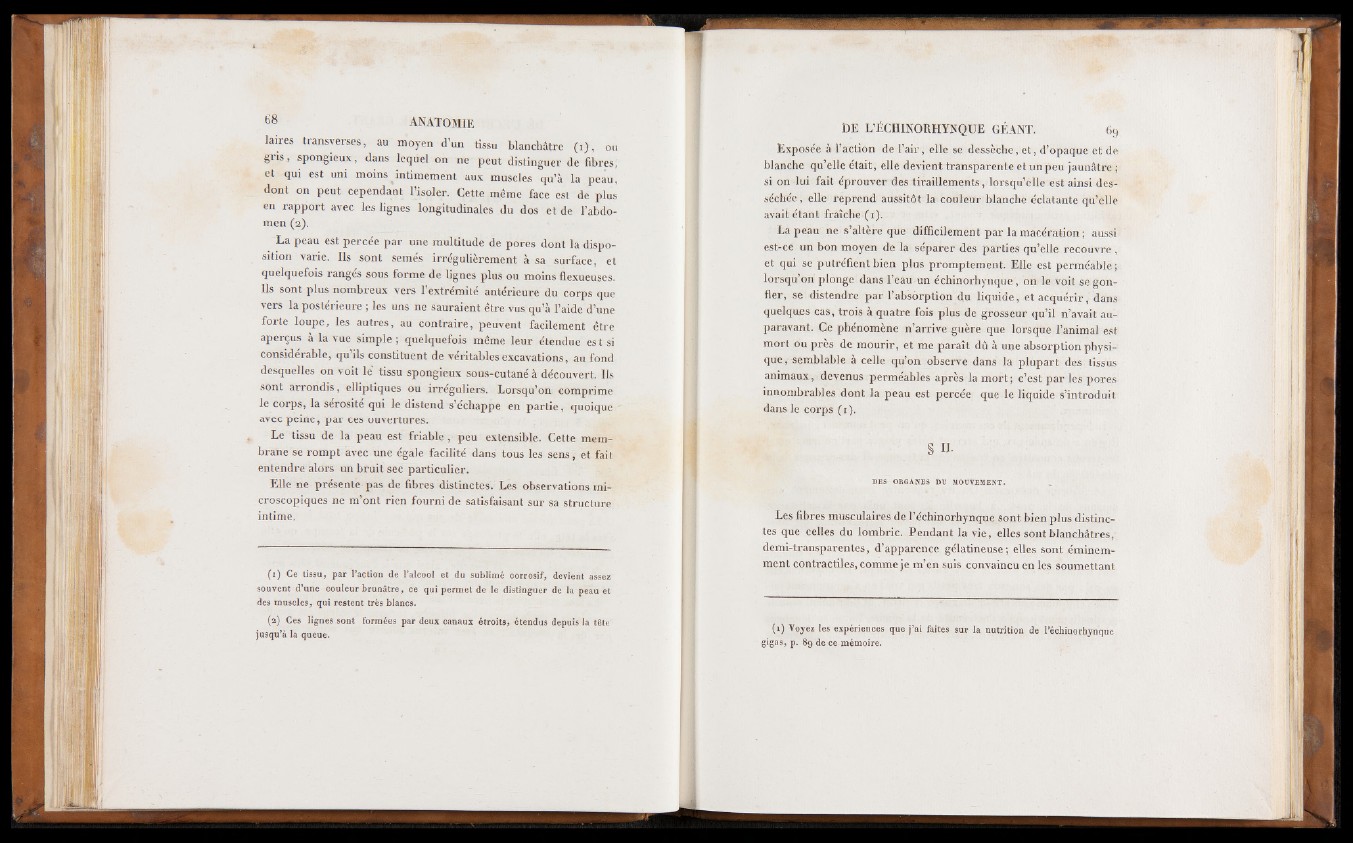
laires transverses, au moyen d’un tissu blanchâtre ( i) , ou
gris, spongieux, dans lequel on ne peut distinguer de fibres,
et qui est uni moins ^ intimement aux muscles qu’à la peau,
dont on peut cependant l’isoler. Cette même face est de plus
en rapport avec les lignes longitudinales du dos et de l’abdomen
(2).
La peau est percée par une multitude de pores dont la disposition
varie. Ils sont semés irrégulièrement à sa surface, et
quelquefois ranges sous forme de lignes plus ou moins flexueuses.
Ils sont plus nombreux vers l’extrémité antérieure du corps que
vers la postérieure ; les uns ne sauraient être vus qu’à l’aide d’une
forte loupe, les autres, au contraire, peuvent facilement être
aperçus à la vue simple ; quelquefois même leur étendue est si
considérable, qu’ils constituent de véritables excavations, au fond
desquelles on voit le' tissu spongieux sous-cutané à découvert. Ils
sont arrondis, elliptiques ou irréguliers. Lorsqu’on comprime
le corps, la sérosité qui le distend s’échappe en partie, quoique '
avec peine, par ces ouvertures.
Le tissu de la peau est friable , peu extensible. Cette membrane
se rompt avec une égale facilité dans tous les sens, et fait
entendre alors un bruit sec particulier.
Elle ne présente pas de fibres distinctes. Les observations microscopiques
ne m’ont rien fourni de satisfaisant sur sa structure
intime.
(1) Ce tissu, par l’action de l’alcool et du sublimé corrosif, devient assez
souvent d’une couleur brunâtre, ce qui permet de le distinguer de la peau cl
des muscles, qui restent très blancs.
(2) Ces lignes sont formées par deux canaux étroits, étendus depuis la tête
jusqu’à la queue.
Exposée à l’action de l’air, elle se dessèche, et, d’opaque et de
blanche qu’elle était, elle devient transparente et un peu jaunâtre ;
si on lui fait éprouver des tiraillements, lorsqu’elle est ainsi desséchée
, elle reprend aussitôt la couleur blanche éclatante qu’elle
avait étant fraîche (1).
La peau ne s’altère que difficilement par la macération ; aussi
est-ce un bon moyen de la séparer des parties qu’elle recouvre ,
et qui se putréfient bien plus promptement. Elle est perméable ;
lorsqu’on plonge dans l’eau un échinorhynque, on le voit se gonfler,
se distendre par l’absorption du liquide, et acquérir, dans
quelques cas, trois à quatre fois plus de grosseur qu’il n’avait auparavant.
Ce phénomène n’arrive guère que lorsque l’animal est
mort ou près de mourir, et me paraît dû à une absorption physique
, semblable à celle qu’on observe dans la plupart des tissus
animaux, devenus perméables après la mort; c’est par les pores
innombrables dont la peau est percée que le liquide s’introduit
dans le corps (1).
§ II.
DES ORGANES DD MOUVEMENT.
Les fibres musculaires de l’échinorhynque sont bien plus distinctes
que celles du lombric. Pendant la vie, elles sont blanchâtres,
demi-transparentes, d’apparence gélatineuse; elles sont éminemment
contractiles, comme je m’en suis convaincu en les soumettant
(1) Voyez les expériences que j’ai faites sur la nutrition de l’échinorbynqüe
gigas, p. 89 deee mémoire.