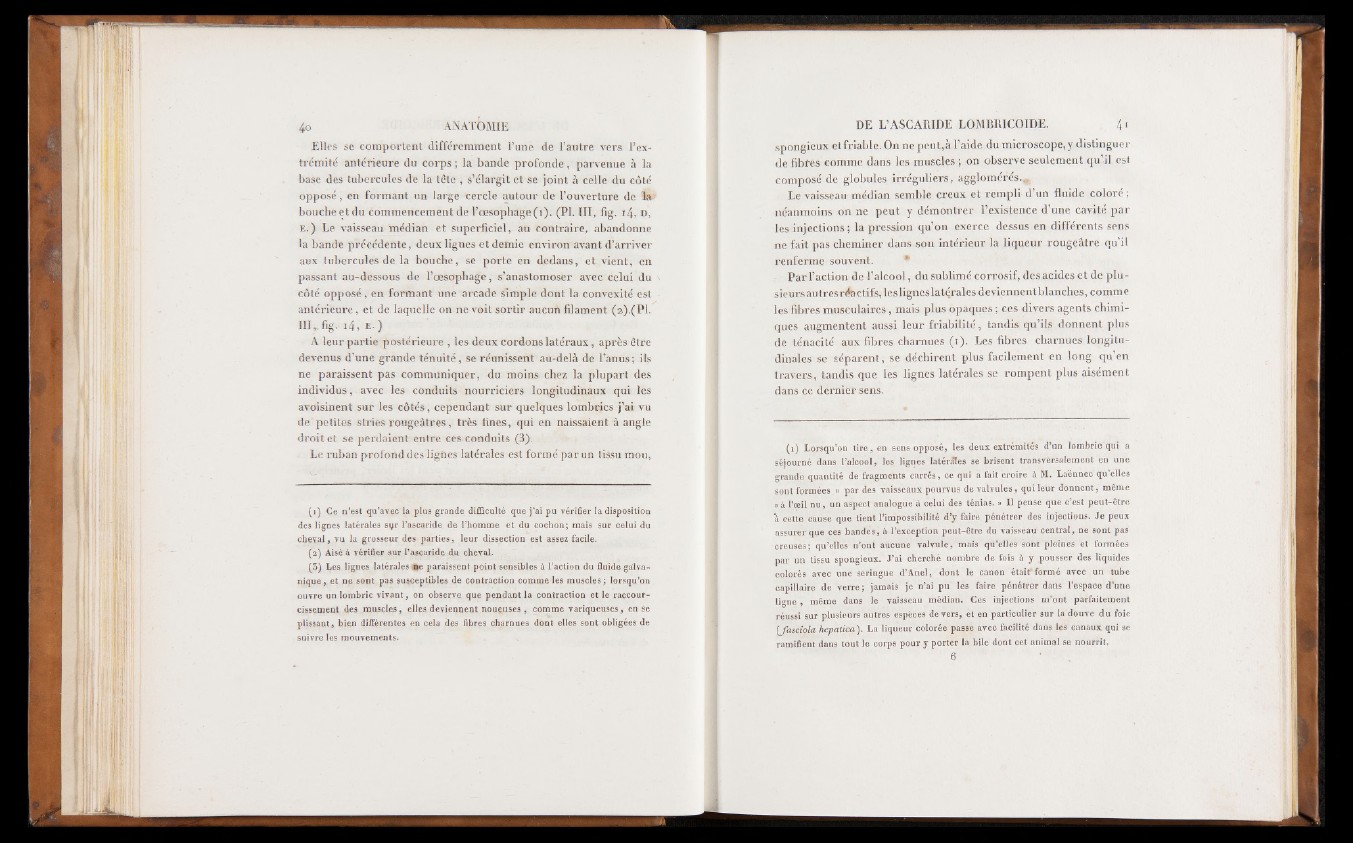
Elles se comportent différemment l’une de l’autre vers l’extrémité
antérieure du corps ; la bande profonde, parvenue à la
base des tubercules de la tête , s’élargit et se joint à celle du côté
opposé, en formant un large cercle autour de l’ouverture de la
bouche et du commencement de l’oesophage (i). (PI. III, fig. i 4, d,
e.) Le vaisseau médian et superficiel, au contraire, abandonne
la bande précédente, deux lignes et demie environ avant d’arriver
aux tubercules de la bouche, se porte en dedans, et vient, en
passant au-dessous de l’oesophage, s’anastomoser avec celui du
côté opposé , en formant une arcade simple dont la convexité est
antérieure, et de laquelle on ne voit sortir aucun filament (2).(PI.
III,.fig. i 4 , e.)
A leur partie postérieure , les deux cordons latéraux, après être
devenus d’une grande ténuité, se réunissent au-delà de l’anus ; ils
ne paraissent pas communiquer, du moins chez la plupart des
individus, avec les conduits nourriciers longitudinaux qui les
avoisinent sur les côtés, cependant sur quelques lombrics j’ai vu
de petites stries rougeâtres, très fines, qui en naissaient à angle
droit et se perdaient entre ces conduits (3).
Le ruban profond des lignes latérales est formé par un tissu mou,
(1) Ce n’est qu’avec la plus grande difficulté que j'ai pu vérifier la disposition
des lignes latérales syr l’ascaride de l’homme et du cochon; mais sur celui du
cheval, vu la grosseur des parties, leur dissection est assez facile.
(2) Aisé à vérifier sur l’ascaride fin cheval.
(3) Les lignes latérales ee paraissent point sensibles fi l’action du fluide galvanique,.
et ne sont pas susceptibles de contraction comme les muscles ; lorsqu’on
ouvre un lombric vivant, on observe que pendant la contraction et le raccourcissement
des muscles, elles deviennent noueuses, comme variqueuses, en se
plissant, bien différentes en cela des fibres charnues dont elles sont obligées de
suivre les mouvements.
spongieux et friable. On ne peut, à l’aide du microscope, y distinguer
de fibfes comme dans les muscles ; on observe seulement qu’il est
composé de globules irréguliers, agglomérés.^
Le vaisseau médian semble creux et rempli d’un fluide colore ;
néanmoins on ne peut y démontrer l’existence d’une cavité par
les injections ; la pression qu’on exerce dessus en différents sens
ne fait pas cheminer dans son intérieur la liqueur rougeâtre qu’il
renferme souvent.
Par l’action de l’alcool, du sublimé corrosif, des acides et de plusieurs
autres r^a çtifs, lesligneslatqrales deviennentblanches, comme
les fibres musculaires, mais plus opaques ; ces divers agents chimiques
augmentent aussi leur friabilité, tandis qu’ils donnent plus
de ténacité aux fibres charnues (1). Les fibres charnues longitudinales
se séparent, se déchirent plus facilement en long qu’en
travers, tandis que les lignes latérales se rompent plus aisément
dans ce dernier sens. 1
(1) Lorsqu’on tire, en sens opposé, les fieux extrémités d’un lombrio qui a
séjourné dans l’alcool, les lignes latérales se brisent transversalement en une
grande quantité de fragments carrés, ce qui a fait croire à M. Laënnec qu’elles
sont formées « par des vaisseaux pourvus de valvules, qui leur donnent, même
»à l’oeil nu, un aspect analogue'à celui des ténias. » Il pense que c’ est peut-être
"fi cette cause que tient l’impossibilité d’y faire pénétrer des injections. Je peux
assurer que ces bandes, à l’exception peut-être du vaisseau central, ne sont pas
creuses; qu’elles n’ont aucune valvule, mais qu’elles sont pleines et formées
par un tissu spongieux. J’ai cherché nombre de fois à y pousser' des liquides
colorés avec une seringue d’Anel, dont le canon était* formé avec un tube
capillaire de verre; jamais je n’ai pu les faire pénétrer dans l’espace d’une
ligne, même dans le vaisseau médian. Ces injections m’ont parfaitement
réussi sur plusieurs autres espèces devers, et en particulier sur la douve du foie
(fasciola hepatica). La liqueur colorée passe avec facilité dans lefi’ canaux qui se
ramifient dans tout le corps pour y porter la bile dont cet animal se nourrit,