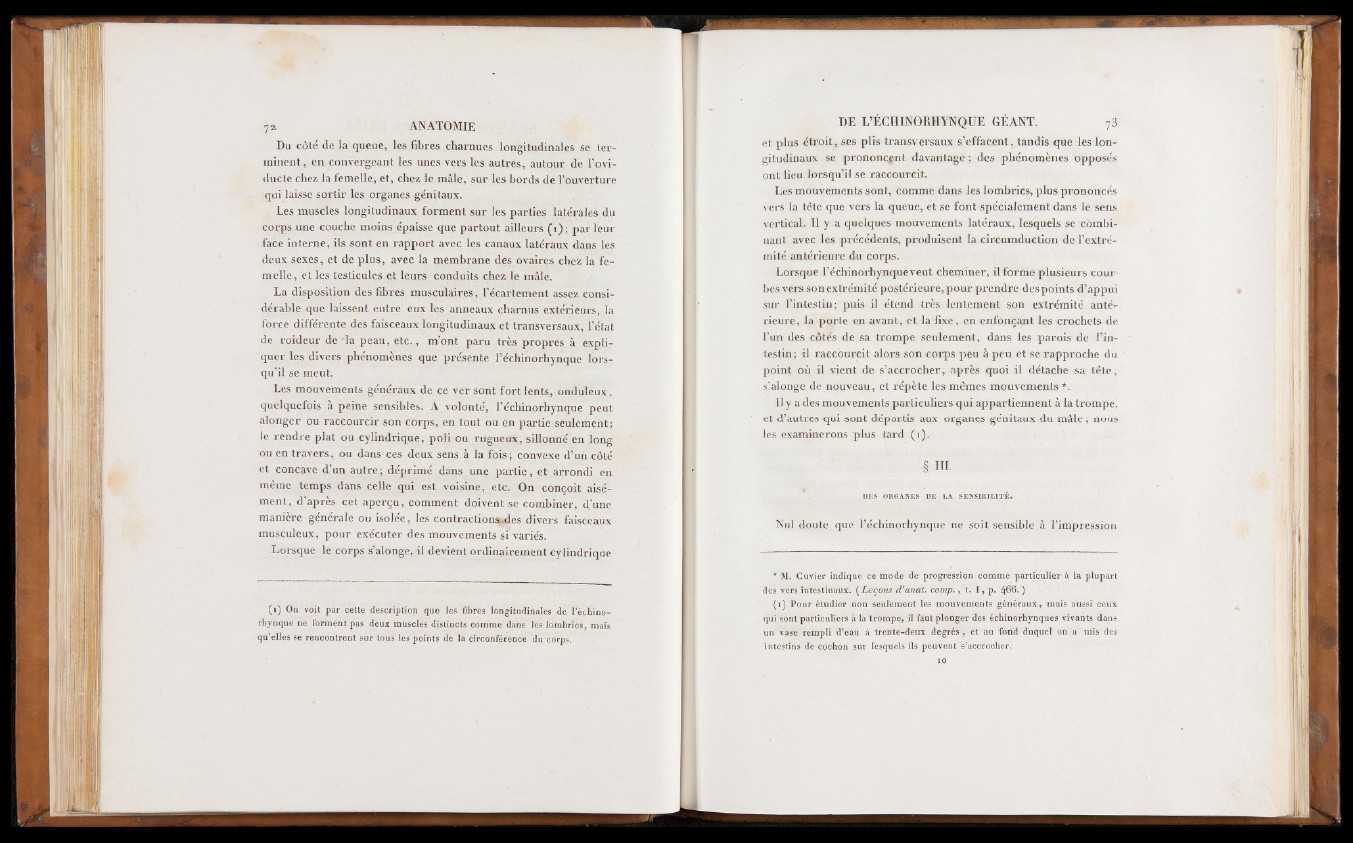
Du côté de la queue, les fibres charnues longitudinales se terminent,
en convergeant les unes vers les autres, autour de l’ovi-
ducte chez la femelle, et, chez le mâle, sur les bords de l’ouverture
qui laisse sortir les organes génitaux.
Les muscles longitudinaux forment sur les parties latérales du
corps une couche moins épaisse que partout ailleurs (1) ; par leur
face interne, ils sont en rapport avec les canaux latéraux dans les
deux sexes, et de plus, avec la membrane des ovaires chez la femelle,
et les testicules et leurs conduits chez le mâle.
La disposition des fibres musculaires, l’écartement assez considérable
que laissent entre eux les anneaux charnus extérieurs, la
force différente des faisceaux longitudinaux et transversaux, l’état
de roideur de ’la peau, etc., m’ont paru très propres à expliquer
les divers phénomènes que présente l’échinorhynque lorsqu’il
se meut.
Les mouvements généraux de ce ver sont fort lents, onduleux,
quelquefois à peine sensibles. A volonté, l’échinorhynque peut
alonger ou raccourcir son corps, en tout ou en partie seulement;
le rendre plat ou cylindrique, poli ou rugueux, sillonné en long
ou en travers, ou dans ces deux sens à la fois ; convexe d’un côté
et concave d’un autre; déprimé dans une partie, et arrondi en
même temps dans celle qui est voisine, etc. On conçoit aisément,
d’après cet aperçu, comment doivent se combiner, d’une
manière générale ou isolée, les contractionss»des divers faisceaux
musculeux, pour exécuter des mouvements si variés.
Lorsque le corps s’alonge, il devient ordinairement cylindrique
(1) On voit par cette description que les fibres longitudinales de l’échino-
rhynque ne forment pas deux muscles distincts comme dans les lombrics, mais
qu’elles se rencontrent sur tous les points de la circonférence du corps.
et plus étroit, ses plis transversaux s’effacent, tandis que les longitudinaux
se prononcent davantage ; des phénomènes opposés
ont lieu lorsqu’il se raccourcit.
Les mouvements sont, comme dans les lombrics, plus prononcés
vers la tête que vers la queue, et se font spécialement dans le sens
vertical. Il y a quelques mouvements latéraux, lesquels se combinant
avec les précédents, produisent la circumduction de l’extrémité
antérieure du corps.
Lorsque l’échinorhynqueveut cheminer, il forme plusieurs courbesvers
son extrémité postérieure, pour prendre des points d’appui
sur l’intestin; puis il étend très lentement son extrémité antérieure
, la porte en avant, et la fixe, en enfonçant les crochets de
l’un des côtés de sa trompe seulement, dans les parois de l’intestin
; il raccourcit alors son corps peu à peu et se rapproche du
point où il vient de s’accrocher, après quoi il détache sa tête,
s’alonge de nouveau, et répète les mêmes mouvements*.
Il y a des mouvements particuliers qui appartiennent à la trompe,
et d’autres qui sont départis aux organes génitaux du mâle ; nous
les examinerons plus tard (i).
§ III.
DES ORGANES DR LA SENSIBILITÉ*
Nul doute que l’échinorhynque ne soit sensible à l’impression 1
* M. Cuvier indiqué ce mode de progression comme particulier à la plupart
des vers intestinaux. (Leçons d’anat. comp., t. I , p. 466. )
(1) Pour étudier non seulement les mouvements généraux, mais aussi ceux
qui sont particuliers à la trompe, il faut plonger des échinorhynques vivants dans
un vase rempli d’eau à trente-deux degrés, et au fond duquel on a mis des
intestins de cochon sur lesquels ils peuvent s’accrocher.