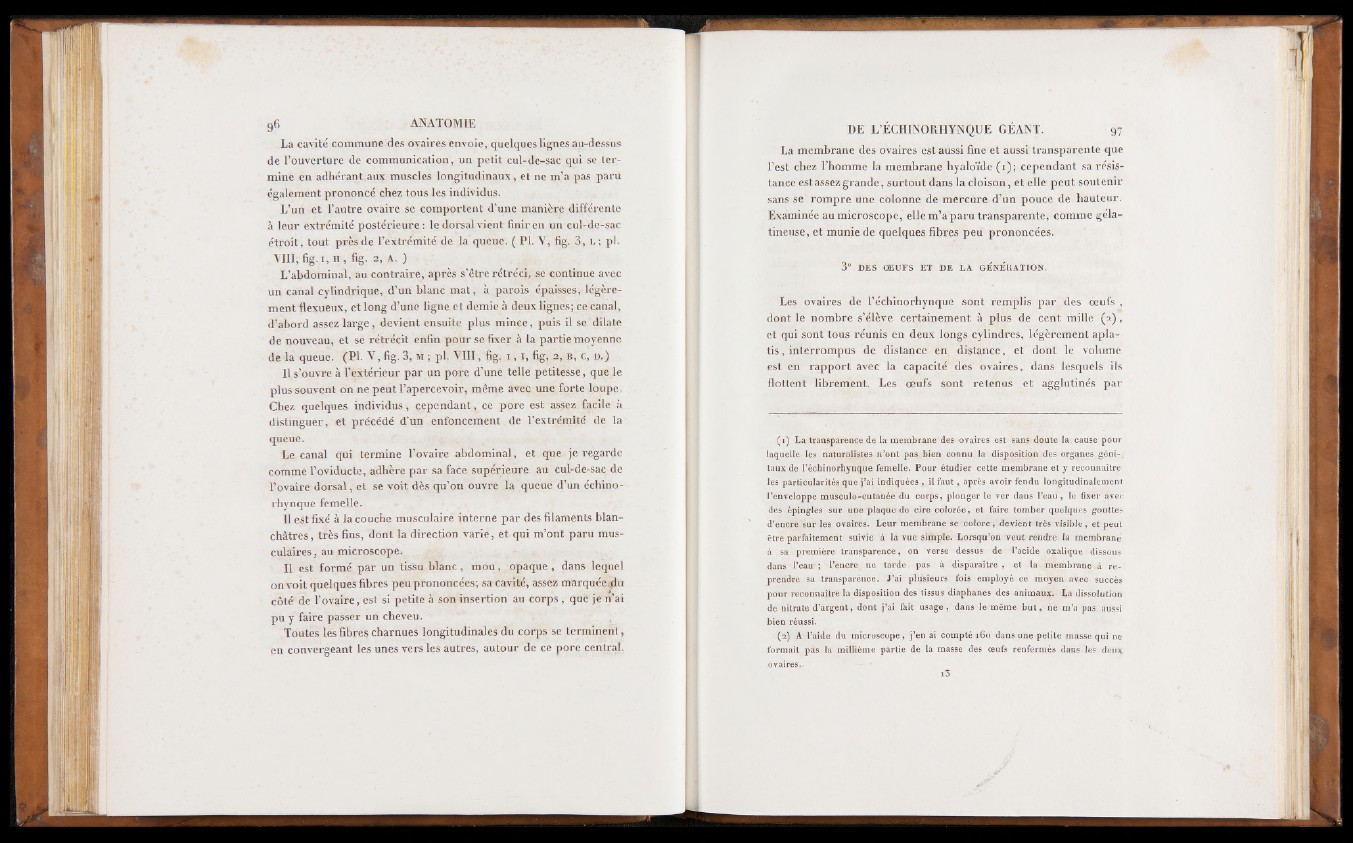
La cavité commune des ovaires envoie, quelques lignes au-dessus
de l’ouverture de communication, un petit cul-de-sac qui se termine
en adhérant aux muscles longitudinaux, et ne m’a pas paru
également prononcé chez tous les individus.
L’un et l’autre ovaire se comportent d’une manière différente
à leur extrémité postérieure : le dorsal vient finir en un eul-de-sac
étroit, tout près de l’extrémité de la queue. ( PL V, fig. 3, l ; pl.
/VIII, fig.i, h , fig. 2, A. )
L’abdominal, au contraire, après s'être rétréci, se continue avec
un canal cylindrique, d’un blanc mat, à parois épaisses, légèrement
flexueux, et long d’une ligne et demie à deux lignes; ce canal,
d’abord assez large, devient ensuite plus mince, puis il se dilate
de nouveau, et se rétrécit enfin pour se fixer à la partie moyenne
de la queue. (Pl. V, fig. 3, m ; pl. VIII, fig. i , i , fig, a , b , c , ü . )
Il s’ouvre à l’extérieur par un pore d’une telle petitesse, que le
plus souvent on ne peut l ’apercevoir, même avec une forte loupe.
Chez quelques individus, cependant, ce pore est assez facile à
distinguer, et précédé d’un enfoncement de l’extrémité de la
queue.
Le canal qui termine l’ovaire abdominal, et que je regarde
comme l’oviducte, adhère par sa face supérieure au cul-de-sac de
l’ovaire dorsal, et se voit dès qu’on ouvre la queue d’un échino-
rhynque femelle.
Il est fixé à la couche musculairé interne par des filaments blanchâtres
, très fins, dont la direction varie, et qui m’ont paru musculaires
, au microscope.
11 est formé par un tissu blanc, mou, opaque, dans lequel
on voit quelques fibres peu prononcées; sa cavité, assez marquéeçdu
côté de l’ovaire, est si petite à son insertion au corps , que je n’ai
pu y faire passer un cheveu. i ,
Toutes les fibres charnues longitudinales du corps se terminent,
en convergeant les unes vers les autres, autour de ce pore central,
DE L’ÉCHINORHYNQUE GÉANT.
La membrane des ovaires est aussi fine et aussi transparente que
l’est chez l’homme la membrane hyaloïde (i); cependant sa résistance
est assez grande, surtout dans la cloison, et elle peut soutenir
sans se rompre une colonne de mercure d’un pouce de hauteur.
Examinée au microscope, elle m’a paru transparente, comme gélatineuse,
et munie de quelques fibtes peu prononcées.
3“ DES OEUFS ET DE LA GÉNÉRATION.
Les ovaires de l’échinorhynque sont remplis par des oeufs ,
dont le nombre s’élève certainement à plus de cent mille ( a ) ,
et qui sont tous réunis en deux longs cylindres, légèrement aplatis,
interrompus de distance en distance, et dont le volume
est en rapport avec la capacité des ovaires, dans lesquels ils
flottent librement. Les oeufs sont retenus et agglutinés par
(i) La transparence de la membrane des ovaires est sans doute la.;cause pour
laquelle les naturalistes n’ont pas bien connu la disposition des organes génitaux
de l’échinorhynque femelle. Pour étudier cette membrane et y reconnaître
les particularités que j’ai indiquées , il faut, après avoir fendu longitudinalement
l’enveloppe musculo-cutanée du corps, plonger le ver dans l’eau, le fixer avec
des épingles sur upe plaque de cire colorée, et faire tomber quelques gouttes
d’encre sur les ovaires. Leur membrane se-'colore, devient très visible, et peut
être parfaitement suivie' ’à la vue simple. Lorsqu’on veut rendre la membrane
à sa première transparence, on verse dessus - (la l’acide oxalique dissous
dans l’eau ; l ’encre ne tarde - pas à disparaître, -et la mcmbrane.à reprendre
sa transparence. J’ai plusieurs fois employé ce moyen avec succès
pour reconnaître la disposition des tissus diaphanës des animaux. La dissolution
de nitrate d’argent, dont j’ai fait usage ,' dans le même but,- ne-rn’a pas. aussi
bien réussi.
(a) A l’aide du microscope, j’en âi compté ifio dans une petite masse qui ne
formait pas la millième partie de la masse des oeufs renfermés dans les deux
ovaires..