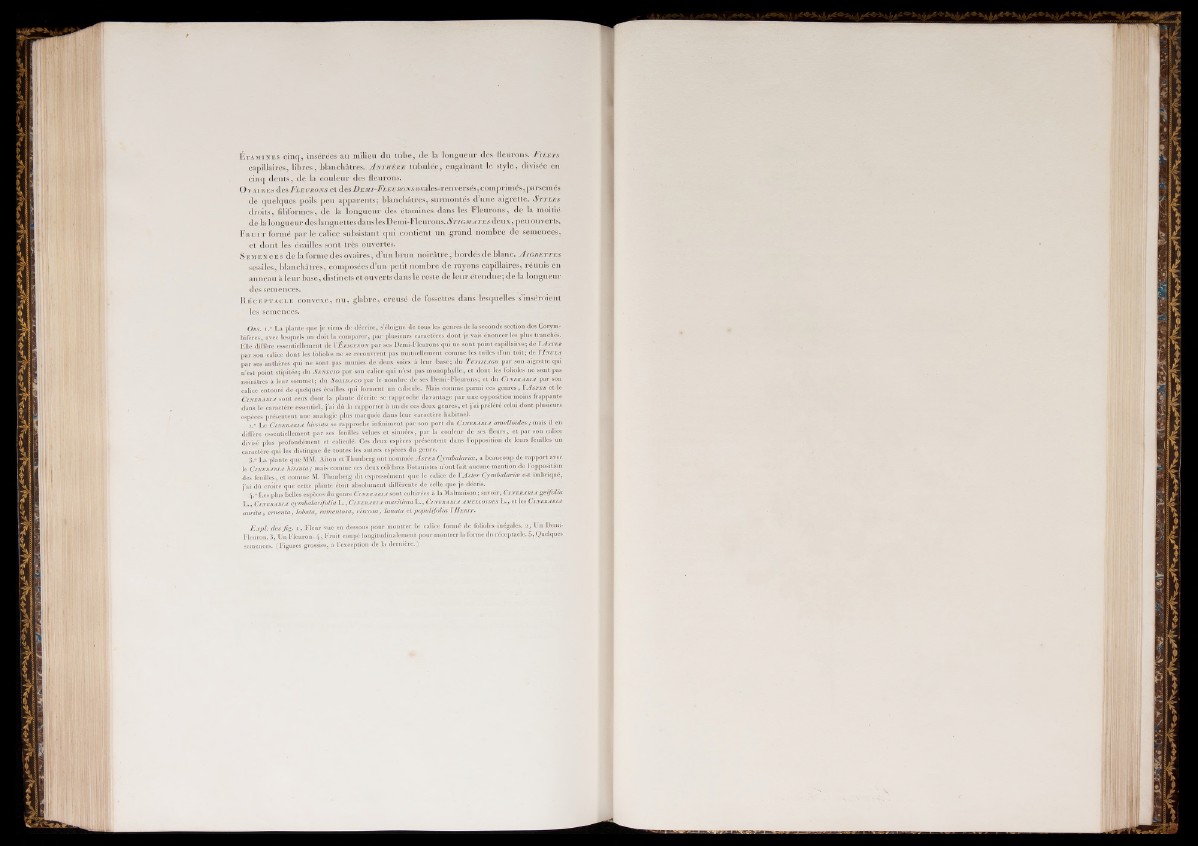
É tamines cinq, insérées au milieu du tube, de la longueur des fleurons. F i l e t s
capillaires, libres, blanchâtres. A n t h è r e tubulée, engainant le style, divisée en
cinq dents, de la couleur des fleurons.
O vaires des F l e u r o n s et des D e m i - F l e u r o n s o v ià e s - r e n v e r s é s , comprimés, parsemés
de quelques poils peu apparents} blanchâtres, surmontés d u n e aigrette. S t y l e s
droits, filiformes, de là longueur des étamines dans les Fleurons, de la moitié
de la longueur des languettes dans les Demi-Fleurons. S t i g m a t e s deux, peu ouverts.
F r u i t formé par le calice subsistant qui .contient un grand nombre de semences,
et dont les écailles sont très ouvertes.
S em en c es de la forme des ovaires, d’un b run noirâtre, bordés de blanc. A i g r e t t e s
sessiles, blanchâtres, composées d’un petit nombre de rayons capillaires, réunis en
anneau à leur base, distincts et ouverts dans le reste de leur étendue\ de la longueur
des semences.
R é c e p t a c l e convexe, n u , glabre, creusé de fossettes dans lesquelles s’inséroient
les semences?
Ors. x.° La plante que je viens de décrire, s’éloigne de tous les genres delà seconde section des Corym-
bifères, avec lesquels on doit la comparer, par plusieurs caractères dont je vais énoncer les plus tranchés.
Elle diffère essentiellement de Y É r ig eron par ses Demi-Fleurons qui ne sont point capillaires; de Y A ster
par son calice dont les folioles ne se recouvrent pas mutuellement comme les tuiles d’un toit; de YIn o la
par ses anthères qui ne sont pas munies de deux soies à leur base; du T ossilago par son aigrette qui
n’est point stipitée; du S e n e c iq par son calice qui n’est pas monophylle, et dont les folioles ne sont pas
noirâtres à leur sommet; du S o l id a g o par le nombre de ses Demi-Fleurons; et du C in e r a r ia par'son
calice entouré de quelques écailles qui forment un calicule. Mais comme parmi ces genres, Y A s ter et le
C in e r a r ia sont , ceux dont'la plante décrite se rapproche davantage par une opposition moins frappante
dans le caractère essentiel, j’ai dû la rapporter à un de ces deux genres, et j’ai préféré celui dont plusieurs
espèces présentent une analogie plus marquée dans leur caractère habituel:
■2.° Le C in e r a r ia hirsuta se rapproche infiniment par son port du C in e r a r ia amelloïdesy mais il en
diffère essentiellement par ses feuilles velues et sinuées, par la couleur de ses fleurs, et par son calice
divisé plus profondément et caliculé. Ces deux espèces présentent dans l’opposition de leurs feuilles un
caractère qui les distingue de toutes les autres espèces du genre.
3.0 L a plante que MM. Aiton et^hunberg ont nommée A s ter Cynibalarioe, a beaucoup de rapport avec
le C in e r a r ia hirsuta; mais comme ces deux célèbres Botanistes n’ont fait aucune mention de l’opposition
des feuilles, et comme M. Thunberg dit expressément que le calice de Y Aster Cymbalarioe est imbriqué,
j’ai dû croire que cette plante étoit absolument différente de celle que je décris.
4.° Les plus belles espèces du genre C in e r a r ia sont cultivées à la Malmaison ; savoir, C in e r a r ia geifolia
L. C in e r a r ia çymbalarifolia L ., C in e r a r ia maritima L., C in e r a r ia am e l loïde s L., et les C in e r a r ia
aurita, cruenta, lobata, ramentosa, viscosa, lanata et popul¿folia YHe r it .
Expi. des fi%. 1, Fleur vue en dessous pour montrer le calice formé de folioles inégales. 2, Ün Demi-
Fleuron. 3, Un Fleuron. 4, Fruit coupé longitudinalement pour montrer la forme du réceptacle. 5, Quelques
semences. ( Figures grossies, à l’exception de la dernière. )