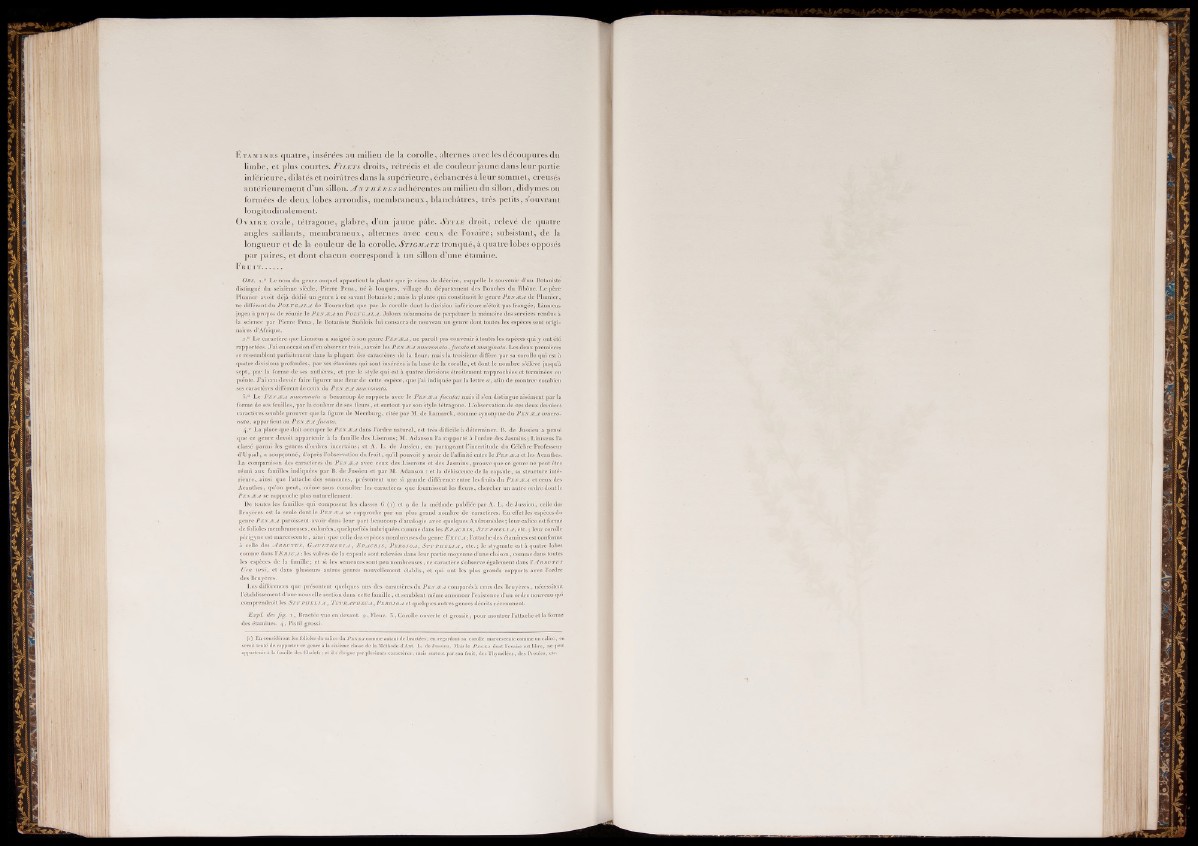
É t a m i n e s q u a t r e , insérées au m ilieu d e la c o ro lle , alternes a v e c les d é co u p u re s du
lim b e , e t plus courtes. F i l e t s d ro its , r é tré c is e t d e c o u le u r ja u n e dans le u r partie
in fé r ie u r e , dilatés e t n oirâtres dans la s u p é r ie u r e , éch an c ré s à le u r sommet, creusés
an té r ieu rem en t d ’un sillon. A n t h è r e s ad hérentes au milieu d u s illon , d id ym e s ou
formées d e d e u x lobes a r ro n d is , m em b ran eu x , b lan ch â tre s , très p e tits , s’ou vrant
lon gitud in alem en t.
O v a i r e ov a le , té lra g o n e , g la b r e , d ’un ja u n e pâle. S t y l e d rp it , re le v é d e quatre
angles saillants, m em b r a n e u x , alternes a v e c c e u x d e l’o v a ire j subsistant, d e la
lo n g u e u r e t d e la c o u le u r d e la coro lle. S t i g m a t e t ro n q u é , à q u a tre lobes opposés
p a r paires, e t d o n t ch a cu n co r re sp on d à u n sillon d ’u n e étamine.
F r u i t .............
Obs. i .° Le nom du genre auquel appartient la plante que je viens de décrire, l’appelle le souvenir d’un Botaniste,
distingué du seizième siècle, Pierre Pena, né à Iouques, village du département des Bouches du Rhône. Le père
Plumier avoit déjà dédié un genre à ce savant Botaniste ; mais la plante qui constituoil le genre P e n æ a de Plumier,
ne différant du P o l f g a i . a de Tournefort que par la corolle dont la division inférieure n’étoit pas frangée, Linnæus
jugea à propos de réunir le P e n æ a au P o l f g a l a . Jaloux néanmoins de perpétuer la mémoire des services rendus à
la science par Pierre Pena, le Botaniste Suédois lui consacra de nouveau un genre dont toutes les espèces sont originaires
d’Afrique.
a.0 Le caractère que Linnæus a assigné à son genre P e n æ a , ne paroît pas convenir à toutes les espèces qui y ont été
rapportées. J’ai eu occasion d’en observer trois, savoir les P e n æ a mucronata, fucata et niarginata. Les deux premières
se ressemblent parfaitement dans la plupart des caractères de la fleur; mais la troisième diffère par sa corolle qui est à
quatre divisions profondes, par ses étamines qui sont insérées à la base de la corolle, et dont le nombre s’élève jusqu’à
sept, par la forme de ses anthères, et par le style qui est à quatre divisions étroitement rapprochées et terminées en
pointe. J’ai cru devoir faire figurer une fleur de cette espèce, que j’ai indiquée par la lettre a, afin de montrer combien
ses caractères diffèrent de ceux du P e n æ a mucronata.
3.° Le P e n æ a mucronata a beaucoup de rapports avec le P e n æ a fucata; mais il s’en distingue aisément par la
forme de ses feuilles, par la couleur de ses fleurs , et surtout par son style tétragone. L’observation de ces deux derniers
caractères semble prouver que la figure de Meerburg, citée par M. de Lamarck, comme synonyme du P e n æ a mucronata,
appartient au P e n æ a fu c a ta .
4-° La place que doit occuper le P e n æ a dans l’ordre naturel, est très difficile à déterminer. B. de Jussieu a pensé
que ce genre devoit appartenir à la famille des Liserons; M. Adanson l’a rapporté à l’ordre des Jasmins; Linnæus l’a
classé parmi les genres d’ordres incertains; et A. L. de Jussieu, en partageant l’incertitude du Célèbre Professeur
d’Upsal, a soupçonné, d’après l’observation du fruit, qu’il pouvoit y avoir de l’affinité entre le P e n æ a et les Acanthes.
La comparaison des caractères du P e n æ a avec ceux des Liserons et des Jasmins, prouve que ce genre ne peut être
réuni aux familles indiquées par B. de Jussieu et par M. Adanson : et la déhiscence de la capsule, sa structure intérieure,
ainsi que l'attache des semences, présentent une si grande différence entre les fruits du P e n æ a et ceux des
Acanthes, qu’on peut, même sans consulter les caractères que fournissent les fleurs, chercher un autre ordre dont le
P e n æ a se rapproche plus naturellement.
De toutes les familles qui composent les classes 6 (i) et g de la méthode publiée par A. L. de Jussieu, celle des
Bruyères est la seule dont le P e n æ a se rapproche par un plus grand nombre de caractères. En effet les espèces du
genre P e n æ a paroissent avoir dans leur port beaucoup d’analogie avec quelques Andromèdes ; leur calice est formé
de folioles membraneuses, colorées, quelquefois imbriquées comme dans les E p a c r i s , S t f p h e l i a , etc. ; leur corolle
périgyne est marcescente, ainsi que celle des espèces nombreuses du genre E r i c A ; l’attache des étamines est conforme
à celle des A r b o t u s , G a o l t h e r i a , E p a c r i s , P e r o j o a , S t f p h e l i a , etc. ; le slygmate est à quatre lobes
comme dans Y E r i c A ; les valves de la capsule sont relevées dans leur partie moyenne d’une cloison, comme dans toutes
les espèces de la famille; et si les semences sont peu nombreuses, ce caractère s’observe également dans Y A r b u t o s
TJva ursi, et dans plusieurs autres genres nouvellement établis, et qui ont les plus grands rapports avec l’ordre
des Bruyères.
Les différences que présentent quelques uns des caractères du P e n æ a comparés à ceux des Bruyères, nécessitent
l’établissement d’une nouvelle section dans cette famille, et semblent même annoncer l’existence d’un ordre nouveau qui
comprendroit les S t f p h e l i a , T e t r a t h e c a , P e r o j o a et quelques autres genres décrits récemment.
Expi. des fig. i , Bractée vue en devant, a , Fleur. 3, Corolle ouverte et grossie, pour montrer l’attache et la formé
des étamines. %, Pistil grossi.
(i) En considérant les folioles du calice du Peuæa comme autant de bractées, en regardant sa corolle marcescente comme un calice, on
seroit tenté de rapporter ce genre à la sixième classe de la Méthode d’Ant. L. de Jussieu. Mais le P-mnjba dont l'ovaire est libre, ne peut
appartenir L la famille des Clialcfs ; et il s’éloigne par plusieurs caractères, mais surtout par son fruit, des Thj’tnélé'es , des Protées, etc.