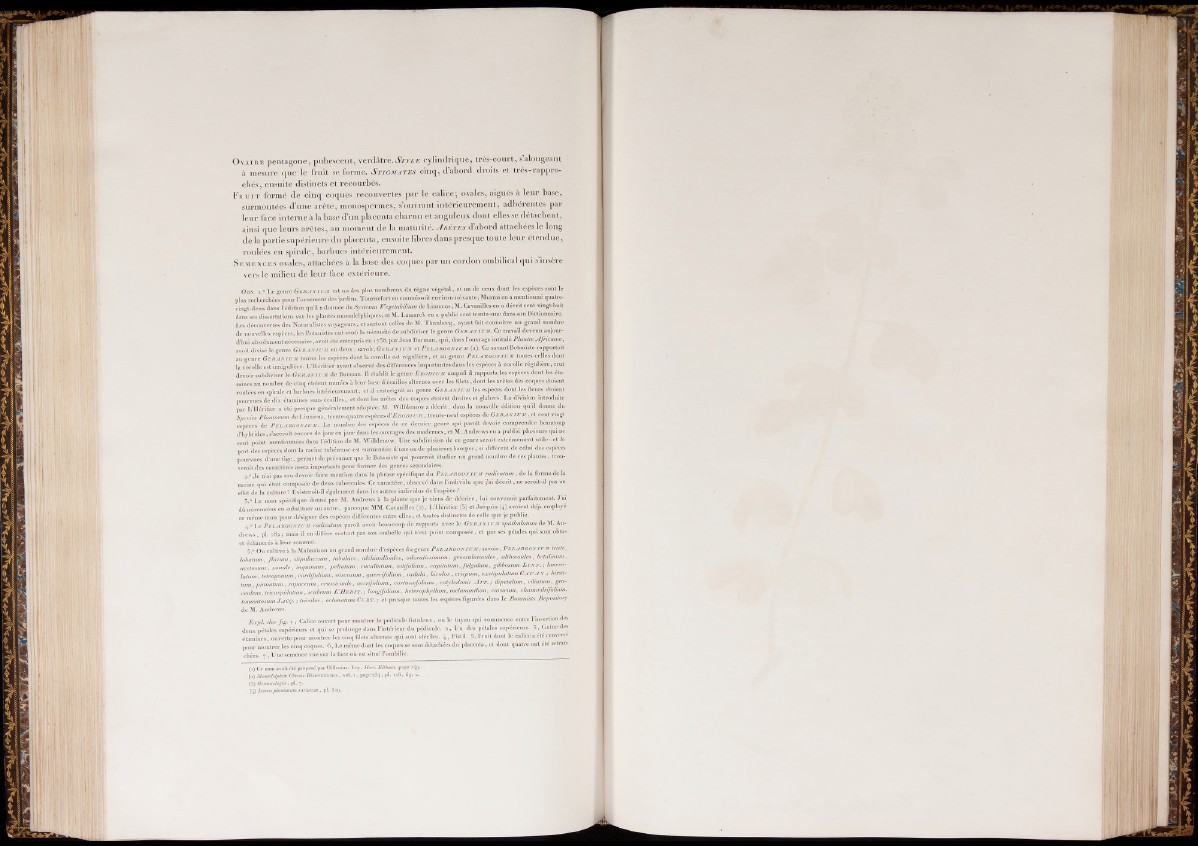
O v a i r e p en ta g o n e , p u b e s c e n t, v e r d â t r e .S t y l e c y l in d r iq u e , trè s -c o u r t, s a lo n g ean t
à mesure q u e le f ru it se forme. S t i g m a t e s c in q , d ’ab o rd droits e t trè s - rap p ro -
ch é s , en suite distincts e t re cou rbé s.
F r u i t form é d e c in q coq u e s re c o u v e r te s p a r le c a l ic e \ ovales , aiguës à le u r base,
surmontées d ’u n e a r ê te , m onosp ermes , s’o u v ran t in té r ie u r em en t , ad h é ren te s par
le u r face in te rn e à la base d ’u n p la cen ta ch a rn u e t an g u le u x d o n t elles se d é ta ch en t,
ainsi q u e le u r s a rê te s , au m om en t d e la m atu r ité . A r ê t e s d a b o rd attachées le long
d e là p artie s u p é r ie u r e d u p la c en ta , en su ite libre s dans p re sq u e to u te le u r é ten d u e ,
rou lé e s en sp ira le , b arb u e s in té r ie u rem en t.
S e m e n c e s ovales , attachées à la base des coq ue s p a r u n c o rd o n om b ilical q u i s’insère
v e r s le m ilieu d e le u r face e x té r ie u re .
O b s . i .° Le aenre G é r a n i u m est un des plus nombreux du règne végétal, et un de ceux dont les espèces sont le
plus recherchées pour l’ornement des jardins. Tournefort en connoissoit environ soixante; Murrai en a mentionné quatre-
vingt-deux dans l’édition qu’il a donnée du Systema Vegetabilium de Linnæus;M. Cavanilles en a décrit cent vingt-huit
dans ses dissertations sur les plantes monadelphiques; etM. Lamarch en a publié cent trente-une dans son Dictionnaire.
Les découvertes des Naturalistes voyageurs, et surtout celles de M. Thunberg, ayant fait connoître un grand nombre
de nouvelles espèces, les Botanistes ont senti la nécessité de subdiviser le genre G é r a n i u m . Ce travail devenu aujourd’hui
absolument nécessaire, avoit été entrepris en i 738,par Jean Burman, qui, dans l’ouvrage intitulé Plantæ Africanoe,
avoit divisé le genre G é r a n i u m en deux ; savoir, Gé r a n i u m et P é l a r g o n i u m (i). Ce savant Botaniste rapportoit
au genre G é r a n i u m toutes les espèces dont la corolle est régulière, et au genre P é l a r g o n i u m toutes celles dont
la corolle est irrégulière. L’Héritier ayant observé des différences importantes dans les espèces.à corolle régulière, crut
devoir subdiviser le G é r a n i u m de Burman. Il établit le genre E r o d i u m auquel il rapporta les espèces dont les étamines
au nombre de cinq étoient munies à leur base d’écailles alternes avec les filets, dont les arêtes des coques étoient
•roulées en spirale et barbues intérieurement; et il restreignit au genre G é r a n i u m les espèces dont les fleurs étoient
pourvues de dix étamines sans écailles, et dont les arêtes des coques étoient droites et glabres. La division introduite
par L’Héritier a été presque généralement adoptée. M. Willdenow a décrit, dans la nouvelle édition qu’il donne du
Species Plantarum de Linnæus, trente-quatre espèces ¿ 'E r o d i u m / trente-neuf espèces de Gé r a n i u m , et cent vingt
espèces de P é l a r g o n i u m . Le nombre des espèces de ce dernier genre qui paroît devoir comprendre beaucoup
d’hybrides, s’accroît encore de jour en jour dans les ouvrages des modernes, etM. Andrews en a publié plusieurs qui ne
sont point mentionnées dans l’édition de M. Willdenow. Une subdivision de ce genre seroit extrêmement utile: et le
port des espèces dont la racine tubéreuse est surmontée d’une nu de plusieurs hampes, si différent de celui des espèces
pourvues d’une tige, permet de présumer que le Botaniste qui pourrait étudier un grand nombre de ces plantes, trou-
veroit des caractères assez importants pour former des genres secondaires.
a.0 Je n’ai pas cru devoir faire mention dans la phrase spécifique du P é l a r g o n i u m r a d i c a tu m , de la forme de la
racine qui étoit composée de deux tubercules. Ce caractère, observé dans l’individu que j’ai décrit,ne Seroit-il pas un
effet de la culture? Existeroit-il également dans les autres individus de l'espèce ?
5.0 Le nom spécifique donné par M. Andrews à la plante que je viens de décrire, lui convenoit parfaitement. J’ai
dû néanmoins ensubstituer un autre, parceque MM. Cavanilles (2), L’Héritier f§ et Jacquin (4) avoient déjà employé
ce même nom pour désigner des espèces différentes entre elles, et toutes distinctes de celle que je publie.
4.0 Le P é l a r g o n i u m radicatum paroît avoir beaucoup de rapports avec le G é r a n i u m spathulatum de M. Andrews
, pl. 282; mais il en diffère surtout par son ombelle qui n’est point composée, et par ses pétales qui sont obtus
et échancrés à leur sommet.
50 Ou cultive à la Malmaison un grand nombre d’espèces du genre P é l a r g o n i u m ; savoir, P é l a r g o n i u m triste,
lo b a tu m , f l a v u m , s t i p u la c e u m , ta b u la r e , a lc h im illo id e s , o d o r a ti s s im u m , g r o s s u la r io id e s , a lth oe o id ê s , b e tid in u m ,
a c e to s u m , s o n a l e , in q u in a n s , p e l t a t u m , c u c u l la t u m , v i t i f o l i u m , c a p ita tu m , f u l g i d u m , g ib b o s u m L i n n . ; la n c c o -
l a tu m , te t r a g o n u m , c o r d i fo l i u m , v i s c o s u m , q u e r c i f o l iu m , r a d u l a , b i c o lo r , c r i s p u m , e x s t i p u la tu m Ga v a n .; h ir su -
t u m , p in n a t u m , r a p a c e u n i , c r a s s ic a ü le , a c e r ifo liu m , c o i lu s c e /o h u m , c o ty le d o n is A i t . ; d ip e ta lu m , c ilia tu m , g r a -
v e o û n s , tr i c u s p id a t u m , s c a b r u m L ' H é r i t . ; lo n g i f o l iu m , h e t e r o p h y ï lu m ,m e I a n a n th o n , c a r n e u n i, c h a m oe d r ifo liu m ,
to m e n to s u m J a c q . ; tr i c o lo r , e c h in a tu m C ü r t . ; et presque toutes les espèces figurées dans le B o ta n is t s R e p o s ito r y
de M. Andrews.
Expi. des fig. 1 , Calice ouvert pour montrer le pédicule fistuleux, ou le tuyau qui commence entre l’insertion des
deux pétales supérieurs et qui se prolonge dans l’intérieur du pédicule. 2, Un des pétales supérieurs. 3 , Gaîne des
étamines, ouverte pour montrer les cinq filets alternes qui sont stériles. 4, Pistil. 5 ,Fruit dont le calice a été renverse
pour montrer les cinq coques. 6, Le même dont les coques se sont détachées du placenta, et dont quatre ont été retranchées.
7 , Une semence vue sur la face où est situé l’ombilic.
(1) Ce nom avoit été proposé par Dillenius. "Ÿoy. Mort. Eltham. page 1/(9.
(2) Monadelphioe C/assis Ehse.rlaliones , vol. l , page 354 , pl.. 118, fig-. *«
(3) Geraniologia, pl. 7.
(4) Icônes plantarum rariorum, pl. 519.