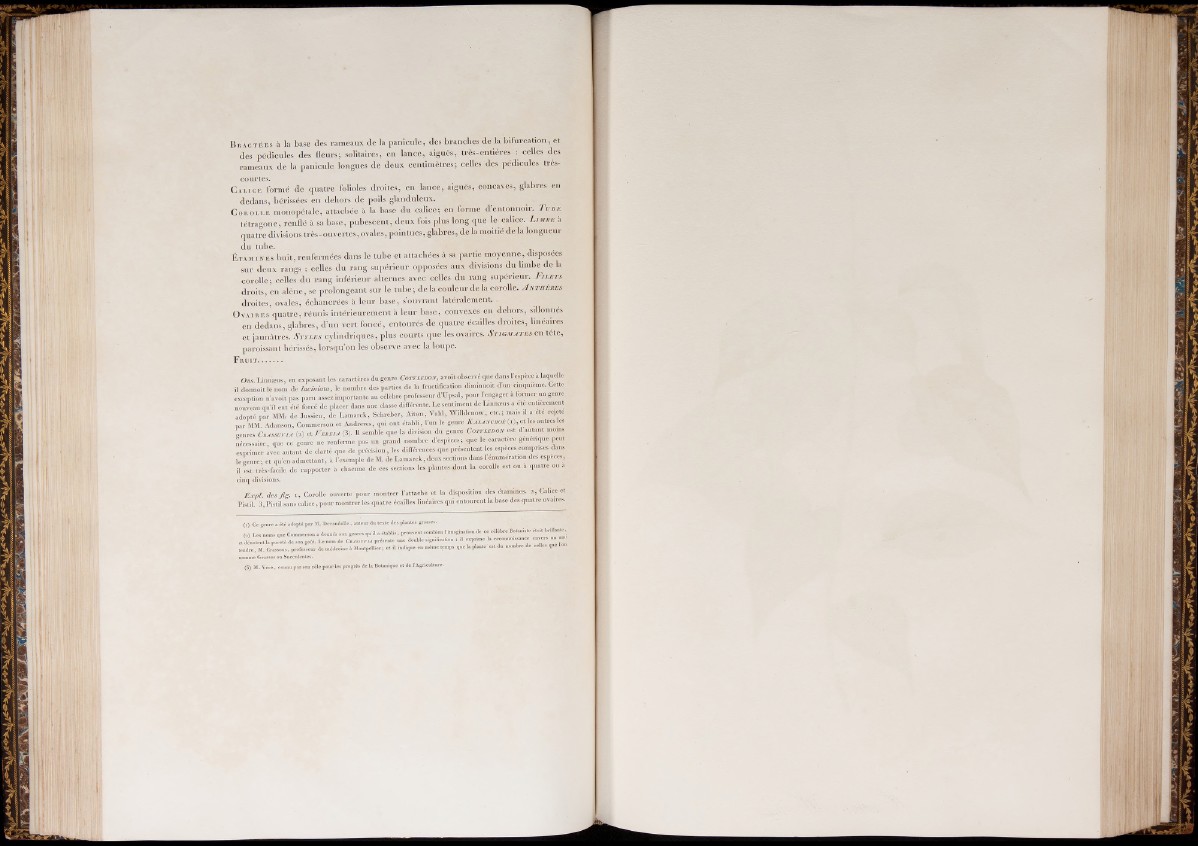
B r a c t é e s à la base des ram e au x d e la p a n ic u le , des b ran ch e s d e la b ifu r c a t io n , e t
des p é d icu le s des fleu rs;, solitaires , en la n c e , aiguës ,, t r è s - e n t i è r e s . c e l l e s des
r am e au x d e la p a n icu le lo n gu e s d e d e u x c en tim è tre s ; celles des p éd icu le s très:
courtes.
C a l i c e fo rm é d e q u a tre folioles d ro ite s , en la n c e , a ig u ë s , co n c a v e s , glabres en
d ed an s , hérissées en d eho rs d e poils g la n d u leu x .
C o r o l l e m o n o p é ta le , a tta ch é e à la base d u calice-, en fo rm e d ’ en to n n o ir . T u b e
té t r a g o n e , r e n f lé à sa b a s e , p u b e s c e n t , d e u x fois plus lo n g q u e l e ca lic e . L im b e à
q u a t r e divisions trè s - o u v e r te s , o v a le s , p o in tu e s , g la b re s , d e la m oitié d e la lo n g u e u r
d u tub e.
ÉTAMiHEs h u i t , ren fe rm é e s dans le tu b e e t attachées à sa p a r tie m o y e n n e , disposées
su r d e u x rang s : ce lle s d u ran g s u p é r ie u r opposées au x divisions d u lim b e d e la
c o r o lle ; celles d u ra n g in fé r ie u r alte rn e s a v e c celles d u ra n g su p é r ieu r . F i l e t s
d ro its , en a lê n e , se p ro lo n g e a n t sur le tu b e ; d e la c o u le u r d e la co ro lle . A n t h è r e s
d ro ite s , o v ale s , é ch a n c ré e s à le u r b a s e , s’o u v ra n t la té ra lem en t. .
O v a i r e s q u a t r e , réu n is in té r ie u r em e n t à le u r b a s e , con v e x e s en d eh o r s , sillonnés
en d e d an s , g la b re s , d ’u n v e r t fo n c é , en to u ré s d e q u a t r e écailles d ro ite s , linéaires
e t jau n â tre s . S t y l e s c y l in d r iq u e s , p lu s cou r ts q u e les.ovaires. S t i g m a t e s en tê te ,
paroissant hérissés, lo r sq u ’on les ob se rv e a v e c la lo u p e .
F r u it ....... . .
Oas.Linn'æus, en exposant les caractères du genre Cottludon, avoit observé que dans l'espèceS laquelle
il donnoit le nom de laoiniata, le nombre des parties de la fructification dimmuoit dun- cinquième. Cette
exception n'avoit pas paru assez importante au célèbre professeur dTJpsal, pour 1 engager a former un genre
nouveau qu’il eut été forcé de placer dans une classe différente. Le sentiment de Lmnæus a etc entièrement
adopté par MM, de Jussieu, de Lamarck, Schreber, Aitou, Vahl, Willdenow, etc.; mais ,1a été rejeté
par MM Adanson, Commerson et Andrews, qui ont établi, l’un le genre IU l a r co ê (,), elles autres les
sentes CiAssunA (a) et (3). Il semble que la division du genre Cotylédon est d autant moins
nécessaire, que ce genre' ne renferme pas un grand nombre d’espèces; que lu caractère générique peut
exprimer avec autant de clarté que de précision, les différences que présentent les espèces comprises dans
le genre; et qu’en admettant, à l’exemple de M. de Lamarclt, deux sections dans rémunération des espèces-,
il est très-facile de rapporter à chacune de ces sections les plantes dont la corolle est ou a quatre ou a
cinq divisions.
Expi. des f is . i , Corolle ouverte pour montrer l'attache et la disposition des étamines. 2, Galice et
Pistil. 3, Pistil sans calice, pour montrer les quatre écailles linéaires qui entourent la base des quatre ovaires.
(1) Ge genre a été adopté par M. Decandolle, auteur du texte des plantes grasses.
M Les noms que Commerson o donnés aux genres qu’il a établis, prouvent combien l'imagination de ce célèbre Botaniste étmt brillante,
et dénotent la pureté de songeât. Le n.m d. C présent, un. double signiSe.tion : il exprime 1. reoonno,ssm.ee ¡m m “
„nuire,IL (basson,, proies,cnr de médecine 1 Montpellier ; et ilindique en même temps quels plante est du nombre de celles qoe
nomme Grasses on Succulentes.
(3) M. Vere, connu par son zèle pour les progrès de la Botanique et de l'Agriculture.