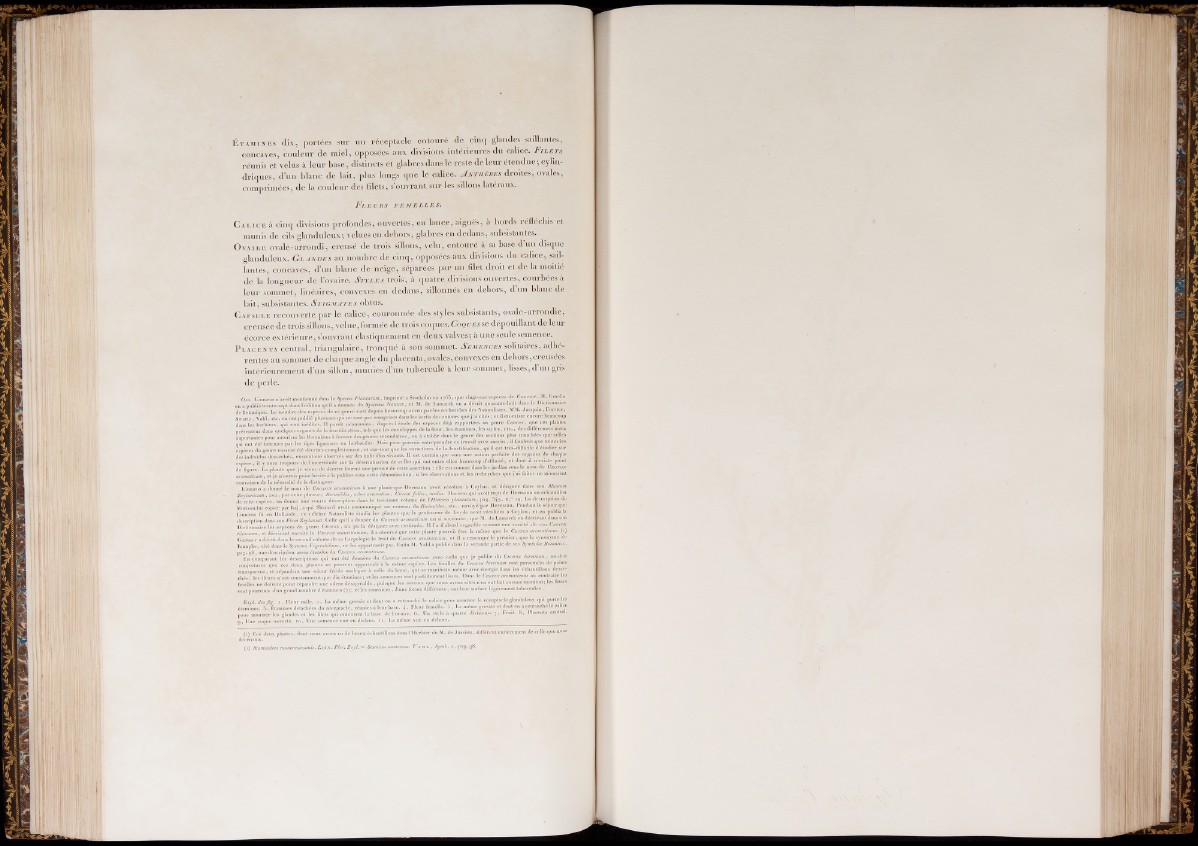
É t a m i n e s d ix , p o r té e s sur un ré c e p ta c le e n to u ré d e c in q g land es saillantes,
c o n c a v e s , c o u le u r d e m ie l , opposées au x divisions in té r ieu re s d u calice . F i l e t s
r éu n is e t v e lu s à le u r b a s e , dis tincts e t g labres dans le re s te d e le u r é t e n d u e -, c y lin d
r iq u e s , d ’u n b la n c d e la it , plus longs q u e le calice . A n t h è r e s d ro ite s , ovales ,
c om p r im é e s , d e la c o u le u r des file ts , s’o u v r a n t su r les sillons la té raux.
F l e u r s f e m e l l e s .
C a l i c e à cinq divisions profondes, ouvertes, en lance, aiguës, à bords réfléchis et
munis de cils glanduleux ; velues en dehors, glabres en dedans, subsistantes.
O v a i r e o v a le -a r r o n d i, c reu s é d e trois sillons , v e lu , e n to u ré à sa base*d’u n disqu e
g la n d u leu x . G l a n d e s au n om b re d e c in q , opposées au x divis ions d u c a lic e , saillan
te s , c o n c a v e s , d ’u n b la n c d e n e ig e , séparées p a r u n file t d r o it e t d e la moitié
d e la lo n g u e u r d e l’ovaire. S t y l e s tro is , à q u a t r e divis ions o u v e r te s , cou rb é e s à
le u r som m e t, lin é a ire s , con v e x e s en d ed an s , sillonnés en d eh o r s , d u n b la n c de
la it , subsistantes. S t i g m a t e s obtus.
C a p s u l e r e c o u v e r te p a r le c a l ic e , c o u ro n n é e des styles subsistants, o v a le -a r ro n d ie ,
c r e u s é e d e trois s illons, v e lu e ,fo rm é e d e trois coques . C o q u e s se d é p o u illan t d e le u r
é c o r c e e x té r ie u r e , s’o u v r a n t é las tiqu em en t en d e u x valves-, à u n e s eu le semence.
P l a c e n t a c e n t r a l, t r ia n g u la ire , t ro n q u é à son sommet. S e m e n c e s solitaires, adhéren
te s a u sommet d e ch a q u e ang le d u p la c en ta ,o v a le s , con v ex e s en d eh o r s , creusées
in té r ie u r em en t d ’u n s illo n , m un ie s d’u n tu b e r c u le à le u r sommet, lisses, d u n gris
d e p erle.
Ods. Linnæus n'avoit mentionné dans le Species Planiarum, imprimé à Stockolm en 1760, que vingt-une espèces de Crotos--M. Gmclin
en a publié trente-sept dans l'édition qu'il a donnée du Sysiema Notera>; et M. de Lamarck en a décrit quarante-huit dans le JDicUonnane
de Botanique. Le nombre des espèces de ce genre s'est depuis beaucoup accru par les recherches des Naturalistes. MM. Jacquin , Forster,
Swartz , Valil, etc. en ont publié plusieurs qui ne sont pas comprises dans les écrits des auteurs que j'ai cités ; et il en existe encore beaucoup
dans les herbiers, qui sont médites. 11 paroit néanmoins, d'après l'étude des espèces déjà rapportées au genre Çrotos, que ces plantes
présentent dans quelques organes de la fructification, tels que les enveloppes de la fleur, les étamines, les styles, etc., des différences assez
importantes pour autoriser les Botanistes à former des genres secondaires, ou à établir dans.le genre des sections plus tranchées que celles
qui ont été fournies par les tiges ligueuses ou herbacées. Mais pour pouvoir entreprendre ce travail avec succès , il faudroit que toutes les
espèces du genre eussent été décrites completteinent, et sur-tout que les caractères de là fructification, qu'il est très-difficile d'etudicr sur
des individus desséchés, eussent été observés sur des individus vivants. Il est certain que sans une notion parfaite des organes de chaque
espèce, il y aura toujours de l'incertitude sur la détermination de celles qui ont entre elles beaucoup d'affinité, et dont il n'existe point
de figure. La plante que je viens de décrire fournit une preuve de cette assertion : elle est connue dans les jardins sous le nom de Choto.v
aromaticum, et je naurois point hésité à la publiersous cette dénomination, si les observations et les recherches que j’ai faites ne m'eussent
convaincu de la nécessité de la distinguer. . _ _
Linnæus a donné le nom de Crotos aromaticum à une plante que Hermann avoit récoltée à Ceylan, et désignée dans son Muséum
Zeylanicum, 202. par celte phrase ; Ricinoïdes, arbor aromalica, Circeoe foliis , media. Morisou qui avoit reçu de Hermann un échantillon
de celte espèce, en donna une courte description dans le troisième volume de l'Historia planiarum, pag. 549, n,° 19 La description de
Morison fut copiée par Raj, à qui Sherard avoit communiqué un rameau du Ricinoïdes, etc., envoyé par Hermann. Pendant le séjour qqc
Linnæus fit en Hollande, ce célèbre Naturaliste étudia les plantes que le professeur de Ley.de avoit récoltées à Ceylan, et en publia la
description dans son Flora Zeylaniea. Celle qu'il a donnée du Crotos aromaticum est si succincte, que M. de Lamarck en décrivant dans son
Dictionnaire les espèces du genre Crotos, n'a pu la désigner avec certitude. 11 l'a d'abord regardée comme une variété de son Crotos
tiliaceumy et'décrivant ensuite le Crotos mauritianum, il a observé que celle plante pouvoit être la même que le Crotos aromaticum-M
Gærlner a décrit dans le second volume de sa Carpologie le fruit du Crotos aromaticum, et il a remarqué le premier, que le synonyme de
Rumphe, cité dans le Systema Fcgeiabilium, ne lui appartenoit pas. Enfin M. Vahl a publié dans la seconde partie de ses Symboles Botanicoe,
pag. 98, une description assez étendue du Crotos aromaticum. . >, , c
En comparant les descriptions qui ont été données du Crotos aromaticum avec celle que je publie du Crotos hiremum, on doit
conjecturer que ces deux plantes ne peuvent appartenir à la même espèce. Les feuilles du Crotos hircinum sont parsemées de points
transparens, et répandent une odeur fétide analogue à celle du bouc , qui se manifeste même avec énergie dans les échantillons desséchés;
les fleurs n'ont constamment que dix étamines ; elles semences sont parfaitement lisses. Dans le Crotos aromaticum au contraire les
feuilles ne doivent point répandre une odeur désagréable , puisque les auteurs que nous avons cités n'en ont fait aucune mention ; les fleurs
sont pourvues d'ùn grand nombre d'étâmincs (a); elles semences, d'une forme différente, ont leur surface légèrement tuberculce.
Expi. des f g . 1 , Fleur mile, a , La même grossie et dont on a retranché le calice pour montrer le réceptacle glanduleux qui porte les
étamines. 5 , Étamines détachées du réceptacle, réunies à leur base. 4 , Fleur femelle. 5 , La même grossie et dont on a retranché le calice
pour montrer les glandes et les filets qui entourent la base de l'ovaire. 6, Un style à quatre divisions. 7, Fruit. 8, Placenta central.
9, Une coque ouverte. io-, Une semence vue en dedans. 11 -, La même vue en dehors.
(1) Ces deux plantes, dont nous avons vu de beaux échantillons dans l'Herbier de M. de Jussîeu, diffèrent entièrement de celle que nous
décrivons.
(2) St a minibus numerosissimit. L i s S. Flor. Zeyl. — Stamina numérota. V a n i , Synib. 2, pag. 98.